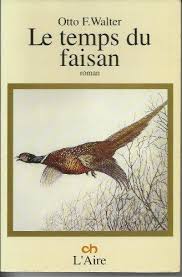L’écrivain en anarchiste solidaire
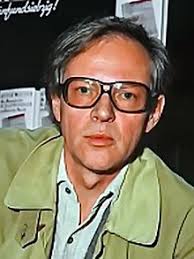
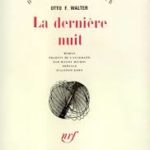
Un entretien avec l’écrivain alémanique Otto F. Walter,
par René Zahnd
En France, la notion d’engagement a pris une couleur désuète et des connotations négatives. Sartre et ses petits camarades ont fait des ravages. Le dandy, le cynique, le mondain ou autres figures de la gent littéraire ont aujourd’hui davantage droit de cité. En revanche, dans les pays germanophones, l’expression «écrivain engagé» garde sa raison d’être, grâce à des auteurs qui cherchent à faire la part des choses entre la littérature et les combats qu’ils mènent. La nature même de l’engagement y a changé ces trente dernières années, venant comme une réponse à l’ évolution du monde. Pourfendeurs des valeurs établies, réviseurs de l’Histoire, titilleurs du conformisme, mais aussi explorateurs du verbe et de la structure narrative, ces écrivains sèment volontiers des grains de sable dans les rouages de la bonne conscience helvétique. Quand ce ne sont pas carrément des pavés.
Parmi eux, le romancier Otto F . Walter apparaît comme l’ une des voix marquantes, non seulement par son authenticité, mais aussi par la qualité de ses œuvres, qui cherchent à marier la pensée au souffle romanes-que, voire la poésie à la rigueur scientifique. On en veut pour preuve Le Temps du faisan, qui vient de paraître en traduction française.
– L ’expression «écrivain engagé» vous est volontiers attribuée. Que signifie pour vous cette étiquette ?
– Par littérature engagée, on entend souvent une littérature de forme triviale, écrite dans l’ unique but de livrer un contenu, un message. Cette conception traditionnelle de la littérature engagée n’ est pas exacte en ce qui me concerne. Je crois que l’ étiquette me vient du fait qu’à côté de mon activité littéraire, je participe directement à la vie publique. Je me mêle du discours politique. Par exemple, j’ai pris la parole lors de manifestations qui peuvent réunir des dizaines de milliers de personnes. Cela explique pourquoi on me taxe d’ écrivain engagé.
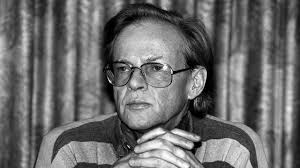
Ce n’est pas faux, mais je m’ oppose à une compréhension réductrice de cette idée. La littérature m’ intéresse d’ abord en tant qu’ expression artistique. Je crois que cette dimension est visible dans mes livres. En même temps, je suis convaincu que la littérature offre la possibilité de discuter de problèmes politiques. Plusieurs de mes livres s’ occupent, entre autres, des attitudes, des convictions et des idées des personnages, parce que j’ estime que la pensée peut s’ exprimer dans un roman. Cette part de l’homme a aussi sa place dans l’œuvre d’art. Mais je n’ essaie pas, comme le ferait un missionnaire, de travailler à l’ amélioration du monde par le biais de la littérature ! Ce n’est pas mon propos.
– Mais si l’on considère que l’individu est soit un observateur , soit un acteur , vous êtes plutôt quelqu’un qui agit.
– Oui. Ce qui m’amuse est que certains critiques me taxent d’ écrivain formaliste et d’ autres d’ écrivain engagé ! J’ espère que les deux ont raison !
– Quelle a été l’ influence du Nouveau Roman sur votre travail littéraire ?
– Je crois qu’il faut distinguer les choses. La figure la plus importante de mon éveil à la littérature reste William Faulkner. Il a été pour moi comme une sorte de maître d’ initiation. Son œuvre m’ a encouragé à considérer la forme traditionnelle du roman de manière sceptique et critique. Mon premier livre, Der Stumme, a été conçu sans que je connaisse les tendances littéraires en France. Entre 59 et 62, j’ ai écrit mon deuxième roman, Herr Tourel. Je crois que c’est le livre qui, de manière la plus explicite, cherche à mettre à jour, positivement, la crise fondamentale du roman classique. J’ai alors été conforté dans mon propos en sachant qu’ en France travaillaient Robbe-Grillet et les autres. Mais les écrits importants de ce concert très disparate – Nathalie Sarraute, Butor, Claude Simon, Alain Robbe- Grillet – ne m’ont influencé que plus tard dans mon travail. Je suis persuadé que des expériences similaires peuvent conduire à des résultats comparables dans plusieurs lieux simultanément. J’ai donc été surpris d’ être désigné, principalement en Allemagne, comme un représentant du Nouveau Roman. D’ une manière générale, je crois que nous devons, nous les écrivains, nous laisser stimuler, encourager, inspirer par la littérature mondiale dans son ensemble. Elle met à notre disposition un vaste répertoire de possibilités déjà explorées et qui invitent à de nouveaux développements. Quand j’ ai besoin d’ une certaine clef à molette, et que je ne la trouve pas dans mon atelier, je vais dans la grande boîte à outils de la littérature mondiale.
– Votre travail sur le fragment, sur le montage est frappant. Est-ce pour vous un moyen adéquat de restituer la réalité ?
– Cette technique du montage s’est révélée fructueuse pour moi. J’ai été influencé par Alfred Döblin, en particulier par ce livre grandiose qu’est Berlin, Alexanderplatz. En lisant Döblin, j’étais persuadé que, à notre époque, la technique du montage pouvait être davantage développée. Un de mes livres, Die ersten Unruhen, qui n’ a pas été traduit, est constitué de citations, de matériaux découverts, de fragments, tout comme Jean Tinguely concevait des machines avec des objets trouvés. C’est une expérience très excitante, que j’ ai poursuivie, jusqu’à la relier avec ma propre subjectivité narrative. Le montage permet justement d’ aller chercher les différents champs de la réalité et de les intégrer à l’ ensemble du roman. De fait, le roman est un média conservateur, un média lent, hérité du temps des diligences. Et chercher sans arrêt le rythme et la sensibilité qui caractérisent notre temps est une démarche qui m’ intéresse. J’ espère que chaque livre témoigne de l’évolution de cette recherche. Dans cette perspective, Le Temps du faisan m’ apparaît d’ ailleurs comme une première tentative de synthèse des différentes tech- niques et explorations présentes dans mon travail.
– Dans Le Temps du faisan, l’Histoire est très présente, et en particulier celle de la Suisse durant la guerre.
– Je dois avouer que je n’ai pas mené d’importantes recherches dans les archives. En revanche, j’ai voulu m’informer, en lisant les publications récentes, travaillant en collaboration avec l’historien Jakob Tanner, qui a écrit un livre sur les relations économiques entre la Suisse et le Troisième Reich. J’ai alors défini trois axes charnières: les documents découverts à La Charité-sur-Loire (révélant des accords militaires secrets), le rapport du Rütli et le Réduit national, afin de donner un éclairage sur ce qu’ on a appelé la «politique du Général», pour finalement cerner l’ensemble de la politique fédérale de la Suisse. A partir de là, je me suis occupé de certaines questions essentielles, sans oublier, bien sûr, le thème de la culpabilité helvétique, due au mutisme et à la thésaurisation. L’industrie suisse tournait à plein régime. Evidemment, nous n’ avons aucune raison de juger cette génération – j’avais dix-sept ans en 1945 –, mais les choses doivent être posées sur la table. Il s’agit de savoir comment les dirigeants d’ alors ont manœuvré dans ces circonstances. A mon avis, il faut le dire: la Suisse a sa part de responsabilité dans l’ existence d’ Auschwitz. Ce n’est pas un nouvelle réjouissante à révéler ici et maintenant.
– Dans votre livre il y a cette phrase: «Le passé n’est peut- être pas que le passé.» Est-ce votre sentiment ?
– On évoque le comportement de la Suisse durant la seconde guerre mondiale comme si on parlait d’un musée, d’événements très éloignés dans le temps. Mon livre montre peut- être aussi de quelle manière des forces qui ont conduit à cette catastrophe, dans un contexte historique précis, existent aussi aujourd’hui, et même de façon virulente. Par exemple: la xénophobie, la haine de l’étranger. Autre exemple: la guerre du Golfe, qui selon moi a été une affreuse action colonialiste de l’Ouest, contre un agresseur horrible, c’ est entendu. Mais il s’ agissait d’ une incroyable tentative d’ingérence dans le monde arabe. Et on pourrait multiplier les exemples, jusqu’aux forces économiques, à mon avis très destructrices.
– Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la Suisse ?
– Je suis nettement plus pessimiste qu’il y a dix ans. J’ai l’impression que nos problèmes se retrouvent, fondamentalement pareils, dans l’ensemble du monde industrialisé et, au fond, je distingue à peine une issue. La crise économique frappe les Etats-Unis. Elle vient maintenant chez nous, en Europe, dans chaque pays de manière un peu différente. C’est une crise de la production et de l’ innovation. On essaie d’y remédier de manière absurde, en pensant que les méthodes qui ont mené à la crise doivent aussi la résorber ! Deuxièmement il y a toute la problématique Nord-Sud et Est- Ouest. Troisièmement, il y a la crise écologique. Les ressources ne sont pas infinies, et nous agissons comme si elles étaient infinies. Face à cette situation, nous continuons à appliquer les vieilles recettes, qui poussent toujours à la croissance et aggravent l’ ensemble de ces catastrophes. C’est la raison pour laquelle je suis très pessimiste.
Du point de vue culturel, si je considère, ici en Suisse alémanique, la domination de la télévision allemande, les tirages gigantesques des magazines allemands, c’ est-à-dire comment les importantes cultures locales sont aplaties par une vaste pression, et comment une sorte de «culture-Dallas» universelle se répand par-dessus tout, alors je trouve que la situation est très grave. C’ est pourquoi je plaide pour une décentralisation à tous les niveaux, également dans le domaine de la culture, afin que les centres de décision soient aussi près que possible des gens et des problèmes, et que tout ne soit pas réglé par un grand appareil central, dans une certaine mesure très éloigné de la réalité. C’ est la raison pour laquelle je suis très sceptique quant à la construction de l’Europe, même s’ il s’ agit au départ d’ une idée grandiose.
– Dans cette vision pessimiste que vous décrivez, on peut se demander où réside le sens de la littérature.
– La littérature reste un moyen de sensibilisation et, disons, de connaissance. Elle permet de s’ interroger sur les forces qui nous déterminent. Qui suis-je ? Cette vieille question, la littérature doit la poser aujourd’hui et devra encore la poser demain. Il s’ agira toujours de fournir des éléments de réponse, avec de nouveaux éclairages. Enfin, je crois et j’ espère que la littérature restera un baromètre qui indiquera l’ ampleur des dégâts, de préférence en les annonçant à l’ avance. On ne peut tout de même pas lui en demander beaucoup plus ! Dans le fond, ma pensée est celle d’ un anarchiste solidaire, position qui est aussi discutée dans Le Temps du faisan. C’est une utopie lointaine, pour un monde solidaire. De toute manière, et jusqu’à présent, il s’agit du plus beau rêve poli- tique qui ait été formulé.
Propos recueillis par René Zahnd