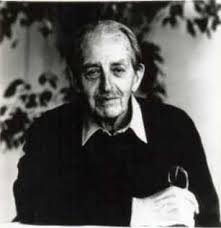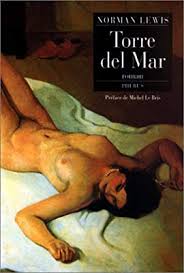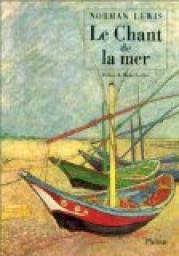Le voyageur immobile
À propos d’un roman (Torre del Mar) et de chroniques (Le chant de la mer) de Norman Lewis,
par René Zahnd
Depuis quelques années, on fait grand cas des écrivains voyageurs (ou, en termes plus branchés: des travel-writers) qui, pour les maniaques de classification, paraissent composer une race à part.
Norman Lewis est sans doute l’une des figures les plus étranges de cette tribu, qui ne manque pourtant pas d’individus farfelus ou fantasques, d’illuminés originaux et autres hurluberlus heureux de jouer à la marelle sur la grille des méridiens et des parallèles. Oui, une des figures les plus étranges, à cause de la réserve qui est la sienne et à cause de sa faculté à restituer des réalités saisies dans leur intimité.
Né en 1914 au Pays de Galles, élevé par trois tantes dont l’une subissait en moyenne une crise d’épilepsie par jour, Norman Lewis a goûté aux horizons lointains dès les années trente. La guerre le surprend à Cuba, il se fait engager dans l’Intelligence Service, débarque en Sicile, est affecté au bureau de Naples, ville qui est le théâtre d’exactions multiples, où les forces alliées et la mafia jouent les premiers rôles. Trente ans plus tard, il se remémorera cette période tourmentée dans Naples 44, que les Editions Phébus annoncent en traduction française.
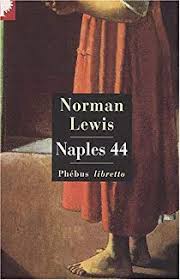
Après la défaite des forces de l’Axe, Norman Lewis part pour l’Amérique latine puis, souffrant, prendra quelque repos sur la Costa Brava, dans un village de pêcheurs. Après ? Birmanie, Viêtnam, Laos, Cambodge, Balkans, Cuba, Union Soviétique, Caraïbe, Inde, Indonésie, Amérique latine… Il fréquente les même bars que Graham Greene, sans jamais le rencontrer. Il croise Hemingway à La Havane. Discret, ne se mettant jamais en avant, le voyageur n’en était pas moins un humaniste de gauche, élevant la voix pour dénoncer l’ethnocide des tribus d’Amazonie en 1968 ou témoignant, dans The Missionaries, des ravages causés par les fondamentalistes chrétiens parmi les sociétés primitives d’Amérique latine.
Dans la préface à l’édition française de Torre del mar, Michel Le Bris note: «Un écrivain engagé, donc — appellation qui lui aurait conféré, il y a encore quelques années, des airs de dinosaure. Mais un écrivain, d’abord, dont le regard lucide et gardant toujours la bonne distance a préservé ses livres de toute dérive prêcheuse: livres qui n’ont pas pris une ride, pendant que tant d’autres, chargés des meilleurs intentions, nous sont devenus illisibles.»
Sans doute est-il singulier d’aborder l’oeuvre d’un «écrivain voyageur» avec des textes qui se caractérisent par une forme d’immobilité. Car Norman Lewis, au contraire de beaucoup de ses pairs, ne donne pas dans la relation du mouvement. La trace de ses pas dans la poussière du globe terrestre ne paraît guère lui importer. On le sent plutôt adepte de la station, de l’observation patiente d’un morceau de réalité qu’il se met éplucher comme un oignon, en enlevant une couche après l’autre.
A la fin des années quarante, tant pour se soigner le corps que pour cautériser le traumatisme de la guerre, Norman Lewis séjourna donc trois saisons dans un petit port de la Costa Brava. Et c’est de cette expérience qu’il rend compte dans deux livres: un roman (Torre del mar) et une chronique villageoise (Le chant de la mer). Les deux sont superbes, témoignant d’une attention rare aux êtres, aux plus infimes frémissements, comme si l’écrivain, blessé dans sa chair et dans son âme, s’était détourné des abysses intérieurs pour regarder tout entier vers l’extérieur, vers les autres.
Torre del mar, volet romanesque de ce diptyque, se déroule dans un petit village dont les habitants ont le coeur communiste. Mais le franquisme a passé, alors, chaque jour, ils apprennent à ruser avec les représentants du pouvoir. Le héros se nomme Costa. Décoré par les nationalistes suite à un concours de circonstance, la communauté le rejette. Comme tous les hommes, il se livre à la pêche, traque le mérou dans les grottes sous-marines, et rêve de se marier à Elena, projet impossible à réaliser tant qu’il n’a pas réuni les fonds nécessaires. Car on est pauvre, au village, mais respectueux des traditions et soumis aux superstitions.
Pour Costa et les autres, tout va se précipiter en quelques semaines. Les caïds du marché noir s’installent sur la côte. Ils amènent de l’argent, brassent des affaires, font venir des touristes. Et puis il y a la Garde civile, l’activiste «rouge» venu en mission depuis la France, les pêcheurs illettrés qui racontent les péripéties de la journée dans le style de Lope de Vega. Et tant de personnages, tels Don Federico Vilanova, l’aristocrate réactionnaire, ou le lieutenant Calles qui déteste l’endroit, ou encore la gitane Paquita… Tout cela forme une toile de fond humaine sur laquelle se déroulent des événements extraordinaires, qu’on se gardera bien de dévoiler ici.
Avec Le chant de la mer, Norman Lewis traite exactement du même univers. L’absence du romanesque est ici compensée, avec quel avantage, par un approfondissement de la perception. Deux villages perdus sont décrits: le village des chats, niché au bord de la mer et tirant ses principales ressources de celle-ci, et le village des chiens, un peu en retrait de la côte, vivant de l’exploitation des chênes-liège. En trois ans, l’équilibre précaire va basculer. Nous sommes dans une articulation de l’histoire.
Il y avait les pêches traditionnelles conduites par le curandero, manière de sorcier sachant repérer les bancs de thons à l’odeur. Il y avait la torpeur des siècles. Et toujours cette frise de portraits: tel humble personnage amoureux de la mer; Don Ignacio, le curé respectueux des us et coutumes de cette population païenne, qui s’esquive souvent pour gratouiller la terre en quête de trésors archéologiques: ou Don Alberto, l’aristocrate ronchon et ruiné, qui pour afficher son oisiveté passe ses journées en pyjama rayé et dont la porte d’entrée est démunie de sonnette, le visiteur devant pousser un puissant «Ave Maria Purissima» s’il entend se faire ouvrir l’huis!
Dès la deuxième saison, sous l’influence d’un magnat de la contrebande, le petit village de pêcheurs va là encore connaître une manière de révolution: le tourisme. Mais, selon les vieux pêcheurs pétris de sagesse qui parlent en vers libre au bistrot de la place, il ne s’agit là que d’un phénomène passager…
L’événement dont ses deux livres témoignent est la disparition d’une civilisation. Chacun à sa manière, ils montrent la perte d’identité qui en résulte. Au-delà des thèmes, la force de ces ouvrages naît de l’écriture somptueuse qui compose une musique parfois ténue, parfois puissante, mais toujours en harmonie avec un pays et ses habitants.
L’intensité du regard que Norman Lewis porte sur ses semblables, la faculté qu’il possède de capter les personnalités, de les restituer par le pouvoir des phrases, de tisser cette toile d’araignée, souvent insaisissable, qui relie l’individu à l’espace et au temps font le reste. C’est la marque d’un homme qui est peut-être un écrivain engagé, peut-être un écrivain voyageur, mais à coup sûr un grand écrivain.
R. Z.