Le vagabond aux semelles d’argile
Dans la foulée de Paul Nizon,
par Claire Julier
Que devons-nous faire nous les quelques-uns qui n’aspirons qu’à habiter dans une vie, qui aimerions avoir une saison, une année, une vie, une terre, un paysage et une place ? Et un ciel qui va avec, et un temps que l’on verrait venir d’en haut, une situation et un âge qui seraient les nôtres ? Et peut-être une conviction qui germerait de tout cela, et la force de la porter ?
Se sentir infiniment délesté, ne rien posséder, n’appartenir à personne, être léger pour être prêt et dispos, vivre exempt de besoin, d’actes, sans jour, sans nuit, sans temps, être entre le plus jamais et le jamais plus, «entre», c’est cela qui convient à l’homme autofictionnaire qui habite les pages d’écriture de Paul Nizon.

Les divers «je» conteurs qui dansent avec les mots expriment la quête obsessionnelle de l’écrivain. Ils cherchent à être libres, même si ce n’est pour rien, mais libres. A n’appartenir à personne, sauf à soi – même pour mieux sentir appartenir au monde des hommes. A être présent au mon-de, un «oui» d’adhésion totale qui passe par mourir et renaître. Car il faut mourir à un passé qui entrave, qui empêche rêverie et contemplation, qui plante des racines dans un lieu où l’on n’existait pour personne et où les désirs des aînés se sont perdus dans une réalité morne. Il faut mourir à la contrée du père – grabataire, figé sur son lit, impuissant, le fil de son histoire coupé – à la contrée des mères – fourmis besogneuses – au romanesque de l’amour avorté, pris au piège de la maison, immobilisé derrière ses murs, à la vie qui se flétrit au fond de quelque mont-de-piété et, dans la chambre alvéole, renaître. Se donner la vie soi-même, libéré des attaches, s’inventer dans l’acte de la création, dans la poésie à l’état pur.
L’homme de Chien est un étranger. Il vagabonde à son rythme, à son souffle, vivant d’instants, de regards. Il n’a pas de projection dans des vies imaginaires; il vit simplement des instants de présent, dans l’instinct retrouvé, un privilège de sa liberté acquise en coupant avec tout ce qui pouvait le retenir, sans bagages, sans attaches, perpétuel clandestin, exilé et dans son besoin assumé de se sentir en exil – même dans l’exil de la langue maternelle – il est parvenu à se détacher de tout parce que simplement un jour il est allé ailleurs. Il ne revendique aucune place dans le monde, il peut s’arrêter où il veut, voyant des bribes de souvenirs, images qui passent sans le rattacher à quoi que ce soit comme la succession de chiens qu’il a eus qui devient un seul et unique Chien, clochard sans l’être puisqu’il est encore l’étranger dans ce monde de la paupérisation, le vivant d’une manière anar-chique, simple photographe d’instantanés sans retouches. Il marche dans les rues, s’assied dans les squares, trouve «ces moments de plénitude où l’on ne fait rien».
«Je suis là comme un meuble oublié, superflu. Parfois je peux entendre le temps gronder en moi comme dans un tuyau de chauffage. Parfois je suis un cinéma et le film passe en moi. Je trouve que mon existence n’est ni dure, ni aride. Je ne ressens rien du tout.» Et dans cet état d’ivresse par-delà le vide, ses sens entrent en correspondance. Musicien, peintre, sculpteur, architecte du rien, poète de l’instant toujours en mouvement.
L’homme de Chien semble être revenu de tout, être passé par les chemins habituels qui font connaître le sentiment de la perte par anticipation, la menace de la solitude, la peur. Parce qu’il portait cela en lui, il a toujours fui à grandes enjambées ce qui était tracé, s’est toujours enfui de chaque lieu, de chaque lien, de tout amour qui pouvait durer.
Marcher à travers le monde, de Rome en Afrique du Nord, de la Suisse à Paris, les divers protagonistes de Paul Nizon marchent. Ils ont le temps pour eux. Marcher est une manière de vivre à la vie. Car être en chemin pendant un certain temps fait sortir de l’étrangeté; le tâtonnement dans l’obscurité active la circulation interne des pensées. «La promenade amorce la course folle à travers le monde sous le crâne.»
L’homme de Paul Nizon, autrefois, sans aucun fil directeur, errait au hasard, dans les villes, se chauffant aux amours de passage, se noyant avec volupté dans des feux d’artifice charnels, vivant, sur un simple regard, un balancement de hanches, le sentiment de «résurrection de la femme depuis les profondeurs de la désirance, la première femme avec toutes les promesses de l’amour». Aujourd’hui il sait qu’il a vieilli. Il en dresse le constat. Le monde s’accentue autour de lui. Son regard s’est aiguisé et alors qu’avant il s’égayait ou se chargeait de mélancolie au hasard des rencontres, aujourd’hui, plus seul encore, s’étant dépossédé de tout car il sait qu’il n’y a rien à perdre, il voit sans compassion les problèmes liés à la délinquance, à la violence, à l’exclusion sous toutes ses formes, comme les faits divers qu’il lit dans des journaux ramassés dans les poubelles, morts anonymes, meurtres sans gloire, suicides désespérants, histoires qu’il lit avec un «mélange de fascination et d’ennui».
Mais d’observateur, il croit devenir observé et cela le met en déroute. S’imaginant sans liens sociaux avec quiconque, délesté de tout, même de l’attache la plus banale et la plus essentielle, celle du chien, quelques mots prononcés vont suffire à mettre son innocence en danger. Un écrivain pourrait le penser, lui inventer une histoire, lui voler son âme et lui faire «perdre l’irresponsabilité de la réflexion». Entre eux se joue un jeu d’esquive, de résistance, de renonciation. Qui est la fiction de l’autre ? Où est la vérité, où est le mensonge ? De l’écrivain ou du clochard qui invente l’autre, qui le crée ? qui fait ressortir par des ombres son propre sentiment de la vie ?
Chien, ode magnifique à la liberté, semble annoncer une respiration encore plus profonde de l’éternel vagabond comme si, en-fin affranchi des obsessions personnelles et d’un passé rangé à sa place de passé, il pouvait se mettre en route pour un autre rêve éveillé. «Je ne suis jamais entré dans la forêt, je me suis toujours contenté de rester à l’orée», dit Stolz. «Est-ce qu’à présent j’entre dans la forêt ?» dit Paul Nizon dans Marcher à l’Ecriture. A force de promenades en soi-même, de ruptures, d’exils, d’immersions dans l’Autre Pays, legs indirect et magnifié du père, avec en son centre la ville, «pierre à aiguiser, provocation, destructrice, mère nourricière et matrice, puissance souveraine, la ville qui – de par la volonté de survivre – met l’écrivain en mouvement», l’écrivain s’est libéré de tout. Le «je» et le «tu», l’ombre et son double, se fondent ensemble, comme si l’artiste et l’homme enfin se reconnaissaient, se glissaient dans la même forme, se réconciliaient, s’unissaient, libres, et reliaient la vie et l’art.
C. J.
Paul Nizon, Chien (Hund, Bachte am Mittag), roman traduit de l’allemand par Pierre Deshusses, Actes Sud, 1988, 117 p. Intégrale des œuvres autofictionnaires de Paul Nizon réunies par Actes Sud dans la collection Thesaurus, 1015 pages.
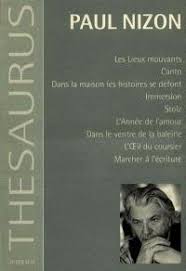
(Le Passe-Muraille, No 39, Décembre 1998)


