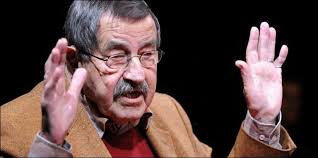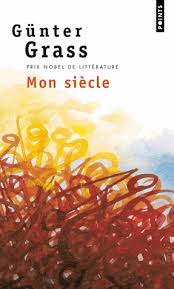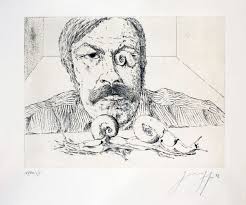Le siècle de Günter Grass
À propos d’une chronique polyphonique kolossale,
par JLK
Pour évoquer l’année 1999, dernière du siècle que Günter Grass évoque en cent chapitres, c’est une très vieille dame qui nous parle, dont nous comprenons bientôt qu’elle n’est autre que la mère de l’écrivain consacré, cette même année, par un prix Nobel de littérature amplement mérité. Parlant tendrement de son fou de fils aux «histoires à dormir debout», la brave centenaire évoque son temps «d’avant et encore avant» où «c’était la guerre, tout le temps la guerre», elle-même ayant perdu son mari en 1914 à Tannenberg. Or cette déploration nous renvoie au premier chapitre du livre, en 1900 et en Chine, quand un petit gars de Basse-Bavière engagé dans la guerre des Boxers remarque déjà qu’«il y avait tout le temps la guerre»…
Ce que le lecteur attentif aura noté, cependant, c’est que la mère de Grass, décédée depuis longtemps mais si présente dans son récit, n’est à vrai dire qu’un personnage ressuscité par l’imagination et la verve créatrice du romancier se faisant, dans Mon siècle, le chroniqueur de tout un siècle d’histoire allemande revisitée, dont le déploiement millésimé n’a rien de fastidieux ni de mécanique.
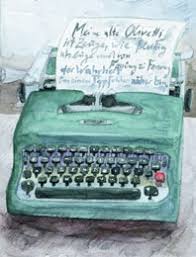

De fait, la structure apparemment linéaire du livre est bousculée à tout moment par le changement constant des points de vue dans l’espace et dans le temps. Ce qui pourrait n’être qu’une chronique monotone devient alors un aperçu kaléidoscopique ou, plus exactement, un étonnant concert de voix restituant la rumeur du siècle.
Siècle de tueries de masse, notre vingtième commence ici place Tienanmen – tristement célèbre pour de plus récents événements – avec le massacre des Boxers auquel assiste un petit engagé volontaire allemand auquel son empereur a recommandé de ne pas faire de quartier et qui ramènera la natte-souvenir d’un supplicié à sa fiancée, laquelle jettera la relique au feu par crainte de la poisse. D’emblée ainsi, par une sorte de regard latéral sur l’Histoire en train de se faire, Grass prête sa voix à un personnage dont il rend l’inflexion particulière, comme il restituera celle des grévistes ou de la danseuse de shimmy, du souverain écrivant une lettre à un pair ou du passionné de courses cyclistes se rappelant les Six Jours de Berlin en 1909, entre cent autres. D’entrée de jeu, le thème du chauvinisme national est également lancé, qui se matérialise sous la forme d’un monumental étron de granit sur lequel ont été gravés les mots Gott mit Uns, en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale.
Pour évoquer les horreurs de celle-ci, Günter Grass prend soudain un demi-siècle d’avance-recul, faisant se rencontrer l’antimilitariste Erich Maria Remarque (auteur d’À l’Ouest rien de nouveau) et l’ex-officier nationaliste Ernst Jünger (héros médaillé et auteur d’Orages d’acier) à Zurich, dans les années 60, par l’entremise d’une jeune dame qui leur offre du birchermüesli. Clin d’œil mis à part (et il y en a des quantités dans le livre que les non-familiers de culture germanique ne remarqueront pas), cette façon de raconter la guerre «entre Allemands» est à la fois symbolique et significative, notamment lorsque les deux vieillards se mettent à bruiter ensemble le champ de bataille, abandonnant ensuite à «ce fou de Céline» le soin d’une autre conclusion.
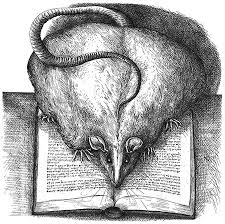
Conteur picaresque aux inépuisables ressources d’observation, Günter Grass brosse, dans Mon siècle, une fresque où des faits apparemment anodins, comme le championnat d’Altona de 1903 (coup d’envoi de l’essor du foot allemand) ou la cueillette des cèpes dans le Haut-Palatinat en 1986 (après Tchernobyl) «parlent» souvent autant que de grands événements avérés, lesquels ne donnent jamais lieu à un traitement marqué par une solennité particulière.
L’apparition des premiers camps de concentration se fait dans une espèce de normalité (les Jeux olympiques de 36 vus de Sachsenhausen…), qui en dit plus long sur ce qu’ils de-vinrent qu’aucune mise en accusation. Voilà ce que fut notre histoire, dit en somme Grass, qui a perçu dans sa chair tous les drames des populations en porte-à-faux sur les frontières nationales ou idéologiques, et défend la dignité d’une Allemagne humiliée et plongeant ensuite d’une abjection à l’autre, mais n’excluant aucune lutte d’Allemand de bonne foi. De la dénazification à la réunification, Grass ne fut-il pas de ceux qui auront le moins mal pensé la dignité de l’Allemagne ?


Bien plus que par l’explication, c’est par l’implication que l’écrivain nous fait ressentir le changement des mentalités d’une époque à l’autre, et les soucis, les hantises, les aspirations collectives ou les comportements de telle ou telle décennie dans telle ou telle catégorie de la population. De la première apparition (1922) d’un certain caporal Hitler réputé par sa façon de «parler aux masses comme personne» à l’époque (1996) du clonage des brebis jumelles Megan et Morag, nous revivons ainsi le siècle comme de l’intérieur d’une vaste foule dont beaucoup de visages nous diraient déjà «quelque chose». Proche des gens, l’écrivain excelle à rendre le langage de chacun en usant volontiers du dialogue ou de l’expression orale. Mêlant la fiction privée et la réalité «fixée» par l’historiographie médiatique (aïe !), Grass ne dilue pas pour autant ses récits dans le relativisme. Une vision profondément politique, à la façon d’un bon génie de la Cité, donne à Mon siècle sa cohérence vigoureuse. L’auteur lui-même apparaît au fil de plusieurs chapitres, comme un de nos frères humains. Nulle trace, au demeurant, de démagogie «humanitaire» dans ce livre foisonnant et passionnant qui fait, d’un siècle à l’heure allemande, une polyphonie de portée universelle.
JLK
Günter Grass, Mon siècle, traduit de l’allemand par Claude Porcell et Bernard Lortholary, Editions du Seuil, 343 p)
(Le Passe-Muraille, No 42, Juillet 1999)