L’Afrique au coeur d’Henri Lopes
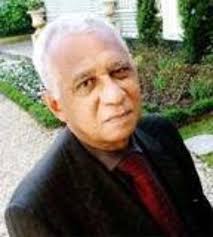
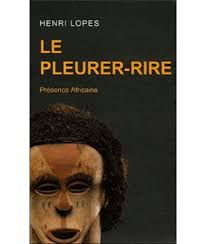
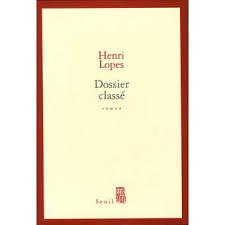
À propos de Dossier classé, avec des éléments d’entretien,
par JLK
Vingt ans après la parution du Pleurer-rire, qui fait aujourd’hui figure de classique de la littérature africaine contemporaine, Henri Lopes a publié, au début de l’année, un nouveau roman intitulé Dossier classé, d’une tout autre tonalité, à la fois plus retenu et plus sobre, qui marque une nouvelle étape, qu’on pourrait dire de la maturité pacifiée, dans une oeuvre sans cesse aux prises avec la réalité de l’Afrique ou du métissage.
Il y est question, plus précisément, de l’enquête à la fois journalistique et personnelle que Lazare Mayélé, fils d’un intellectuel en vue de la période de l’Indépendance, mais établi lui-même aux Etats-Unis avec sa femme américaine, mène pour une revue dans son pays d’origine, l’imaginaire Mossika. Sous ses dehors paisibles, ce roman vibre cependant aux échos d’un drame jamais élucidé, puisque le père de Lazare, Bossuet Mayélé, a été assassiné dans des circonstances restées obscures. Ponctuée de rencontres de plus en plus éclairantes, la quête de Lazare n’aboutit pas à l’élucidation complète du mystère, lequel caractérise en somme la période troublée où a disparu son père. Un sentiment de tendresse un peu mélancolique se développe au fil de son parcours, qui lui permet de renouer avec ses racines africaines alors même qu’il a choisi l’exil.
Lors d’une conversation récente avec Henri Lopes, à Paris où il a fonction d’ambassadeur du Congo-Brazzaville, l’écrivain nous a d’abord dit quel genre d’homme il était au moment de composer Le Pleurer-rire, entre 1977 et 1981, et comment il en est venu, lui qui était encore ministre en fonction, a se lancer dans une satire aussi virulente du pouvoir de plus en plus délirant et cruel d’un potentat africain.
«En 1977, j’avais exactement 40 ans et, derrière moi, déjà, pas mal d’aveuglement dissipé et d’illusions perdues, une foi marxiste battue en brèche et l’expérience du gouvernement et des gens de pouvoir qui m’a convaincu que la transformation de l’Afrique dépassait les options idéologiques en conflit, et jusqu’à la question de la direction —tenant à un problème de culture globale. On a souvent présenté Le Pleurer-rire comme une dénonciation de la dictature. C’est vrai. Mais il y a aussi autre chose qui est important là-dedans, que je ne dis pas explicitement, et c’est que toute dictature implique la complicité des peuples, et d’autant plus que le niveau culturel de la population est bas. Par exemple, on peut penser à Bokassa ou à Amin Dada en lisant ce livre mais je me suis rendu compte que, parmi les ministres de Bokassa se trouvaient de grands militants communistes du temps où nous étions étudiants. C’est facile de dire qu’ils ont été corrompus. Je ne crois pas qu’ils aient été corrompus par l’argent, mais plutôt qu’ils se trouvaient en accord avec une partie de leur société. A l’époque je pensais encore que l’écrivain a un rôle d’éducateur à jouer : d’où Le Pleurer-rire. Par ailleurs, j’ai tout de suite pensé qu’il fallait accentuer le côté bouffon et rocambolesque du sujet. Une constante que j’ai observée est que l’Afrique a survécu à toutes les tragédies non par des plaidoyers mais en trouvant un antidote dans la détente. Je pense par exemple que, si nous avons survécu à la traite, c’est grâce au chant. Aujourd’hui encore, face aux absurdités de certaines directions, y compris celles auxquelles j’ai participé, parce qu’il ne faut pas avoir honte de dire qu’on s’est trompé, l’Afrique se défend par le rire. À Brazzaville, il y avait un personnage qu’on surnommait Double, qui était constamment saoul. Or, une fois qu’il était ivre, il devenait Le Canard Enchaîné du Congo. Personne ne le touchait en dépit de la virulence de ses propos. Quand un Africain éclate de rire, souvent on ne sait pas si c’est parce qu’il se réjouit ou si c’est parce qu’il trouve la situation trop incroyablement tragique. De là le titre du Pleurer-rire...»
Métis par ses parents, Henri Lopes (dont le nom est d’origine zaïroise, et non portugaise) a introduit, dès Le chercheur d’Afriques (Seuil, 1990), le thème du métis dans son oeuvre, central dans Dossier classé.
« Le personnage de Bossuet Mayélé, le père du protagoniste, doit beaucoup à ma réflexion sur le travail de l’écrivain. Je crois que l’écriture est une mise à nu. Une mise à nu dangereuse, qui fragilise, mais qui est indispensable. Avec Bossuet, je vais au bout du thème du métis culturel, puisqu’il a une Afrique mythique dans la tête, alors que la réalité africaine lui fait peur. J’ai moi-même dû affronter et surmonter cette peur afin de retrouver en moi l’Afrique première, bridée par mon éducation européenne, mais qui revient. Or exprimer cette Afrique indicible tient, chez moi, de l’obsession. Dans Dossier classé, cependant, par delà l’image sur-faite d’une Afrique vouée à la seule oralité, j’ai voulu, dans une forme plus épurée, affirmer l’Afrique dans la maîtrise de soi. »
JLK
Henri Lopes, Dossier classé. Seuil, 2002, 251 pages.
