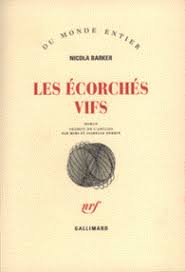La souillure et le pardon
À propos des Écorchés vifs de Nicola Barker,
par JLK
C’est un livre trouble et troublant que Les Ecorchés vifs de Nicola Barker, jeune romancière anglaise qui nous immerge au cœur des ténèbres contemporaines que hanterait une humanité dénaturée. Si les personnages du roman sont bel et bien des écorchés vifs, son titre original, Wide open, rend mieux la sensation vertigineuse qui se dégage de sa lecture, comme au bord d’une béance que figure le décor à la fois urbain et sauvage, entre déglingue et mer roulant sous un ciel plombé.
«Laissez toute espérance, vous qui entrez…» serait-on tenté d’inscrire au fronton de cet enfer onirique imposant son imagerie d’absolue déréliction où règne la confusion des sentiments et des identités, où toute innocence paraît vouée à la souillure avant que ne se manifeste, par une sorte d’obscur re-tournement, l’appel d’une lumière liée à la diffusion «physique» d’une tendresse compassionnelle à la Simenon et à l’invocation d’un pardon.
Cela commence sur un pont d’autoroute où deux hommes, tous deux prénommés Ronny, se rencontrent sans savoir qu’un lien secret les attache. Ronny I, intrigué par le manège de Ronny II, gesticulant sur un pont de l’A2 (direction Londres) à l’adresse des voitures blanches et jaunes, se déroute un jour que l’énergumène lui semble en voie de se jeter du pont, l’aborde et découvre qu’il a pleuré, qu’il est en train de souffrir à l’observation de l’agonie d’une guêpe.
Comme Ronny II porte le même prénom et les mêmes chaussures que Ronny I, ce-lui-ci se demande alors s’il ne s’est pas rencontré lui-même comme dans certaine pièce de Ionesco, puis apprend de Ronny II que le carton fermé qu’il traîne avec lui contient «son âme». Or tout, dès ce préambule à la fois hyperréaliste et lesté de mystère, va se développer comme un grand rêve éveillé mêlant l’émotion in-time et l’obscénité, et baignant dans une espèce de magma.
Tous les personnages de ce roman sont des enfants perdus, comme ces objets qui s’entassent et transitent dans le bureau des objets trouvés du métro de Londres où l’un d’entre eux est employé: Nathan, frère aîné de Ronny I et fils de feu le «grand Ron», figure maléfique dont l’ombre de grand méchant pédophile plane sur ses fils.
L’essentiel du roman se déroule sur le bord d’un chenal, en l’île de Sheppey où voisinent une plage de nudistes et une zone de bungalows préfabriqués, des dunes où se terrent des lapins noirs, une ferme et son élevage biologique de sangliers. Dans ce «coin désert», ce «paysage lunaire» évoquant les landes désolées de Beckett se retrouvent bientôt Ronny I et Ronny II. Du premier, l’on apprend dans la foulée qu’il a été mêlé à un crime, avant que Ronny II (Jim de son vrai nom, du genre squatter errant) ne s’installe chez lui après l’avoir baptisé Jim… Dans leur voisinage apparaissent en-suite Luke, qui se livre à d’étranges rituels photo-pornographiques en compagnie de Sara, dont la fille Lily, mal-aimée et convaincue que «la nature est un véritable tyran», se réfugie dans la vénération posthume d’une Tête de monstre animal, hybride de truie et de sanglier au corps en forme de mitaine…
Compliqué tout cela ? Bien plutôt: noyé en de mystérieuses ténèbres, et se dévoilant progressivement comme une trame de roman noir ou comme un drame à la Faulkner, à la fois très physique et nimbé de résonances métaphysiques. De fait, et à l’exclusion de toute explication factuelle univoque, le dénouement de ce roman renvoie le lecteur dans le «monde malade» dont il constitue la projection, tout en offrant une forme de paix à chacun des protagonistes. Au regard de surface, l’univers de Nicola Barker paraît absurde et désaxé. Or cette méditation incarnée sur le mal aboutit à une forme obscure de pitié et de pardon.
Qui sont ces personnages ? Que leur est-il arrivé au juste ? D’où viennent-ils et à quoi rime leur existence ? Tous, en l’occurrence, sont marqués par une forme de malédiction, à commencer par les deux Ronny, dont on pourrait parfois penser qu’ils ne forment qu’un personnage à deux faces. La figure inquiétante du père, violeur d’enfants, dépasse de loin les dimensions de l’anecdote pathologique pour devenir symbole mythique de non-filiation. Pour les «orphelins» de cette dramaturgie, la représentation de soi n’est pas moins problématique ou faussée, à commencer par l’image de son propre corps (que Sara photographie sous toutes ses coutures pour mieux se «révéler», croit-elle) ou de sa place dans la «dissociété» ambiante. Ajoutons à cela que les protagonistes, dont la vie sexuelle s’est diluée dans la confusion des sentiments et des sensations, mais surtout du langage, ont contaminé leur environnement. Voici naître des hybrides étranges, qu’on dirait le résultat de manipulations génétiques. Par contraste, la mort du sanglier descendu à l’arme à feu, tout au bord de la mer, fait figure de catastrophe naturelle.
Très curieusement cependant, de cet univers apparemment in-sensé et délétère se dégage une singulière énergie et une sombre beauté, avant qu’une réelle compassion n’oriente l’évolution des personnages, dominée par la figure du Christ d’Antonello de Messine dont le trouble érotico-douloureux qu’il dégage (l’un des personnages le présente comme venant de se masturber) devient ici le symbole d’une sorte de parfaite fluidité compassionnelle. Or ce n’est là qu’une des multiples intuitions incarnées de ce roman dérangeant et tranchant complètement sur le fond de platitude de la littérature au goût du jour, qu’on pourrait relier à la fois aux écrits d’une Flannery O’Connor, en plus trouble, ou aux romans plus récents d’un Timothy Findley.
J.-L. K.
Nicola Barker, Les Ecorchés vifs, traduit de l’anglais par Mimi et Isabelle Perrin. Gallimard, collection Du Monde entier, 429 pages.
(Le Passe-Muraille, Nos 43-44, Décembre 1999)