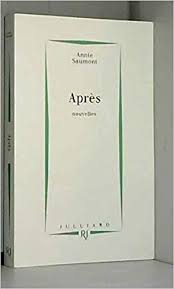États d’urgence
À propos des nouvelles d’Après, d’Annie Saumont,
par Claire Julier
«Je l’ai vue poser le chat sur l’herbe. Elle l’a regardé qui s’étirait qui ronronnait, pas méfiant, relax et superbe. Alors très vite elle est remontée dans la Ford, a claqué la portière et soufflé à mon père: Vas-y. Y a eu comme un grand silence. Avant que je me mette à hurler»…
Tout cogne et crie en eux. Et pourquoi «ils fissurent» ils ne savent pas expliquer. «Ce serait qu’ils ont un pouvoir de chagrin qui jusque-là était caché.» Alors si quelqu’un leur donne la parole, leurs phrases se précipitent. Ils se sont tellement contenus que maintenant les mots se bousculent, empiètent les uns sur les autres, mélangent les obsessions et les vacheries de la vie. Leur bouche enfin dé-cousue crie l’exclusion à cause de l’âge, du handicap, du quartier, de leur zéro en intelligence scolaire ou de leur zéro en conduite. Ils ne comprennent pas le manque d’argent chronique et la mère qui gémit parce que les enfants salissent tout et qu’il faut préparer des plats nourrissants et économiques, la mère qu’a le temps de rien faire parce qu’elle a trop à faire et le père qu’est pas là ou qui est au chômage ou qui boit pour oublier la guigne.
Ils ne comprennent pas tout le désordre de leur tête. Ce qu’ils veulent, c’est exister. Ils ne se tassent pas dans un coin; ils revendiquent leurs cités où tout se déglingue, les dimanches chez Auchan et les espaces mités qu’on appelle verts. Ils disent leur filouterie, leur aigreur, leur méchanceté. Mais, vaille que vaille, ils ont de l’amour à donner et cherchent à s’en faire éclater la tête et le cœur à qui ils pour-raient bien le donner, cet amour insolent.
Alors les vieux retraités en maison, les éclopés du cœur et de la société, les enfants grandis dans des lieux étriqués qu’on appelle de vie et qui n’en ont aucune, les jeunes en cabane et les haineux raciaux, à force d’appeler un rêve qui ne vient pas, ils ont dû se durcir et la haine est montée en eux.
Annie Saumont a l’œil d’un photographe de l’instant, mais elle ne prend pas des photos volées; ce sont des photos prises avec tout le respect auquel ils ont droit et qu’elle leur donne avec rudesse et amour. Elle ne juge pas. Elle devient simplement eux et dit dans l’urgence la trahison qu’on leur a faite, à un moment ou à un autre. Elle dit pour eux car ils ne savent pas aller au bout de leur douleur, ni effacer les marques d’une injustice.
Les recueils de nouvelles d’Annie Saumont ne ressemblent en rien à un reportage vu de l’extérieur, de ceux qu’on filme à heure fixe lorsque les banlieues deviennent chaudes ou lorsqu’elles relèvent d’un nouveau programme politique, ni à une fiction mélodramatique ou malsaine; ce sont des instants de vie vécus de l’intérieur, dans toute leur noirceur et leur logique parce que Après n’existe pas. Il n’y a que le présent et un cœur vide qui bute contre les murs parce qu’il n’a pas su se barder contre l’envie de demain. «Nous le dimanche on glande lugubre. Le dimanche a l’odeur d’ennui et l’odeur du poulet rôti-frites et celle du couscous-merguez qui sortent par les fenêtres.»
Dans un monde sourd, comme il est difficile de regarder ce qui nous concerne de près !
C. J.