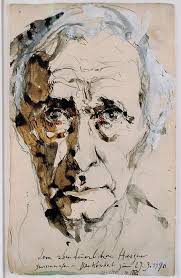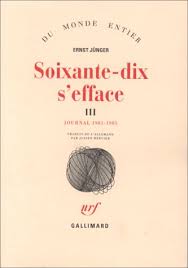Ernst Jünger en son durable malentendu
À propos du Journal, de la fin de l’Histoire et du Temps qui passe,
par Christophe Calame
Le temps se moque de Jünger: l’homme qui, plus que tout autre, a douté de l’Histoire, est maintenant centenaire. Mais la vie de l’auteur n’est pas celle des livres. La petite chapelle des inconditionnels, parmi lesquels je me range résolument depuis l’adolescence, n’est pas parvenue à dissiper les malentendus qui, osons le dire, ne sont peut-être que l’écho des provocations de l’auteur.
Lors d’une émission récente, l’on demandait à Jünger s’il pensait avoir eu de l’influence sur les nazis avec l’essai sur le Travailleur (enfin traduit en français). L’auteur éclatait de rire en répondant qu’un livre qui n’était toujours pas compris en 1997 ne pouvait guère l’avoir été en 1937 !
C’est que Jünger, malgré sa passion des événements, pense non seulement que l’Histoire est finie, mais aussi que la grande révolte de la Nature commence, et que notre époque est d’essence titanesque. C’est là une position extrêmement solitaire: les hégéliens américains, généralement libéraux, ne sont pas près de voir dans la «fin de l’Histoire» autre chose que l’assomption des valeurs bourgeoises, et les écologistes se figurent que la Nature est faible et demandent leur aide pour résister à la Technique.
Or Jünger, précisément, pense que rien n’est plus naturel que la Technique et que le déchaînement universel des chantiers, sans parler des moyens de communication et de transport, ouvre une ère dans laquelle ne peut trouver place l’Histoire humaine, symbolisée par la statue de bronze sur la place publique. Ce réveil des puissances de la Terre pourrait bien la débarrasser même de l’homme, apprenti sorcier armé de la foudre atomique pour sa perte.
Tout désigne donc Jünger à la suspicion, et la fonction exclusivement correctrice des valeurs publiques en cette fin de siècle ne favorise guère le débat. L’hypermoralisme contemporain ne veut tenir compte que du point de vue des victimes. Comment passer pour une victime lorsqu’on a été un officier allemand décoré, un auteur toujours primé et fêté (ce qui, malheureusement, ne suppose pas la lecture), un retraité paisible, amateur de croisières méditerranéennes et de voyages tropicaux, collectionneur de coléoptères et de papillons ?
Le malentendu est donc presque inévitable: un homme qui ne se plaint de rien ne semble pas devoir être entendu par le tribunal de l’opinion, ou plutôt par cet aréopage frivole et avide de malheur qu’est devenu le public. Le journal de l’auteur s’étonne à chaque page de cette solitude, toujours sereinement vécue, et manifeste plus que jamais cette curiosité pour les destinées et les moindres signaux des contemporains.
La traduction de ce journal, qui maintenant excède d’ailleurs son titre (Siebzig verweht: Soixante-dix s’efface), en arrive aux années 1981-5. La lecture des journaux, intimes ou non, procure toujours une incomparable proximité avec l’auteur, presque celle même qui définissait l’amitié dans l’Antiquité: la vie commune. Il y a le moindre apprêt de l’écriture quotidienne, mais aussi toutes les petites remarques apparemment anodines, qui font tout le sel et la drôlerie des gens intelligents. Je cite (presque) au hasard: «Une société de gens beaux produit encore plus que toute autre l’impression d’un troupeau» (10 juin 1982).
Ch. C.