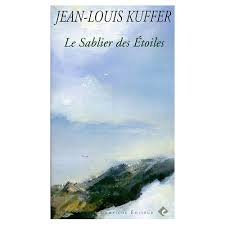Confessions fuguées
À propos du Sablier des étoiles de JLK,
par Philippe Thirard
Il n’y a rien de tel que de travailler dans les journaux pour se guérir des faux-semblants et de la comédie du paraître. Au cœur d’une rédaction, la vie entière déboule sur votre bureau dans le splendide fracas aléatoire de ses contradictions et il n’est d’affirmation, d’idée ou de fait qui ne se trouvent contrecarrés dans l’instant qui suit leur apparition. Cela peut donner du vertige et de la lucidité. A l’évidence, Jean-Louis Kuffer a du penchant naturel pour l’un et l’autre. Et avec cela un prurit d’écriture qui n’a rien d’affecté: sa plume trempe directement dans l’encre vive de son âme – de son «esprit tordu» comme dirait sa tante dure – dont elle répand le ruissellement tantôt lumineux tantôt sombre.
Quittant (provisoirement?) le roman, il ne revient pas pour autant au récit à proprement parler. Sous-titré «fugues helvètes», son Sablier des étoiles ressortit bien aux deux définitions de ce mot sans doute trop oublié des écrivains d’aujourd’hui. Ces trente-trois fragments d’une vie intérieure se suivent, se répondent dans leurs dissemblances, «fuient» l’un devant l’autre, évoquant en effet l’échappement du temps dans le sablier du métabolisme mental. Une «petite musique» s’en dégage qui hante le souvenir après la lecture. Pourtant, ce sont des considérations bien personnelles auxquelles donne voix Jean-Louis Kuffer, issues des strates d’une mémoire qui plonge parfois très profond dans sa propre existence. Avec cet humour acide qui le caractérise, il met toutefois en boîte par avance les psychanalystes rentrés qui voudraient faire de l’exégèse psychologique à bon compte.
D’enfance et même de petite enfance, il est souvent question, par exemple à travers un grand-père (Grossvater) dont la figure se mêle étrangement à celle de Robert Walser, JLK rendant hommage à toutes ses filiations, familiales, spirituelles et littéraires, dans la même effusion contrôlée du souvenir. Enfance, oui, mais surtout esprit d’enfance. Plusieurs de ces «nouvelles» convient le lecteur à une sorte de traversée des apparences vers le pays enchanté d’avant la constitution de l’ego, contrée qui ne va pas sans rappeler l’univers et la logique trouée de fantaisie du Wonderland cher à Lewis Carroll. Et, dans son pays rêvé de l’autre côté du miroir, le réel et l’imaginaire, la poésie et la vitupération, la fureur et l’attendrissement, le futile et le grave dansent un grand ballet de phrases tantôt courtes tantôt longues (l’«Eté 1968» se déroule en trois pages que ne ponctue aucun point sauf le final) où s’exprime sans fausse pudeur la pure joie d’écrire: «A un moment donné, plus rien ne compte qu’un certain bonheur de phrase.»
Il se bat, l’auteur du Sablier des étoiles: contre la «grande machine à oublier» qui «parfaitement silencieuse, s’active», contre l’indifférence (comme dans «La Faute à pas de chance»), le conformisme (voyez «Littérature»), les fantômes nés du refoulement (dans les superbes «Ombres transies»), les lieux communs (partout), mais aussi contre lui-même («Rendez-moi mes jouets»). Il court à travers ce livre inspiré une sorte d’adieu aux refus catégoriques et aux certitudes furieuses de la jeunesse, comme si l’écrivain acceptait que le combat de la vie est autre, est ailleurs que dans un affrontement frontal entre soi et le reste de l’univers. «Tant de saveurs ignorées par blasement d’époque!», constate-t-il en s’adonnant à la littérale jouissance que lui procurent les gestes de cultiver son jardin. «Mais n’est-ce pas le propre de cette fin de siècle au jouir sommaire et au savoir vague, qui prétend avoir fait le tour de tout et s’en ankylose de mélancolie alors que tout reste à goûter, bonnement offert sur un plat?» C’est dire si la pose pessimiste n’est pas de mise ici.
Le vertige n’empêche pas la lucidité, comme nous le disions plus haut. Si la fugue est fuite éphémère, c’est pour prendre quelque distance et mieux regarder le réel. Un grand chagrin sous-tend cette jubilation d’un homme pour qui, toute mélancolie bue, «Il n’y a à faire que faire», définition première, étymologique, de l’activité du poëte, comme l’orthographiait Claudel pour souligner la dimension créatrice du mot. «Ce soir y a plein d’étoiles, y a plein d’amis défuntés qui vous zyeutent par les hublots du grand paquebot aux abeilles…» Et cette peine et cette résolution s’accompagnent d’un élan empathique, d’une compassion où le sentiment ne cède jamais à la sentimentalité. Ainsi quand il évoque, avec une poignante simplicité, ceux qui n’ont pas été conviés au festin des battants souverains dans notre société d’abondance, «ceux qui n’ont plus nulle part où aller».
La vie quotidienne aussi pénètre «le cercle enchanté de la lampe» où, à l’instar de Bachelard dans l’intimité de la chandelle, Jean-Louis Kuffer aime à confier aux aurores ses épanchements: émois de père face aux métamorphoses adolescentes de ses filles, amant de cœur alignant toutes les déclinaisons de son amour, voire ces troublants et ironiques «Rêves érotiques». Confessions? Peut-être, mais alors transmutées par l’alchimie d’un regard sensible et aigu sur les expériences qui ont traversé leur auteur et dont il nous restitue la quintessence sans nous embarrasser du vil plomb de l’anecdote. Il y a de l’esprit d’un Montaigne dans son honnêteté passionnée… Que la plupart de ces textes semblent avoir été écrits dans une maison qui s’appelle La Désirade n’a sans doute rien d’innocent. Cette belle enseigne a accouché d’un beau livre.
Ph. T