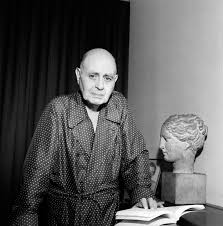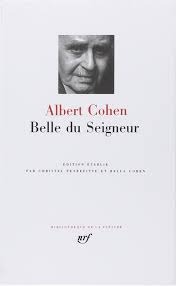Cathédrale baroque de l’amour
À propos de Belle du Seigneur,
par Jean Romain
L’achevé d’imprimer de Belle du Seigneur date du 15 mai 1968. Au même moment, à Paris, quelques galopins aux cheveux longs allaient peindre en noir sur les toits de la Sorbonne le drapeau tricolore en promettant que sous les pavés on devrait en toute logique découvrir la plage, tan-dis qu’à Prague, les Soviets son-geaient à normaliser, tanks à l’appui, un printemps devenu trop prometteur pour l’idéologie marxiste. On croyait à la révolution permanente, on chantait l’amour libre, on s’embrassait sur les barricades, on manifestait tantôt en remontant tantôt en descendant les Champs-Elysées, et les théoriciens du nouveau roman étaient déjà confortable-ment installés dans leur entreprise de faire bâiller le lecteur. En même temps que le roman, on voulait inventer l’homme nouveau: depuis 1963, Pour un nouveau roman de Robbe-Grillet s’employait à grand renfort de concepts à démontrer qu’une nouvelle relation entre l’homme et le monde était en train de s’établir sur le mode de l’objectivité.
Or, à contre-courant et assez traditionnellement, voici qu’Albert Cohen (il a 73 ans) donne Belle du Seigneur. Il s’agit d’un volumineux roman d’amour (845 pages), de l’amour et de sa dénonciation, entre Solal, sous-secrétaire général de la Société des Nations et Ariane, épouse du médiocre Adrien dont l’ambition est d’être nommé membre A de ladite Société.
Un roman foisonnant, touffu, une cathédrale baroque, un chef-d’oeuvre d’inventions langagières, de drôleries, de pitreries, de tragique idéalisme, d’insolites façons de voir les choses les plus banales, de sensualité perverse, de passion et de pessimisme, un roman poignant aussi, qui met face à face un homme (le Seigneur) et une femme (la Belle), l’homme et la femme tels qu’ils auraient pu apparaître au premier matin du monde, alors que rien n’était encore joué. Mais, et c’est là que chacun est piégé, tout est joué. Autour des deux amants gravitent de nombreux personnages secondaires qui illustrent à leur façon, ici la vanité, là la mondanité imbécile, plus loin l’ambition vide de sens, juste à côté la bêtise de la compétition sociale, partout le désir de paraître. Autant de vices auxquels les deux héros, parce qu’ils visent à un amour dégagé de tout ce qui est trivial, entendent échapper mais vers lesquels ils sont sans cesse ramenés. Le roman progresse selon trois logiques: les trois cent cinquante premières pages décrivent les inventions que Solal trouve pour séduire Ariane et la cueillir «les yeux frits»; cinquante pages, ensuite, sont consacrées à l’amour absolu et pur que le couple a tant recherché; toute la fin est une interminable scène de ménage qui se clôt sur le constat que la vie à deux est infernale.
L’enfer pour Cohen, ce n’est pas les autres, mais c’est l’autre qu’on idolâtre. La vie infernale, c’est celle de la passion amoureuse lorsqu’elle est tellement travaillée qu’elle ne permet plus aucun souffle d’air frais. Car c’est bien d’un huis-clos qu’il s’agit. Solal et Ariane, deux êtres à la fois intelligents et sots, ne parviennent pas à se hisser à la hauteur de leurs rêves parce qu’ils rêvent d’un amour immaculé qui répudierait tout ce qui n’est pas pureté. L’amour comme une oeuvre d’art, le face à face absolu, le triomphe de la pureté dans l’excès de la passion, autant de pièges dans lesquels donnent les amants, autant de terrains vagues où rôde la mort (thème obsessionnel de toute l’oeuvre). C’est ce monde dense et multiple qu’Albert Cohen crée impitoyablement.
N’allez surtout pas croire que Belle du Seigneur illustre de manière un peu navrante la thèse selon laquelle le temps passe, et que la passion ne résiste pas à ce passage dévastateur. Il ne s’agit pas d’opposer les jeunes amants aux vieux. Ici, la passion ne s’inscrit pas dans le temps, mais elle représente un type de rapport à la temporalité. Le texte ne s’attarde pas dans les méandres de la durée négative: il bondit, il se hâte du début à la fin, d’où ces phrases elliptiques, sans cesse hors d’haleine, s’impatientant d’un verbe qu’elles ne veulent pas trouver, ou soudain débordantes de verbes jusqu’à satiété. Les choses arrivent, et l’esprit les voit arriver selon un ordre que la passion amoureuse force à ne pas s’éterniser, c’est presque un ordre synchronique. Le pré-sent est donc le temps essentiel du roman (même s’il est écrit au passé le plus souvent) parce que, dans la passion, seul le présent importe. Dans la passion, ce n’est qu’à ce qui est présent que l’esprit adhère. Quelle que soit la longueur du livre, la passion est réduite à ce qu’elle est dans le moment même, tout est joué dès l’entrée, et le tort des protagonistes est de s’aveugler au sujet d’un avenir sur lequel le présent n’a aucun débouché ni aucune efficacité. En revanche, ce qui surprend le lecteur, c’est que le monde de Cohen ne réussit pas à tenir dans une coquille de noix, il a besoin d’un espace énorme (845 pages). Ce qui rend le tour de force baroque c’est qu’un univers aussi exigu que celui des mondains de la Société des Nations d’avant la seconde guerre mondiale occupe un espace si vaste.
La jalousie est, dans l’amour, la mort à l’oeuvre. Albert Cohen, comme d’autres et peut-être mieux que d’autres, a puissamment mis en relief le motif de la jalousie qui tarit les sources mêmes de la passion. Toute passion est sans fenêtre et sans avenir. L’homme n’échappe pas à la douleur d’être, il n’est pas en sa puissance de s’en libérer. Prisonnier des balivernes sociales, lorsqu’il croit les fuir en s’enfermant dans la passion, il y découvre la puissance de la jalousie. Tous les instants sont minés de l’intérieur et c’est pourquoi tous les instants sont décisifs, eux-mêmes sans durée. Mais pas plus que le futur n’est un effet du présent, la jalousie n’est un effet de la passion. L’homme universel est jaloux parce qu’il n’est pas généreux, parce qu’il n’est pas capable de renonce-ment, et l’amour se désagrège en même temps qu’il apparaît. D’où ce cri: «O vous, frères humains, connaissez la joie de ne pas haïr.»’ On ne peut pas dire adieu à ce qu’on a cessé d’être car, puisqu’il n’y a pas de temps qui passe, puisqu’on est dans le monde intemporel de l’attente, on est toujours le même dans l’univers de Cohen. Chacun est captif de sa propre mythologie et, quoiqu’il le veuille, n’en sort pas. Chacun est seul. A qui s’en désolerait, l’oeuvre propose soit la bouffonnerie, soit la mort, au choix. Peut-être est-ce après tout la même démarche. Mais qu’on est loin ici des pessimismes habituels! Le livre n’est pas effrayant. Il rassure: il renvoie le lecteur à son propre monologue, celui qui lui est le plut intime, le monologue que chacun poursuit avec sa propre mort. Ainsi des amours «sublimes» de Solal et d’Ariane: deux soliloques qui ne partagent rien à part, constante, la certitude de leurs deux désespoirs. Et les voilà tous deux punis pour leur même imposture.
Car punition il y a. Les excès de l’ amour-propre leur ont fait oublier l’identité du vrai Seigneur, celui dont parle la Bible. Dans l’oubli du Seigneur, l’amour n’est plus qu’une faute. Si d’emblée ils ont eu l’impression de pouvoir s’aimer sans Lui, c’est qu’ils ont trahi les valeurs les plus profondes de leur culture. Leur amour n’est qu’une farce tragique, splendide et pitoyable, dont ils sortiront en se donnant la mort. Le juif Solal a voulu échapper à sa condition d’homme déraciné. Toute l’histoire si difficile du peuple Juif a été celle d’une quête de l’amour. Solal n’y coupe pas. Il est devenu le Seigneur de la Société des Nations; aimé et adulé, porté au pinacle, voilà qu’il était justifié, il avait sa raison d’être. Mais il n’était Seigneur que pour Ariane que pour le petit peuple diplomatique du Palais de Genève. Sa vanité l’a aveuglé autant que l’amour d’Ariane.
On n’échappe pas à ce qu’on est, on ne peut pas prendre congé de soi-même. Toute la famille céphalonienne (haute en couleur et plus ou moins loufoque) autour de Solal est là pour le lui rappeler.
J. R.
Albert Cohen, Ô vous, frères humains, Gallimard, 1972.