Au fer rouge de la mémoire
À propos d’En lui quelque chose de l’Algérie, de Viviane Campomar.
par Francis Vladimir
La blessure de guerre pour roman, d’une guerre qui ne dit jamais son nom, travestie en opérations de pacification. Une guerre niée puis occultée par les autorités, la bien-pensance de l’époque, et par ceux qui, consentants ou forcés, furent envoyés sur le terrain. De l’Algérie, on a dit l’histoire de la colonisation, civilisation pour les uns, joug pour les autres. Les uns ce furent les Français qui s’y étaient installés et qui, pour la plus grande majorité d’entre eux, partageaient un quotidien chaleureux, un voisinage partagé avec les autres, les ressortissants, les natifs du pays. Ce qui fait la chair du roman de Viviane Campomar, c’est un effluve, un parfum, une senteur de l’autre rive de la Méditerranée, échappés d’une mémoire recroquevillée sur elle-même.
Celle de Joseph Stopek, descendant d’un hongrois, passé par Malte, qui gagnera sa nationalité française. De ces événements à vif pour ceux qui les traversèrent, la conduite d’opérations éprouvantes, traumatisantes, demandée aux soldats du contingent envoyés pour un interminable service militaire, ou les épreuves sans fin des populations, il n’est évoqué que le silence, le non-dit balbutié, la sidération secrète de celui qui, après s’être formé à la médecine en métropole, où il débarque en 1949, reviendra sur sa terre natale pour s’acquitter de son devoir d’un côté mais affronter ses propres congénères, de l’autre.
De cette trajectoire meurtrie au fer rouge, l’auteur ne jette dans son roman que quelques notes comme si l’explicitation eût surligné à tort l’évidence de la catastrophe. Pour aborder à l’indicible, il fallait déjouer, dévier, décaler pour que le narrateur et le lecteur puissent faire du roman une lecture apaisée. Car l’histoire refoulée commence un 08 mai 1945 à Sétif « Et les massacres ? Les massacres de Sétif et les milliers de morts juste pour quelques drapeaux un peu trop verts brandis pour communier dans la victoire, cette victoire à laquelle tous avaient participé… » Rappel nécessaire. En déstructurant l’histoire de Joseph qui ne retient de la guerre, pour l’essentiel, que la seconde, celle 1939-1945, qu’il connut enfant et jeune adolescent, la romancière s’applique à lever le lièvre de l’impossibilité d’affronter la réalité suivante, cette autre guerre qui fut celle d’Algérie. Elle déplace – dit prosaïquement- le curseur du récit, focalisant notre intérêt sur les liens de Joseph Stopek avec sa fille Valérie.
De la toute petite enfance de celle-ci, marquée par une mère absente, retirée de ses obligations de mère, froide, sans chaleur à son égard, dénuée de tout intérêt et compassion pour l’histoire de déracinement et d’éloignement de son propre époux, médecin à Clermont-Ferrand, en des années où la notabilité égoïste engonçait dans une respectabilité revendiquée. Avec ce lien père-fille, le roman avance sur un fil d’équilibriste. Celui d’un père, pied-noir, s’effaçant, se voilant la face, par peur inavouée des démons et fantômes, confronté aux heurts des événements, face aux interrogations à fleur de lèvres de sa fille, qui naissent des livres sur l’histoire de l’Algérie trouvés à la bibliothèque municipale. « Valérie encaisse. La crudité des phrases trop construites lacère le monde baigné de miel de son père. Il lui faut se rendre à l’évidence, Roger Stopek ne lui a servi qu’un gruyère chronologique. Lui pourtant si droit, si intransigeant. Avec ses mots minables qui morcelaient l’Histoire, ses stratégies de contournement désolantes. La tenait-il pour demeurée, pour ne lui émietter que les reliefs de sa vie ? » Incapacité pour le père de dire, découverte tardive et muette, pour la fille, de cette période.
C’est à ce fil d’Ariane que Viviane Campomar s’attache dévidant la douleur cachée pour les chers disparus qui peuplent la première partie du livre, et celle de l’arrachement volontaire à un pays, sans retour possible, à une terre de soleil, de mer et de ciel bleus, de migration. Comme celle des oiseaux que la passion ornithologique de Joseph nous rend familiers dans des pages d’une sensibilité douce, à la grâce légère. Valérie grandit sous nos yeux de lecteur. Elle grandit encontre et se transforme à vue ou plus loin, du côté de Bordeaux où elle fait ses études. L’éloignement apparent qu’elle met entre elle et Joseph n’est jamais qu’une nécessité pour retrouver et s’inventer son père, s’apaiser elle-même.
De sa propre bouche elle ne pourra entendre sa vraie histoire – sa fuite en avant, ses manies cachées, son malaise constant – biaisée en cela par la mort soudaine de Joseph et l’attitude soupçonneuse de sa mère. Le deuil convoque alors les contradictions de l’enfance, du départ et du retour, de l’abandon définitif du pays, des liens familiaux, de l’amour paternel, des correspondances et du cahier secret, de la dernière lettre, mettant à nu la blessure et soulevant un coin du voile. De cet oubli dans les mots tus, où la banalité s’impose, reste cependant à Valérie, la fille profondément aimée, la transmission enfin consentie, le legs d’une existence, la rencontre fugace d’un père et de sa fille, la présence obstinée de la nature. « Un héron cendré… L’instant s’était figé dans ce sortilège. Valérie et son père suspendus à cette beauté pure, avaient baissé leur garde. Plus rien n’existait que cette somptuosité naturelle, plus de divergences plus de désordres plus de chagrins. Cette chance qu’il fallait saisir, cette connivence inattendue dans ce souffle de grâce. Le héron s’envola dans un froissement intime. Quelque chose de l’Algérie voltigeait désormais en eux.» La révélation de la vie.
Francis Vladimir
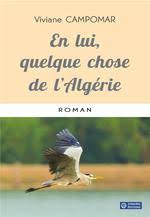
Viviane Campomar, En lui, quelque chose de l’Algérie. Zonaires Éditions, 2022, 145p.

