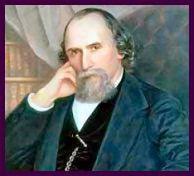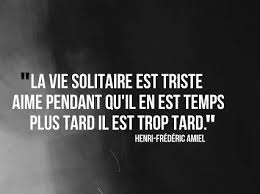Amiel en âme et conscience
À propos du Xe volume du Journal intime,
par Gérard Joulié
À mesure que l’on tire de l’ombre le contenu des 174 cahiers noircis par Amiel, représentant quelque 16.900 pages, on voit plus claire-ment l’ampleur et l’importance de cette figure de grand psychologue qui tient, d’une part, de Maine de Biran, et qui d’autre part semble annoncer Proust. En même temps Amiel est dans l’histoire littéraire romande une manière de père fondateur à la fois omniprésent et refoulé, qui a su exprimer en for-mules saisissantes les aspirations obscures autant que les idées imprécises de son milieu. L’une des originalités d’Amiel, outre l’imprégnation protestante qu’on pourrait croire indélébile en Suisse française, aura été de tirer toute sa philosophie, non d’une série de déductions logiques s’enchaînant fatalement, ou d’une conception générale du monde basée sur un a priori, mais de subordonner sa métaphysique à l’étude de soi-même et de tout faire découler de la connaissance du moi. C’est de surcroît par Amiel que l’inconscient est entré, pour la première fois peut-être, dans le domaine de la psychologie. On lui doit aussi d’avoir inauguré l’examen des problèmes religieux, non du point de vue théologique ou exégétique mais en se plaçant sur le terrain de l’expérience intérieure. Enfin le Journal intime représente un des plus riches trésors sur la vie de l’esprit et les mouvements du coeur, la pensée européenne à la fin du siècle passé et la société genevoise dont Amiel s’est fait le chroniqueur, les innombrables paysages qu’il aquarelle à la mode du temps ou les portraits de femmes que ses sempiternelles tergiversations en matière de projets conjugaux l’inclinent à multiplier pour l’examen. Ainsi, en 1852, envisage-t-il 50 possibilités de convoler, et 80 en 1857, dont la plus parfaite se trouve ruinée du seul fait que l’intéressée traîne derrière elle trois ou quatre parents qui disconviennent au pusillanime…

Quarante ans de sa vie Amiel s’est donc voué à cette tâche de prendre des notes sur lui-même, au prix d’un effort tenace, patient et tel que, si lamentable qu’Amiel paraisse à ses propres yeux, jamais il n’éprouve de lassitude à le dire et de jouissance à l’écrire, car il faut souligner aussi les constants bonheurs d’écriture du styliste. Appelant l’attention sur un aspect du Journal intime que l’on avait jusque-là négligé, Matthew Arnold a prétendu que la véritable vocation d’Amiel lui semblait avoir été celle de critique littéraire, comme l’attestent maintes pages de ce dixième volume de l’édition complète. Je ne puis citer qu’un de ses jugements porté sur les Mémoires de Mlle Delaunay: «Mille impressions au passage, sur elle, son milieu, son époque: sécheresse, netteté, précision du style; uniformité de la phrase courte et sans inversion, extrêmement fatigante à lire haut; pas une description des choses ni des gens, c’est nu et abstrait comme le vestibule où se déroulent les tragédies; pas une métaphore, sauf celles de géométrie. Il n’existe pour l’esprit que la société c’est-à-dire la cour et le cou-vent, ou la Bastille, avec des caractères qui s’observent, des vanités qui se servent ou se des-servent, des intelligences qui se jugent. Mais ce qui est délicieux, c’est la politesse et la finesse du langage, le délié de la pensée, la légèreté et la sûreté du trait, l’art des nuances, le sentiment de l’imperceptible, la sagacité psychologique, le besoin de se rendre compte et de voir vrai. Il est curieux, de suivre cette malice que rien n’abuse, sous le décorum des convenances et sous les révérences à demi prosternées. Cela rappelle la Chine: le coup d’oeil perçant et désabusé du bon sens se vengeant de l’esclavage officiel d’une minutieuse étiquette, Mlle Delaunay fait comprendre La Rochefoucauld et Saint-Simon, elle est une demi-soeur de La Bruyère dont elle ne parle pas. Mais à tout prendre, ce petit tableau de 1710 à 1730 justifie sans le savoir 1789. Le fétichisme envers l’ancien régime ne se conçoit que chez les êtres frivoles, qui n’ont pas même la notion de la justice et de la dignité humaines, et trouvent que pour obtenir les quelques fleurs de Versailles et de Sceaux, une nation entière peut servir de fumier». Et ce genre de plaisir nous est livré à tout moment dans le Journal intime, car cet homme à la véritable nature de Protée ondoyant ne devait jamais cesser d’être ê la fois un critique et un poète, si médiocres que fussent à vrai dire ses vers. Mais quelle formule digne d’un Shelley que celle qui lui vient en cheminant: «ce petit sentier, royaume du vert»…
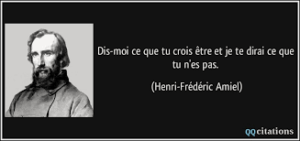
Quant à la pensée d’Amiel, un texte de 1874 nous place à l’endroit favorable pour en découvrir le caractère et la faiblesse: «Le penseur est au philosophe ce que le dilettante est à l’artiste. Il joue avec la pensée et lui fait produire une foule de jolies choses de détail, mais il s’inquiète des vérités plus que de la vérité, et l’essentiel de la pensée, sa conséquence, son unité lui échappe». Des vérités à la Vérité, il importe que le passage s’accomplisse. Or la clé du drame intime d’Amiel me paraît résider en ceci que ce passage des vérités à la Vérité, il n’a jamais voulu l’accomplir. Debout au bord de la rive, il laisse chaque fois le bac s’éloigner; un enchantement le cloue au sol; il ne peut s’embarquer, ni même s’écarter du rivage; il semble qu’il guette toujours en messager invisible. Des écrivains protestants de ce siècle, tels qu’André Gide, montrent la même passion du vagabondage. «Il y a si longtemps que je vis dans le pensée d’autrui», soupire-t-il. Ce pouvoir lui est donné, de comprendre toute doc-trine, d’en faire le tour, d’y pénétrer, de s’abandonner à une paralysante sympathie. Prestiges, enchantements contre quoi demeure sans pouvoir sa religion du libre examen. Il croit muser sur mille routes, mais toutes mènent l’imprudent voyageur aux bords sombres de l’Océan bouddhique. La religion d’Amiel qui le livre désarmé aux philosophes ne lui fournit des armes que contre le catholicisme. Or il perd le privilège de son aiguë clairvoyance dès qu’il s’agit de Rome. «Immobilité, vasselage des consciences, vaine pompe, religion extérieure», ces mots lui reviennent sans cesse à propos de la «pieuvre catholique» dont il stigmatise les «lanières à pustules», comme s’il n’avait jamais rien su d’un saint Bernard de Clairvaux ou d’une Thérèse d’Avila, ni des milliers de saints qui ont élargi jusqu’à l’infini les limites du royaume intérieur.
Partagé entre le biblicisme impératif du calvinisme que la nouvelle école critique lui dénonce comme insoutenable, et le libre examen dont nous voyons qu’il ne peut qu’abuser, persuadé que nous sommes entre les mains d’un Dieu inaccessible qu’il incline à confondre avec l’univers, Amiel n’a plus d’autre issue qu’un calme désespoir et ce passe-temps d’un journal où il se regarde souffrir.
G.J.
Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, tome X, années 1874 à 1877. Editions L’Age d’Homme, 1234 pages.