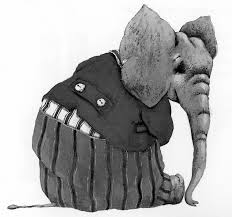Lettre à Robert Walser
Une missive inédite de Jacques Roman

Cher Monsieur Walser,
V0us l’avouerais-je ? Je ne sais par quelle bizarrerie de l’esprit, entendant prononcer votre nom, longtemps j’ai douté de votre existence ; je veux dire par là que votre nom m’était de légende. Relisant il y a quelques jours ces lignes tracées de votre main visiblement à mon adresse, par quelle autre bizarrerie de l’esprit, fermant les yeux, je vous ai parfaitement reconnu sur les bancs de l’Institut Benjamenta où je fus moi-même élève, et ce m’est joie quoique vos mots lus et relus m’aient plongé une fois encore dans une sorte non d’abattement mais de mélancolique compassion qui très vite m’enfiévra à ce point qu’il me fallut trouver remède. J’en suis là, la plume en main. Il me serait pénible d’avoir l’indélicatesse de vous parler de votre gloire et plus pénible encore sous prétexte de chasser une douleur qui n’appartient qu’à moi de toute sa banalité de juger de vos lignes. Mais votre envoi est là devant moi, sauvage comme je vais et comme vous le dites ..
Être sauvage, c’est toujours être à moitié fou.
Permettez qu’à mon poste, humblement, je vous adresse ces quelques lignes reprenant les termes de votre envoi tandis que:
Depuis quelque temps, le monde tourne autour de l’argent et non plus de l’histoire.
Mais auparavant, une nouvelle que vous accueillerez j’en suis certain avec ce même sourire aux lèvres qui était celui de notre camarade Kraus : l’Institut Benjamenta n’a pas fermé ses portes. Certes, il n’a plus de direction puisque, au désert, ensemble, je me souviens, M. Benjamenta et vous êtes partis. Une autre Lise a pris la place de celle qui dans la salle de classe envahie par le crépuscule gisait inanimée par terre. Devant sa dépouille…
Je me trouvais même bon et beau, quelque vanité qu’il y ait à le dire. J’entendais le murmure très léger de mélodies venant de je ne sais où.
disiez-vous, et
Que nous as-tu enseigné chère morte? Tu disais : un chant est une prière.
A l’Institut encore aujourd’hui:
On n’apprend absolument rien. Et puis : A quoi servent à un homme des idées et une pensée quand il a, comme moi, le sentiment de ne savoir qu’en faire?
Vous souvenez-vous comme nous rêvions de pénétrer un jour dans les appartements privés de M. Benjamenta ? Qu’y verrions-nous ? Vous répondiez:
Peut-être rien d’extraordinaire? Oh si, si, je le sais, il y a des choses merveilleuses quelque part dans cette maison.
Vous m’écrivez ces mots qu bien sûr me troublent plus que je ne saurais le dire et qu’à mon tour je vais expédier à quelques-uns de nos amis, car nous en avons, cher Robert Walser:
Un homme peut être aussi fou et ignorant que l’on voudra: s’il sait s’adapter, se plier et se remuer un peu, il n’est pas encore perdu, il fera son chemin dans la vie mieux peut-être que le malin bourré de savoir. L’art et la manière: oui, oui…
Mon trouble me vient voyez-vous des livres car il y a les livres… les livres qui trop souvent je m’en rends compte me font oublier l’état des lieux:
… un prétendu progrès de la terre, mais ce n’est là qu’un des nombreux mensonges que répandent les faiseurs d’affaires, afin de pouvoir pressurer la masse d’autant plus effrontément et avec moins d’égards. La masse est l’esclave de notre temps, et l’individu l’esclave de la grandiose idée collective. Il n’y a plus rien de beau ni de parfait
Cher Robert, comment avez-vous pu garder en vous, furieusement incestueux, votre désir de famille, écrivant non comme on claque les portes mais les ouvrant et, presque aussitôt, les refermant en silence. Combien de fois avez-vous collé votre oreille au trou de la serrure, toujours n’y entendant qu’un silence de mort qui invariablement vous ramenait à la contemplation de la photo de maman que jai toujours soigneusement conservée. Oui, la photo de cette mère qu’une nuit en rêve vous aviez frappée au visage, que vous aviez jetée à terre, la tirant par ses cheveux respectables. Est-ce de la mort que vous attendiez l’amour ? puisque avec le défi vous en aviez fini depuis long-temps:
Le défi m’a passé depuis longtemps.
L’argent. Ah ! l’argent ! Certes il nous fait défaut et si nous en avions nous ne voudrions nullement faire le tour de la terre. Rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui vous attire. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Ou plutôt si, si, un valet : Kraus, cet autre vous-même — très digne. Et puis l’argent oui, a coup do; l’argent devrait être employé d’une façon affolante, car seul l’argent gaspillé serait — aurait été beau. (Êtes-vous suisse Robert Walser?)
Walser à Herisau, était-ce ce mendiant, heureux au soleil, sans envie de savoir de quoi il était heureux ? Et la mort attendue était-ce encore:
… maman viendrait et se jetterait à mon cou…
Une bonté active et pleine d’égards, de la discrétion, des principes qu’à soi-même on se donne ; ce qui, chez un homme, est plein d’amour et de réflexion, c’est cela la culture, et tant de choses encore mais:
Il règne dans ces milieux de la culture avancée une fatigue qu’il est à peine possible de ne pas voir, ou de mal comprendre.
Vous me dites qu’écrire vous exalte trop, que vous perdez toute discipline et que les lettres dansent et papillotent devant vos yeux. Comme je vous suis reconnaissant de m’ouvrir votre boîte à ouvrage, de m’y montrer les aiguilles à tricoter. Il est vrai que le froid vous saisit quand on parle de héros, et puis:
… avons-nous encore besoin d’autres jardins que ceux que nous nous _faisons nous-mêmes?
De la musique de table comme on dit du vin de table, on en boit chez vous. Savez-vous qu’il est difficile aujourd’hui d’en trouver ? Je vous l’ai dit dans les premières lignes de cette lettre, vos mots m’ont vu envahi d’une mélancolique compassion et en cet instant me reviennent vos paroles. Vous disiez:
Peut-on consoler un Jacob von Gunten? Impossible, tant que j’ai des membres valides.
On vous pensait orgueilleux — ce von Gunten ! —quand vous n’étiez que cet aristocrate un peu fatigué de cette continuelle possession et conscience de soi, cette petite pièce certes mais si précieuse de la machine travaillant à la grande entreprise. Et, oh ! ce conditionnel!
Je ne maudirais pas la vie, elle serait maudite depuis longtemps, je ne ressentirais pas de souffrance, car la souffrante avec ses brusques sursauts, j’en serais venu à bout depuis longtemps.
Mais vous en êtes venu à bout, Robert Walser ! menant une étrange double vie, à la fois réglée et déréglée, contrôlée et sans contrôle, simple et excessivement compliquée. Voyez-vous, en ce moment ma main tendue vers une signification je la voudrais dormante comme au bois, comme la Belle du conte. Vous écrire c’est transformer quelques larmes en lance d’or. J’aurais voulu écrire moi aussi ces lignes :
En vérité, je n’ai jamais été un enfant, c’est pourquoi, je le crois fermement, je garderai toujours quelque chose de l’enfance. Je n’ai fait que pousser et vieillir, mais le fond est resté. Je ne me développe pas.
Vos mots invitent à respirer avec vous dans des régions inférieures, là où les littérateurs n’ont pas accès, petits conquérants du monde du dehors, de la profession, des ambitions, des luttes où l’on rencontre des océans d’ennui, de tristesse et de solitude. Attendre, seulement attendre dans une maison des morts ou dans un palais de délices. Attendre là où il se passe quelque chose que l’on ne comprend pas encore:
Il y a une chose dont je suis sûr : nous attendons ! C’est là notre valeur. Oui nous attendons, nous tendons pour ainsi dire l’oreille vers la vie, vers cette plaine, vers cette mer et ses tempêtes qu’on appelle monde.
Vous me dites avoir en vous deux races, l’une tendre, l’autre intrépide, qui chacune vous pousse soit à risquer quelque chose d’audacieux soit quelque chose de très délicat. Voyez-vous, je pense que vous avez réussi tout à la fois à être délicat et audacieux. Non vous n’êtes pas du tout ridicule, même s’il est vrai que ces mots conviennent peu à l’époque actuelle lorsque vous dites:
« On ne peut pas m’excuser, cela je le vois, mais on ne peut pas non plus m’offenser, cela je m’y oppose. »
Je voudrais avant de prendre congé de vous, cher Robert Walser, à la fois répondre à l’une de vos questions et à mon tour vous en poser une : Oui votre cri résonnant dans les gorges et les gouffres:
«J’ai pris une décision. »
Nous l’entendons. Oui vous avez pris une décision, où il était question de davantage de travail, de moins de désirs et surtout de disparaître à vous-même, de vous oublier tout à fait. Vous avez pris la décision de partir pareil à cet autre enfant, l’homme aux semelles de vent. Est-ce bien lui avec lequel vous cheminez ?
Nous allions à pied, faisant du trafic avec les indigènes, et nous étions étrangement animés d’un contentement froid et grandiose, dirais-je. «Echapper à la culture, sais-tu Jacob, c’est fameux» disait de temps à autre monsieur le Directeur, qui avait l’air d’un Arabe.
Est-ce Arthur Rimbaud ? Et ces lignes que j’ai plaisir à recopier et que peut-être vous reconnaîtrez, sont-elles de vous ou de lui ? Mais peut-être tout simplement les avez-vous apprises ensemble de la même bouche d’ombre, à minuit, une main féminine sur vos épaules.
Je sens que la vie exige des mouvements, non des réflexions. Je vais avec M. Benjamenta dans le désert. Je verrai s’il n’y a pas moyen de vivre aussi au désert, de respirer, d’être, de vouloir sincèrement le bien et de le faire, de dormir la nuit et de rêver. Bah ! Maintenant je ne veux plus penser à rien. Pas même à Dieu? Non! Dieu sera avec moi. Qu’ai-je besoin de penser à lui ? Dieu marche avec celui qui ne pense pas.
Oserais-je vous dire à bientôt cher Monsieur Walser ?
J. R.
(Le Passe-Muraille, Nos 64-65, Avril 2005)