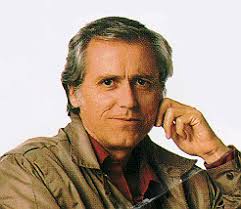Le Système et la faille
À propos de Cosmopolis de Don DeLillo,
par Pascal Ferret
Il est peu d’auteurs contemporains qui parviennent, autant que le romancier américain Don DeLillo, à pratiquer, à partir d’une observation clinique du monde contemporain en général, et de la société américaine en particulier, ce qu’on pourrait dire une pensée romanesque. Sans être vraiment des romans d’idées, les livres de Don DeLillo ne cessent de distiller la réflexion la plus aiguë sur la transformation des relations entre individus, des moeurs et des valeurs dans la société de consommation et de communication en voie de mondialisation qui est la nôtre. En dépit d’une conscience « sociologique » aussi active que celle d’un John Dos Passos, dont il relance l’inventaire et auquel il s’apparente également du point de vue de la musicalité « urbaine » de son écriture, Don DeLillo ne sacrifie pas pour autant l’intuition flottante du romancier, et ses inventions narratives, autant que ses hantises et autres fantasmes récurrents, sont d’un écrivain puissant doublé d’un styliste bien plus que d’un théoricien à système. Sous le vernis brillant du New-Yorkais grouille par ailleurs, à l’opposé de l’artificiel Tom Wolfe (à ne pas confondre évidemment avec l’immense Thomas Wolfe…), toute une humanité vivante et vibrante familière à ce fils d’immigrés italiens né dans le Bronx et qu’on retrouve dans la faille duplus glacé de ses romans, dernier paru sous le titre de Cosmopolis et figurant les prémices de l’effondrement concrétisé par les attentats du 11 septembre 2001.
A penser l’Amérique en la racontant, la scannant et la recréant, Don DeLillo s’est consacré dès son premier roman, Americana, paru en 1971 et cristallisant les mythes de l’époque, de même que Libre a fixé le sociodrame lié à la mort de JFK, qu’Outremonde revisite le rêve américain au miroir du dernier demi-siècle, ou que Mao II analyse les tenants et les aboutissants des phénomènes émergents de la crédulité de masse (manipulés par un Révérend Moon, en l’occurrence) ou de la nébuleuse du terrorisme, entre autres thèmes liés à l’époque.
Eric Packer, le protagoniste de Cosmopolis, est le parangon du Nouvel Homme des années quatre-vingt-dix qui aurait dû symboliser la fameuse Fin de l’Histoire selon Fukuyama, avant qu’un crash financier n’illustre la fragilité de son empire. Dernier avatar du Battant à l’américaine, après les deux cracks du Bûcher des vanités de Tom Wolfe et d’American Psycho de Bret Eastpn Ellis, ce superponte de la finance mondialisée est plus intéressant à tous égards que ceux-là, en cela que sa réussite « absolue » relève bel et bien d’une façon technocratique de Quête de l’Absolu combinant la maîtrise du Temps et de la Matière à tous leurs degrés. Grâce à sa compétence personnelle (il reste un self made man de la bonne vieille école) en phase avec toutes celles qui dépendent de son pouvoir, Eric Packer « gère » son portefeuille avec le même soin d’hygiéniste perfectionniste qu’il consacre à l’entretien de son corps ou à l’accomplissement de ses désirs esthétiques ou sexuels. A ce propos, s’il affirme que le «sexe voit clair», il en est arrivé à un état où la jouissance se réduit pratiquement à un orgasme mental relevant de la pure connection entre neurones.
Quittant le matin son appartement rotatif de quarante-huit pièces juché au sommet de la plus haute tour du monde, Packer va prendre le temps du roman pour traverser Manhattan avec l’idée apparemment insignifiante de se faire couper les cheveux. Dans l’intervalle, frayant avec ces «éphémères giclées d’être» à quoi se réduisent les gens sur l’« espace viande» de la rue, Packer ne cessera, un oeil vrillé aux multiples écrans de sa limousine tapissée de liège à l’imitation de la chambre de Proust, de surveiller l’évolution continue de ses affaires et de celles du monde, le cours du yen l’intéressant autant ce jour-là que l’état de sa prostate en léger déficit.
S’il y a du monstre froid dans ce portrait de financier post-moderne (il a « réfléchi aux surfaces », rêve de se payer la chapelle de Rothko et se demande lyriquement « où vont les limos la nuit »…), ce Prospéro régnant sur son île Système s’étoffe au fur et à mesure de ses rencontres et «stations», tandis qu’il s’approche de la boutique du coiffeur et, par la même occasion, du Caliban chômeur «jeté» d’une des ses entreprises qui l’enlèvera et lui fera la peau dans son antre anachronique d’homme du souterrain à la Dostoïevski.
La faille du Système de Packer réside cependant en lui-même plus qu’en ce double obscur, et c’est en cela que Don DeLillo renoue avec ce qu’on pourrait dire l’Amérique du tréfonds, où survit un vieux rêve de fraternité. La plus belle scène du roman est ainsi celle où Packer, redevenu le fils de son père l’immigré, écoute le dialogue de deux chauffeurs de taxis qui se racontent leurs nuits à rouler à travers New York et découvrent qu’ils pissaient sous le même Manhattan Bridge… Cela pourrait sembler kitsch dans un tel roman, mais c’est le contraire qui est vrai : il y a là, dans ce simple geste amical faisant « tache humaine » sur le fond de ce ballet fantasmatique où l’économie et la culture, la science et la mystique sont censés se fondre au point Oméga, l’antidote même au kitsch érigé en Système.
JLK
Don DeLillo. Cosmopolis. Traduit de l’américain par Marianne Véron. Actes Sud 2003, 221 pages.
(Le Passe-Muraille, No 59, Décembre 2003)