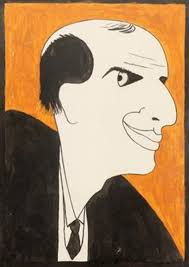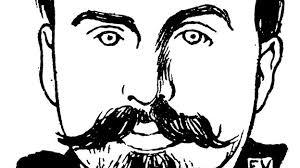Vies imaginaires de Marcel Schwob
Un aventurier passif,
par Fleur Jaeggy

Mayer-André-Marcel Schwob fait son apparition dans une famille de rabbins et de médecins. Sa mère, Mathilde, était une Cahun, descendante de Caym de Sainte-Menehould, qui avait suivi Joinville outremer et, disait-on, l’avait soigné et guéri du choléra, devant Saint-Jean-d’Acre. Du grand-père de sa mère, Anselme, rabbin de la communauté de Hochfelden, Schwob avait pris le vaste front, la bouche sensuelle et un demi-sourire triste dans les yeux. Marcel avait l’orgueil de sa race et préférait souvent ne pas fréquenter certaines personnes de sa race. Son cerveau était encombré de noms, de mots, de légendes, à trois ans il parlait l’allemand et l’anglais. Dans la maison de la rue de l’Église, à Chaville, régnait un grand silence, sa mère montait l’escalier sur la pointe des pieds, et même les Prussiens, lorsqu’ils avaient volé le vin dans les caves, avaient eu un comportement très délicat envers cet enfant trop précoce, trop intelligent, qui souffrait d’une fièvre cérébrale. Pendant sa maladie, obligé de garder le lit avec les volets clos, Marcel continuait à partir pour de longs voyages. Il était légèrement rachitique et rêvait de traverser la Manche à la nage. À son arrivée, il y aurait Jules Verne pour l’embrasser. Il y avait un autre ami avec lequel il parlait, dès qu’il avait chassé son précepteur allemand, c’était Edgar Allan Poe. Il mettait de l’ordre sur sa table, il préparait sa chambre pour une rencontre. Avec Edgar et Jules, il s’était entouré de conversations, il abhorrait donc les enfants de son âge et leurs râles enfantins. Sa concentration était telle qu’il ne s’était pas rendu compte des heures qui passaient, ni des années, au cours de ces dialogues. Il eut soudainement quinze ans et dévorait la Grammaire comparée d’Auguste Brachet. Son oncle, Léon Cahun, auteur de La Vie juive, devint son tuteur et son maitre. D’ailleurs, qui aurait pu être le maitre de Schwob, sinon un Cahun. Et un Cahun conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Il connaissait les histoires des aventuriers, des marins et des soldats, il avait voyagé en Asie Mineure, le long de l’Euphrate. Il connaissait beaucoup de choses, même la langue des Ouighours.
Au lycée, Marcel rencontre quelqu’un de son âge, étrange et mélancolique, Georges Guieysse, ils deviennent très vite inséparables et travaillent ensemble. Chaque page de Marcel passe par les mains de Georges et, comme un humaniste de la Renaissance, Marcel lui écrit des lettres en grec, avec des salutations en arabe, ou bien un simple shake hands. Marcel lui avoue qu’il est souvent incroyablement fatigué, que ses idées lui échappent, que sa mémoire est en miettes. Pourquoi ne pas partir comme squatters pour l’Australie ou le Canada ? Malheureusement Georges, depuis quelque temps, semblait absent. Lorsqu’ils se voyaient, il laissait à Marcel le soin d’inventer pour lui les itinéraires des voyages qu’ils feraient un jour, et, en proie au spleen, il restait blotti dans un coin et observait l’érudit. Le 7 mai 1889 Georges Guieysse se tira une balle dans le coeur, il avait vingt ans.
Dès lors, Marcel eut comme demeure la salle austère de la Bibliothèque Mazarine, souvent vide, et les Archives, où il exhumait des documents sur Villon et la bande des Coquillards. Il devint écrivain. Une soirée d’automne, quand la pluie est déjà froide, il rencontre dans la rue une petite ouvrière à l’esprit enfantin, Louise, et en tombe amoureux. Elle est très maigre, rongée par la tuberculose, une enfant misérable aux cheveux châtains, aux yeux perdus et rieurs, qui lui écrit des mots colorés, et Marcel est enchanté par les petites sottises que Louise lui dit. Par exemple Mon Loulou, mes cheveux sont tombés, fais attention à tes ongles qui poussent et aux petites écailles de ta peau qui tombent. J’ai mal au ventre. J’ai recousu le nez de ma poupée, il est devenu à présent plus court, mais aussi plus gros, et j’ai oublié de lui laisser ses narines. Je reprendrai plus tard mon travail de ciseaux, mais je dois les avoir perdus. Souviens-toi de m’en rapporter une autre paire, quand tu viendras, tu m’aideras peut-être. Pichci-quinki.
L’érudit avait pris la manie du jeu. Ses poches étaient pleines de coton, d’aiguilles, de bouts de tissu aux ourlets colorés, il parlait d’une voix de fausset avec les directeurs des journaux qu’il détestait, et souriait beaucoup. Marcel, en même temps, soignait avec inquiétude la petite Vise, qui était dans un état grave. Les médecins étaient atterrés des conditions d’hygiène dans lesquelles vivait Louise, la petite chambre sans un courant d’air, avec en haut une fenêtre de quelques centimètres toujours fermée. Louise fumait cigarette sur cigarette, des cigares, la pipe de Marcel et buvait toujours du café. Bientôt Louise mourut. Après l’enterrement, le malheureux écrivain revient dans la chambre et couche dans une valise toutes les poupées et les porte chez lui. Ses amis ne le laissent pas un moment, car, dès qu’il est seul, Marcel a peur que la morte ne meure encore. Il voit son fantôme rire dans tous les coins de la maison, ses yeux d’eau lui proposent de nouveaux jeux. Marcel enferme dans un tiroir les ciseaux et les canifs et jette les aiguilles, les bouts de tissu, il devient superstitieux, et veut dormir longtemps. Dans son sommeil l’écho d’un éclat de rire effronté le rejoint, l’enfant a donc grandi dans la mort, les gazouillements et les bêtises se sont-ils évanouis ? Le matin suivant il se regarde dans le miroir, il a vieilli, ses cheveux sont tombés dans la nuit et son front est maintenant encore plus vaste.
Il prit l’habitude de la morphine. Ce sont les moments de sa solitude gran-diose. Après les visites de ses amis, il barricade les portes et les fenêtres, pas un bruit ne filtre, ce sont les heures perpé-tuelles, l’éternité se stratifie dans la chambre. Il devenait alors vraiment le Grand Cheikh du Savoir et des Grimoires, comme l’appela le Docteur J. C. Mardrus, en lui dédiant le XVe volume de sa traduction des Mille et Une Nuits. Mardrus avait une voix mielleuse et ses rires de temps en temps faisaient perdre patience à Schwob. Il portait de longs manteaux aux ourlets recousus et les boutons pendaient, mais ses poches intérieures étaient gonflées de pièces d’or. Des histoires d’argent s’intercalaient entre les légendes extraordinaires que racontait Mardrus. Schwob préféra bien vite prendre ses distances aussi avec cette amitié. Il pensa écrire les Vies imaginaires. Ces hommes qui vécurent comme des chiens, ces femmes saintes et crédules devant n’importe quel moine sournois, ceux qui se damnent, la complaisance et l’aspiration vers tout ce qui est encore plus bas, telle était à présent la compagnie à laquelle Schwob se mêlait. Il s’aperçut qu’il souriait en répétant ce qu’il avait écrit : «N’embrasse pas les morts : parce qu’ils étouffent les vivants… les morts donnent la peste. » Schwob était déjà malade et savait qu’il ne guérirait jamais.
Dans un pavillon de l’Exposition universelle de Paris en 1900, Marcel vit un Chinois, dont le nom était Ting, et le prit à son service. Il décida de partir pour les lieux de Robert Louis Stevenson «55/100 artiste, 45/100 aventurier », avec lequel il avait entretenu une longue correspondance. Schwob et Ting s’embarquèrent vers les mers australes à bord de la Ville-de-la-Ciotat. Quand un de ceux qui le connaissaient, Jules Renard, fut informé de ce départ, il nota : « Avant de mourir, il vit ses récits. » Des fonctionnaires gras, des magistrats coloniaux qui liaient conversation et une famille hideuse composée de quatre filles taurines, aux lourdes nattes roussâtres, et d’un fils albinos qui avait l’air d’une grosse fille de ferme habillée en homme parcouraient en long et en large le bateau. Le voyage lui parut vite trop long. A Colombo, il contemplait avec lassitude la Babel des religions. Il vit des caravanes d’hommes prier dans une caverne, il vit la fête tamoule, de plus en plus fatigué, il respirait à peine, un vent chaud soufflait sur lui la poussière et les mouches se collaient à sa peau. Le paysage lui semblait souvent sinistre, en Australie de longues plages à la pâleur cadavérique où les arbustes oscillaient comme des paquets de chevelures mortes. A Samoa, on l’appelle tulapala, le talkman, et on l’oblige à conter très tard dans la nuit. Il serre la main du roi Mataafa qui ressemble à Bismarck. Schwob ne vit pas le tombeau de Stevenson au sommet du mont Avea, parmi les fleurs. Il ne trouva pas ce qu’il cherchait. Un certain capitaine Crawshaw lui montra quelques billets écrits par Stevenson. L’un d’eux recommande mystère et discrétion, avec prière de se saisir de Wurmbrandt à Tonga pour l’amener tout de suite chez lui. Wurmbrandt était un aventurier autrichien que Stevenson aimait beaucoup. Ce voyage de la mémoire vers les ombres des enchantements s’était dissipé. Il ne restait que le catalogue racorni d’une longue errance. Il avait rencontré des imposteurs larmoyants qui se traînaient en proposant des affaires, des charlatans en ruine, des moulages vermoulus des brigands et des criminels qu’il connais-sait si bien depuis toujours. Dans ce bain de multitude, il désira ardemment sa chambre de Paris.
Il se renferma chez lui pour respirer le retour. Océanide, Vaililoa, Captain Crabbe étaient les titres de livres qu’il n’écrirait jamais. Et il ne voudrait plus jamais par-tir. Il se sentait comme un « chien vivisectionné ». Pourquoi les morts ne viennent-ils pas converser une demi-heure avec cet homme malade? Son visage se colora légèrement et devint son masque d’or. Ses yeux restèrent impérieusement ouverts. Personne ne parvint à lui fermer les paupières. Le deuil s’exhalait de la chambre. (Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro)
F.J.
Marcel Schwob l’antiquaire

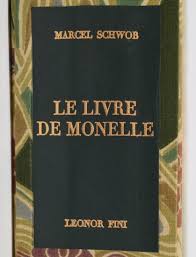
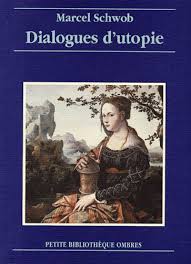
Marcel Schwob l’antiquaire
Type par excellence de l’écrivain «fin de siècle », Marcel Schwob (1867-1905 ), mélange de fou de lecture et d’érudit aux curiosités rares en matière de littérature grecque ou latine, médiévale et surtout anglo-saxonne (il a traduit Shakespeare, De Quincey et son ami Stevenson) nous a laissé une oeuvre de conteur singulier dont quelques titres, tels Le Livre de Monelle ou La Croisade des enfants, ont gardé leur charme et leur saveur. Ses Vies imaginaires (rééditées en 1993 aux éditions Ombres), initialement parues dans Le journal, entre juillet 1894 et juin 1896, et rassemblées en volume en 1896, constituent également un florilège délectable de portraits combinant le savoir et la fantaisie.
«L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que l’unique », écrivait Schwob dans sa préface à ce livre, décidé à pallier les manques de la « science historique » qui nous laisse « dans l’incertitude sur les individus », tandis que le biographe accumule les certitudes individuelles, avérées ou inventées.
La vie d’Empédocle est ainsi celle d’un « dieu supposé » qui connut quatre premières existences sous forme de plante, de poisson, d’oiseau et de jeune fille, avant de s’illustrer par maints prodiges. Plus de vingt autres personnages, fameux (comme Pétrone ou Paola Uccello) ou gagnant à être connus (une matrone impudique, un poète haineux, un pêcheur de trésors, une princesse indiennes et divers pirates) sont également portraiturés. A cet ensemble, traduit en italien aux éditions Adelphi par Fleur Jaeggy, celle-ci a ajouté une vie imaginaire de Marcel Schwob que nous la remercions de nous permettre d’offrir ici à nos lecteurs.
JLK
Fleur des marges

Deux livres ont suffi à établir, dans notre langue, la notoriété de Fleur Jaeggy, révélée en 1992, chez Gallimard, par Les Années bienheureuses du châtiment. Née à Zurich mais installée à Milan (où elle partage la vie de Roberto Calasso, écrivain lui aussi et directeur des prestigieuses éditions Adelphi), écrivant en italien avec une très forte imprégnation culturelle helvétique — non du tout au sens d’un provincialisme étroit mais au contraire dans l’ouverture cosmopolite dont participait aussi un Robert Walser, cité dès les premières lignes —, Fleur Jaeggy racontait, dans son premier livre traduit, rappelant assez le climat des Désarrois de l’élève Törless ou de L’Institut Benjamenta, la vie d’un collège-pension de l’Appenzell où cohabitent des jeunes filles du monde entier.
Modulant le même mélange d’acuité perçante et de poésie, de trouble diffus et de puissance expressive, les nouvelles de La Peur du ciel (Gallimard, 1996) confirmèrent, avec plus encore d’intensité, ce talent littéraire d’exception, rappelant à certains égards celui d’une Flannery O’Connor, en moins « catholique» assurément. Cependant, le même goût pour les personnages hors normes (anges et/ou démons), les passions extrêmes ou les crises révélatrices, la même approche «panique» de la réalité, la même révolte et la même tendresse blessée apparentent ces deux écrivains à l’écoute de ceux qu’un Henri Calet appelait les «sinistrés de l’âme».
JLK
(Le Passe-Muraille, No 53, Juillet 2002)