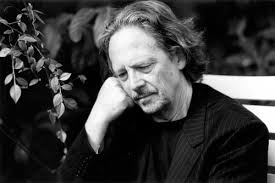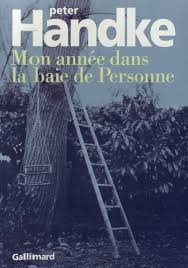Odyssée d’une imagination
Sur Mon année dans la baie de Personne, roman de Peter Handke,
par Antonin Moeri
«De qui parle-t-on lorsque l’on parle de moi ?» Gombrowicz aurait pu poser la question, ou Wittgenstein, ou Proust… Comment ne pas la poser, dès lors qu’un narrateur est mis en scène dans un livre où l’action devient saisie minutieuse du réel, où la moindre évidence est remise en question, le langage examiné dans ses représentations, nos habitudes de vie scrutées au télescope et le moi, signe de notre identité, suspecté ?
Cette minutieuse, lente, prudente saisie du réel peut embarrasser le lecteur pressé, car ses catégories de perception sont bousculées, ses repères ignorés. La «prière narrative» se soustrait au langage réglé par la logique dite rationnelle. Les images attendues ne sont pas convoquées. Mais rassurez-vous, le narrateur du dernier livre de Peter Handke traduit en français est un homme civilisé. C’est un écrivain professionnel qui a étudié le droit. Il a un nom: Keuschnig. Et un prénom: Gregor. Les instructions de lecture sont données. Il s’agit bel et bien d’un roman. D’une fiction. C’est l’épopée des interstices de la terre, des grives en plein vol, des frelons jaunes, des églises orthodoxes et des petits artisans devisant dans les squares.
Ce n’est pas un monde abstrait qui est célébré, mais «le monde sous forme de détails», ceux qui permettront de raconter des histoires, de fantasmer, d’imaginer, de chanter les discontinuités intérieures. «Il était une fois…» Par ces mots pourrait commencer le livre. Car l’éternel arpenteur marche depuis le début sur «la piste du monde fabuleux», en quête d’une légende, d’un conte qui pourrait le relier au «peuple dispersé des lecteurs». Ce monde plus grand au-quel il aspire, ce peut être une cantilène entendue au loin qui le lui ouvre, ou un signe de hanche qu’il croit lui être adressé par une femme aperçue au bord de la nuit.
Pour imaginer, il suffit de fermer les yeux, «et passer le dimanche avec le prêtre lointain, m’asseoir avec lui devant la soupe de midi, respirer l’odeur de sa voiture». Pour se souvenir de la femme qui a partagé sa vie quelque temps, pour évoquer sa sœur, son frère, son fils Valentin ou sa propre enfance à la frontière slovène, Gregor Keuschnig ferme les yeux. C’est de l’autre côté de la vie qu’il a choisi de se fixer, au centre d’une étoile qui sera lumineuse, qui rejoindra, au ciel des questions sans réponses, les cohortes de réprouvés, d’orphelins et de criminels. Un centre qui ne relève ni de l’architecture, ni de la géométrie, ni de la géographie, qui échappe à toute définition mais qui permet à Gregor de retrouver la bonne distance entre lui et ses souvenirs, ses rêves, ses sensations vraies, entre lui et les autres.
Mais d’où lui vient le besoin de dire les dérades, les errances, les voyages en Mongolie et en Alaska, la blanche écorce des bouleaux, les ruches abandonnées à la lisière d’un bois ? D’où lui vient le besoin de nommer Asnières, Clichy, les collines de la Seine, la fontaine Sainte-Marie, Clamart et Châtillon, l’amie qu’il voit sous le soleil de Satan, la corde à linge sur la terrasse, un bus poussif dans une rue déserte, le vent glissant entre les doigts, le corps gris clair des moineaux blottis tous ensemble là-haut, sur la branche du platane ? Ce besoin vital indique une peur panique devant le chaos de ce qu’il est convenu d’appeler la réalité. Ce besoin de nommer exige une discipline que l’ancien droit romain avait pu suggérer à Gregor: «En épelant les Pandectes article par article, section et sous-section, je voyais le désordre et l’obscurité disparaître de mon univers.»
Méthode, discipline, lois subtiles auxquelles se soumet l’écrivain que taraudent les scrupules: qui me donne le droit d’écrire, quelle légitimité donner à mon entreprise solitaire ? qui est le «je» qui parle, celui qui se souvient, celui qui marche à l’ombre d’Erik Satie, celui qui écrit et contemple le cèdre depuis sa table, celui qui charge de sens le langage en créant une langue qui palpite plus qu’elle ne raisonne, celui que Gregor était dans le passé, celui qui se réveille à côté de la grand-mère morte, celui qui voit «les gouttes de pluie dans la poussière du chemin de campagne»? Pour la plupart des événements vécus, la main hésite devant le «je» avec un tremblement d’effroi, comme si le doute, l’incertitude devant la chose à dire, comme si la crainte de manquer une nuance dans la dénomination étaient le véritable sujet du livre.
Si Valentin, le fils méticuleux, poursuit son voyage de Maribor à Bitola, en passant par Dubrovnik, avec son couteau militaire, les crayons à dessin, le marteau de géologue et une biographie antique de Pythagore, avec sa manière particulière de considérer l’univers, Gregor, le père obstiné, s’inscrit plus profondément dans un espace. Il se retranche pour faire sien un territoire: région, localité, maison. Il n’entend pas créer un «autre» monde. Son ambition est claire: nous enchanter avec ce qui est, valoriser les choses les plus «banales» pour enluminer les riches heures. Esquivant habilement tous ceux qui prétendent l’envelopper d’amour, Gregor «s’attache à un état jusqu’à ce qu’il devienne forme, jusqu’à ce qu’il prenne figure».
Handke rêve depuis toujours d’une «narration qui se pose d’abord des questions, naturelles et pressantes». Mon Année dans la Baie de Personne apparaît comme un achèvement, pourrait-on dire, la réalisation d’une idée belle, obsédante. Les transitions d’une séquence l’autre y sont agréables, d’une auberge l’autre, d’une chênaie l’autre, elles nous entraînent comme une mélodie qui ne nous quitte plus. Nul souci de faire poétique, comme chez la plupart des tâcherons du joli. Chaque paragraphe, chaque phrase, chaque signe répond à une nécessité interne impérieuse: ouvrir le scripteur aux bruissements et aux couleurs, aux lumières diaprées, à la musique, et avec lui le lecteur qui accepte la métamorphose.
Handke est un écrivain très rare. Il ne craint pas d’envisager le mal. Dans les sifflements de paroles impuissantes, dans les fioritures proliférantes du discours édifiant, le mal absolu ne réside-t-il pas, finalement, dans l’incapacité de nommer ? A cette question, le poète autrichien répond par une œuvre inspirée, somptueuse dans sa plus grande partie, monumentale, taillée dans le «minéral épique»: l’aventure d’une imagination.
A. M.