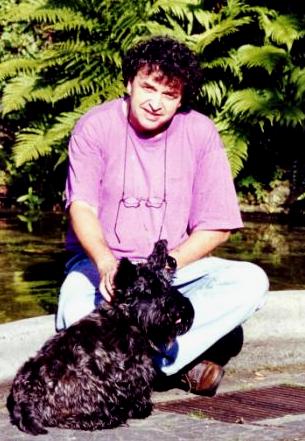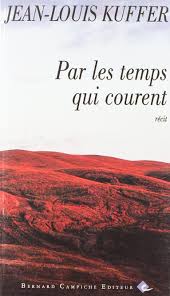La Vraie Vie est toujours devant soi
À propos de Par les temps qui courent, récit de JLK,
par Rose-Marie Pagnard
Qu’est-ce qu’un livre de Jean-Louis Kuffer ? C’est la pierre d’une étape, c’est, en quelque sorte, un livre qui dit: je reprends tout depuis le début – l’enfance, l’adolescence, la révolte et la jeunesse, la société et l’individu, le temps et les contre-temps – pour ensuite mieux attaquer la vie, et à chaque fois avec un peu plus de jugeote, un peu plus de compassion, et de sagesse et d’élan.
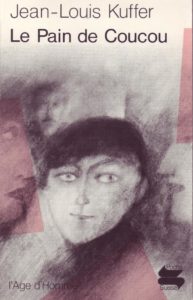
Cette vie écrite, comme un reflet méticuleusement travaillé et quelquefois volontairement voilé d’une existence réelle, court à la recherche de la Vraie Vie. Notez les majuscules, elles brillaient déjà sur l’image pieuse que contemplait un petit garçon dans Le Pain de Coucou (L’Age d’Homme, 1993), un livre dans lequel Jean-Louis Kuffer évoquait son enfance; elles brillent aujourd’hui encore dans ce dernier récit intitulé Par les temps qui courent, aussi mystérieuses que par le passé car, lorsqu’on croit l’étreindre, la Vraie Vie nous échappe, et se tient devant nous. Cependant l’instant fugace, indicible, où l’on s’imagine comprendre soudain le secret de la vie, cet instant-là existe: «(…) c’est cela même que j’aimerais dire et rien d’autre», écrit Jean-Louis Kuffer. Ainsi revisite-t-il dans ce livre les instants rares, inoubliables, où la perception du monde et de sa propre existence s’est subitement imposée, devenant «(…) l’instant même où des liens inattendus se révèlent, tissant entre objets et visages, pensées et parfums, songes et souvenirs, tout un entrelacs de résonances à n’en plus finir».
En sept chapitres géographiquement dispersés – Lausanne, Tokyo, La Nouvelle-Orléans, New York, la maison des parents, l’hôpital, un train, l’Italie – Jean-Louis Kuffer raconte ces moments d’éveil, dans une chronologie qui est celle des vagabondages de la mémoire et des préférences du cœur. On y retrouve le ton d’ardeur rebelle de l’ex-jeune homme révolté, et ce penchant à l’aller «dans le sens opposé à celui du flot». Dans le TGV qui le ramène de Paris où il a interviewé «L’Ecrivain Magistral» (le lecteur préférerait un nom à la place de ce clin d’œil en forme de devinette), le narrateur aperçoit un ancien camarade du temps du militantisme communiste, un homme maintenant transformé en «pédégé manucuré»: la résurgence des glorieux idéaux, liés à l’interview du ponte littéraire, entraîne le narrateur dans une introspection ironique, allusive, qui laisse le lecteur tout embrouillé, conscient seulement que cela pourrait être dit plus simplement. Plusieurs passages du chapitre «Cité de Babel», qui parlent de la «modernisation» du journal auquel collabore le narrateur, donnent le même sentiment, comme si la causticité engendrait dans le texte ces tournures compliquées.
La Vraie Vie de ce livre est ailleurs, par exemple dans ces mouvements subtils que la narrateur voit comme des «retournements» mentaux. Ce qu’il entend par ce terme, c’est que toute chose, toute personne, sous l’apparence, possède un visage plus secret, pas forcément contraire au visage visible, mais complémentaire, comme un autre aspect de la réalité, et peut-être comme le sens de celle-ci. Cela survient n’importe où, dans les lieux les plus laids comme les plus majestueux, dans un sous-sol, dans une chambre minable de La Nouvelle-Orléans, dans une gare routière à New York, au chevet d’un père mourant, dans un train bondé à Tokyo, à sa table de travail. Tout désormais, pour celui qui parcourt le monde, qui simplement veut voir et savoir – jeune homme à bicyclette sur une route de Toscane, voyageur ballotté dans un bus américain, père penché sur ses enfants endormis – contient à la fois l’ombre et la lumière, tout est motif à l’émerveillement en même temps qu’à l’effroi: parce que le sentiment de la précarité s’est installé en lui. «J’ai pensé distinctement que tout ce qui m’avait été donné pouvait m’être repris dans l’instant, et je me suis dit que ma reconnaissance seule souriait au dieu que je sentais en moi, comme je souriais.» Une dimension mystique se révèle, qui mêle à la découverte de soi et des autres l’interrogation suprême; et voici que les dernières pages de ces confidences font un bond inspiré, plein d’énergie, d’odeurs et de visions, et que, comme le protagoniste de Ô terrible jeunesse ! Cœur vide !(L’Age d’Homme, 1973), ce narrateur-ci salue le matin d’un nouveau jour en buvant son café et en proclamant que «tout est bien»…
R.-M. P.
Jean-Louis Kuffer, Par les temps qui courent, récit, Bernard Campiche Editeur, 1995, 200 p.
Pris Edouard Rod en 1996, réédité au Passeur, Nantes, en 1996, avec une préface de Jacques Chessex.
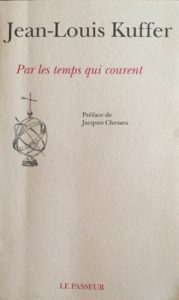
(Le Passe-Muraille, No 22, Décembre 1995)