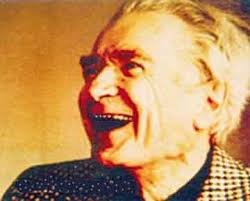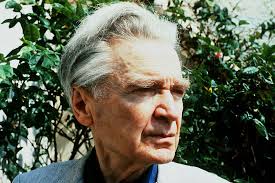La paradoxale sagesse de Cioran
Par manière d’hommage posthume,
par Maurice Sierroz
Disparu en juin dernier, Cioran laisse une œuvre virulente, comme en témoigne la parution, peu avant sa mort, de trois ouvrages1. Ces derniers confirment combien la verve tonique de son style atténue le pessimisme de ses essais. Son admiration pour la langue cristalline des moralistes français du XVIIIe siècle lui fit adopter l’aphorisme et la formule qui réfrénèrent les éruptions de cynisme et les sentiments morbides de ses nuits d’insomnie. Le Précis de décomposition (1949), premier livre qu’il écrit en français, poursuit sa dénonciation impitoyable des illusions entamée dans ses premiers essais roumains empreints de lyrisme. Parmi les illusions qu’il dénonce, on trouve l’histoire, la religion, la philosophie et la politique. Cioran révèle comment, sous l’apparence de la connaissance, elles dissimulent en fait les motivations cachées du moi: les passions, le désir, la croyance, l’envie, la cupidité, etc. La connaissance, comme vérité impersonnelle, lui apparaît ainsi une façade derrière laquelle se cache une irrationalité inavouable.
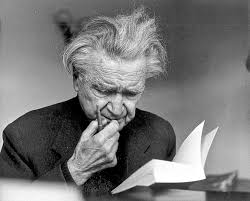
L’idée, selon Cioran, travestit toujours une croyance. L’origine réelle du savoir se trouve dans l’incertitude de l’homme et dans son besoin vital de foi. Ce sont ses fondements irrationnels que la raison cherche à camoufler sous les notions de vérité ou de progrès par exemple. De même, l’action convoite un but dont la réalisation dépend, en bonne partie, de l’oubli du moi. Cioran s’y refuse, car il voit dans l’expérience intime et ressentie le critère de la pensée authentique, à commencer par la sienne. Des épreuves telles que l’insomnie, la maladie, la mélancolie ou l’ennui représentent la source même de ses idées. La sensation est la matière première de sa réflexion. Aussi raille-t-il ces philosophes professionnels qui ratiocinent sur le moi et les passions faute de les éprouver. «Penseur d’occasion», Cioran voit donc naître ses idées à l’occasion d’une expérience vécue – à l’instar de Nietzsche.
Dès ses premiers essais, la philosophie devient l’objet d’une critique acerbe. Il rompt très tôt avec la philosophie universitaire incapable, selon lui, de soulager des maux de l’existence. Stérile, elle est une fuite dans l’abstraction afin d’échapper au vécu. Pourtant, malgré sa hargne à l’encontre du système, il ne rejette pas pour autant la pensée soucieuse de la vie. Proche en cela des Stoïciens et des Cyniques, il joue leur quête d’une sagesse que les professeurs dédaignent pour la spéculation et le jargon. La réflexion du penseur roumain s’apparente également à une méditation bouddhiste sur le moi et l’illusion. Cependant, la sagesse qu’il poursuit se distingue de la spiritualité orientale. «Sagesse négative», elle procède davantage du désaveu des certitudes et de l’Absolu que d’une quête du nirvâna.
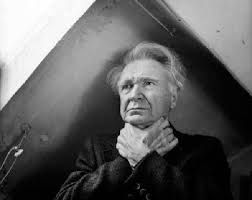
Son scepticisme viscéral le conduit à des insolences fréquentes à l’égard de Dieu et de la religion. Mais, alors que cela devrait l’éloigner de la mystique, l’ascèse stylistique à laquelle il se contraint lie étrangement ses doutes à une mystique du mot. Ce paradoxe apparaît dans certains titres2 de ses ouvrages qui traduisent l’«écartèlement»3 de sa pensée entre son instinct sceptique et son aspiration mystique. Témoignage d’une sagesse inaccessible ou d’une mystique sans Dieu, la réflexion de Cioran dresse en fait l’inventaire des obstacles à la libération de l’homme, celui-ci demeurant prisonnier de ses illusions malgré son désir de vérité et d’Absolu. L’absence de transcendance qui caractérise son art du discernement le rapproche sans aucun doute de Valéry – lui aussi mystique profane. Mais contrairement à l’intellectualisme de ce dernier, Cioran ne cède point à l’idolâtrie de l’esprit.
Nombreux sont les obstacles qu’il décèle sur la voie de la lucidité. Cioran s’en prend surtout aux mots et à la réalité qu’ils déterminent – et à laquelle nous adhérons. Il estime que l’éveil ne résulte pas de l’adhésion au langage, mais de la perception de l’irréalité et du vide. Toute sa pensée découle de ne nihilisme. Dès lors, la vie ne peut être qu’un simulacre de réa-lité et le moi, un agrégat d’humeurs fluctuantes sans consistance. La «tentation d’exister», à laquelle l’homme cède en naissant, l’entraîne aussi inexorablement au néant. Devant ce tragique de la condition humaine. Cioran a souvent songé à se suicider. Il ne put toutefois s’y résigner, trouvant dans les mots – cette «volupté de l’apparence» – des vertus consolatrices à sa lucidité. Dans cette perspective, le fragment et l’aphorisme s’avèrent une thérapeutique préférable au traité de philosophie. Ils autorisent les contradictions inhérentes au vécu que le souci de cohérence exclut. Le caractère homéopathique de la forme brève en fait un «remède» au désespoir de vivre, tandis que le roman demeure un tissu de mensonges inutiles. La littérature est, aux yeux de Cioran, une farce dérisoire en regard de l’absurdité de l’existence et du désarroi qu’elle suscite. Si le concept traduit les illusions de la raison et le roman celles de la littérature, c’est parce que celles-ci génèrent une inflation verbale incapable de nous guérir de l’inconvénient d’être né.
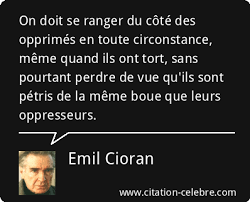
Il y a certes un paradoxe de la part de Cioran à dénoncer ainsi l’illusion des mots alors qu’il y recourt impunément. Il ne conteste cependant ni l’effet thérapeutique de l’écriture sur ses angoisses, ni celui de son esthétique du discernement sur ses dégoûts. Nourrie de pessimisme et d’ironie, son œuvre procure à ses lecteurs une allégresse qui résulte curieusement de son cynisme. C’est là le secours qu’offrent la dérision et l’humour du sceptique face au tragique de l’existence. Ils conduisent à une sagesse ambiguë émanant de ses exercices de lucidité. Une sagesse qui préfère en définitive au fardeau de la connaissance la jouissance des apparences.
M. S.
1 Signalons la biographie de G. Liceanu, Itinéraires d’une vie: E. M. Cioran suivi de Les continents d’insomnie, entretien avec E. M. Cioran, aux Editions Michalon. Riche de photographies, notamment sur la jeunesse de Cioran, elle complète les Entretiens, inédits en français, parus chez «Arcades» Gallimard ainsi que les Œuvres dans la nouvelle collection «Quarto» de Gallimard.
2 Syllogismes de l’amertume (1952), La chute dans le temps (1964), Sur les cimes du désespoir (1990), Le Crépuscule des pensées (1991), Des larmes et des saintes (1992).
3 Ecartèlement, Paris, Gallimard, 1979.