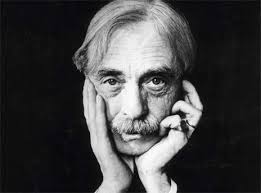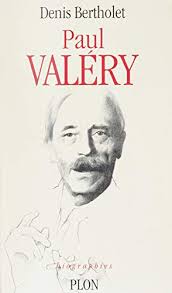Antipolitique latente
À propos de la première biographie(s) de Paul Valéry, nageur émérite t poète à ses heures,
par Christophe Calame
Il y a des auteurs qui jouent à ne pas avoir de vie. Les «premiers de classe» comme Giraudoux, bien sûr, dont les souffrances conjugales et amoureuses sont parfaitement tacites sous le style limpide, aussi invisibles que les blessures de guerre. Ou les vrais «classiques» alors, dont les vies se confondent si bien avec les institutions et les passions avec la carrière, qu’on en viendrait presque à penser qu’ils n’ont vécu que pour donner un visage aux grandes institutions, que ce soit les Petites-écoles de Port-Royal, l’Hôtel de Bourgogne, l’Académie, l’affection du monarque. Paul Valéry, sous la IIIe République, semble jouer à être Racine.
Les amitiés littéraires de jeunesse (avec Gide et Louÿs), la protection paternelle de Mallarmé, un mariage paisible (arrangé par Degas et Mallarmé, avec l’amie de Julie Manet), l’Agence Havas, la NRF, les salons, l’Académie, le Collège de France, la Société des Nations, la diplomatie culturelle, les éditions à tirage limité, la vente discrète des manuscrits aux collectionneurs, l’afflux des commandes (préfaces, discours, causeries): tout cela semble bien lisse, et ne donne pas l’impression qu’une biographie détaillée soit nécessaire. C’est peut-être seulement parce que l’évidence de l’engagement de Valéry se perd avec le temps que l’envie peut naître de le re-trouver autrement que par les immortelles maximes du Palais de Chaillot.
Selon Denis Bertholet, auteur de la première biographie de Valéry, qui restera par l’ampleur de son information et son style remarquable, le petit garçon corse (de mère italienne, risorgimentiste) qui regarde les bateaux dans le port de Sète à la fin du XIXe siècle est même tout le contraire de Paul Valéry. Ce petit-bourgeois méridional, élève médiocre et nageur émérite, est éperdument amoureux d’une imposante dame qui habite sa rue, à laquelle il ne parlera jamais.
Au cours d’une nuit d’orage effroyable, à Gênes, le jeune nigaud se promet de ne plus être amoureux, de ne plus être poète, de ne plus être emporté par rien. Bref, c’est le contraire de la nuit du Mémorial: Valéry, à travers les éclairs, se jure de ne plus croire à rien. Pascal devient sa bête noire, définitivement: n’a-t-il pas préféré «coudre des papiers dans ses poches» plutôt que de «donner à la France la gloire du calcul de l’infini» ?
Pendant vingt ans, Valéry va donc construire sa vie autour de la négation: il sera parisien, il sera mondain, il sera père de fa-mille, il aura chaque année un rhume en septembre et une grippe en décembre, la toux du grand fumeur qui réveille de bonne heure, et les petits matins tranquilles avec le café et les mathématiques. Les cahiers sont des anti-poèmes, ils ne réclament rien et personne ne viendra y mettre son nez. Valéry apprend à être un Moi, c’est à dire rien de fortement déterminé.
Jeunes et moins jeunes peuvent bien le presser de rééditer ses premiers vers, il ne se prêtera plus à la comédie littéraire. A la fin de la journée, après les heures de travail au service de l’un des grands de ce monde, le fondateur de l’Agence Havas (où trouver Louis XIV au XXe siècle, si ce n’est parmi les milliardaires), Paul Valéry s’introduit dans le monde, pour essayer ses paradoxes sur les duchesses, avant de rentrer dîner en famille entre les tableaux de Manet et de Berthe Morisot. Valéry méprise la politique qui «a besoin pour ses fins de la crédulité, de l’excitabilité, de l’émotivité».
Cette organisation est quelque peu troublée par la Grande Guerre: la poésie revient, et Valéry se laisse forcer la main par les circonstances, s’amuse à écrire la Jeune Parque («Ce poème a tout à fait la définition du vieillard galant – ni queue ni tête»). Après la Guerre, c’est l’amour qui revient frapper au carreau: la jeune mathématicienne Catherine Pozzi le fait véritablement souffrir par son acharnement à vouloir l’arracher à sa famille et surtout aux salons (Denis Bertholet, dans sa grande réserve, n’est pas tendre avec la trop amoureuse Catherine !).
Mais la maîtresse passionnée se brise sur le Moi, tout comme la poésie d’ailleurs. D’autres amours se montreront plus heureuses (Valéry semble apprendre, avec le temps, à aimer sans en trop souffrir, mais la biographie ne nous l’indique au fond que par son extrême discrétion). Quant à la poésie, elle ne reviendra pas, ou si peu. Le moment est venu de jouer la grande partie de l’esprit.
Nous avons de la peine à estimer justement, aujourd’hui, ce que furent les efforts des hommes intelligents pour conjurer la catastrophe, dans l’entre-deux guerres. Leur échec nous aveugle injustement. Leurs moyens étaient certes dérisoires: les livres contre la propagande, les commissions contre les manifestations, le scepticisme contre les charismes politiques, la parole contre la haine. Le Centre universitaire de la Méditerranée, à Nice, se donne la mission d’arracher l’Italie à sa pente fasciste. La Commission culturelle de la sdn veut faire l’alliance des esprits. Le pen Club, celle des écrivains. Valéry est de toutes ces institutions.
Une «action antipolitique lente», tel est son programme. Cet engagement européen est admirablement retracé par Denis Bertholet (qui enseigne à l’Institut genevois fondé par Denis de Rougemont). C’est le moment de vérité pour le biographe: son ton, toujours lisse, laisse percer de l’admiration.
Sous l’Occupation, entendant les Allemands faire leurs exercices militaires dans sa rue de Villejust, «comme s’ils craignaient de ne pas nous savoir assez informés du plaisir qu’ils y prennent et de la lassitude que nous en avons», Valéry n’aura pas pour lui uniquement la satisfaction d’avoir empêché l’Aca-démie de trop féliciter Pétain, et de Gaulle lui en saura gré, par les funérailles nationales de 1945.
Mais il savait aussi que tout était à recommencer, et que l’es-prit peut survivre aux civilisations: «Il faut tenter ce que l’on peut pour retirer le gouvernement des choses humaines à des réflexes élémentaires ou primitifs, aux impulsions aveugles, aux excitations illimitées et aux souvenirs incohérents». Ce programme n’a pas vieilli.
Ch. C.