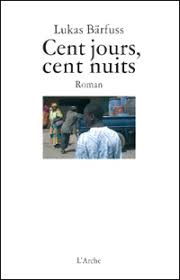Au coeur des ténèbres humaines
À propos de Cent jours, cent nuits, de Lukas Bärfuss,
par Matthieu Ruf
«Les livres qui n’existent pas et qu’on veut lire, il faut les écrire.» Le ton innocent de Lukas Bärfuss, rencontré récemment à Lausanne, semble de prime abord démentir l’aura qui entoure cet auteur de théâtre reconnu, né à Thoune en 1971. L’année passée, son roman Hundert Tage avait déclenché une solide polémique sur l’aide au développement. Débats devant des centaines de personnes, multiplication d’articles: la charge virulente du livre, qui fait de la Direction du développement et de la coopération (DDC) un facilitateur majeur du génocide rwandais de 1994, avait remis au goût du jour, en Suisse, la notion d’«écrivain engagé».
À la lecture de la traduction française, parue en octobre chez un petit éditeur de théâtre parisien, le constat est clair: l’écrivain Bärfuss est tout sauf innocent.Cent jours, cent nuits nous entraîne en effet dans la descente aux enfers du protagoniste David Hohl, envoyé en 1990 au Rwanda pour sa première mission avec la DDC. Un cauchemar déroulé peu à peu, mais annoncé dès l’incipit: dans sa maison enfouie sous les «sapins noirs» du Haut-Jura, un soir d’hiver, David raconte son histoire d’«homme brisé» au narrateur. Un ami d’enfance qui, rapidement, disparaît entièrement du récit, pour laisser place au monologue cynique et terrifiant de David lui-même. Une structure que l’auteur a voulue proche de celle d’Au cœur des ténèbres, de Conrad, et qui ne laisse aucune issue, comme si l’expérience de l’erreur interdisait même le réconfort d’une amitié. Car c’est avant tout un cauchemar de l’erreur que vit le lecteur avec David.
Erreur de l’auxiliaire au développement idéaliste, confronté aux effets pervers des investissements au long terme de la DDC dans le régime hutu: «nous leur donnions le crayon avec lequel ils dressaient ensuite leurs listes de morts (…), nous leur construisions les routes sur lesquelles les assassins roulaient vers leurs victimes». Erreur de l’amant égaré dans la «grande baise» avec Agathe, Rwandaise étudiant à Bruxelles et que le génocide transformera, de l’occidentalisée indolente qu’elle était, en militante raciste et cruelle.
Erreurs de l’homme, encore et encore, qui confondra le sauvetage d’un oiseau avec la dignité humaine.Il y a des scènes très fortes dans ce livre, dont le réalisme impitoyable nous rappelle constamment notre animalité: ainsi, le besoin de «faire pipi» vient brutalement couper une séquence picturale de fuite sous la lune. Du quotidien bureaucratique aussi excitant qu’un «enterrement protestant» du début, jusqu’aux visions apocalyptiques des dernières pages, dans lesquelles David regarde la pluie transformer un camp de réfugiés en «bouillie puante et merdeuse», les phrases sont lourdes, le parcours intense. Mais parfois un peu décousu: des transitions mal amenées, certaines inconsistances trop obscures du protagoniste, sans diluer la force politique, nuisent à la cohésion stylistique du roman. Pourtant les errances inexpliquées du récit de David expriment peut-être l’essentiel: l’incompréhension est fatale. Aux relations entre l’homme et la femme comme à la sincère ambition de quelques Européens d’instaurer, en Afrique, la «justice universelle».
M. R.
Lukas Bärfuss, Cent jours, cent nuits, traduit de l’allemand par Bernard Chartreux et Eberhard Spreng, L’Arche, 2009, 224p.