Demain

Récit inédit de Fabrice Pataut
(avec des dessins originaux de l’Auteur)
UN
Ils étaient libres, ils avaient conquis, leur regard pouvait porter loin devant et ne jamais buter contre l’horizon pour peu que tel fût leur désir ; c’est ainsi qu’Irène comprenait l’intimité qu’ils avaient patiemment acquise avec les choses du monde, à coups d’exploits éphémères et de victoires silencieuses. Elle se pencha pour effleurer l’eau froide du bout des doigts, sans raison, pour le seul plaisir de faire le geste, un ample geste de semeuse, mais Pierre, toujours attentif, le lui interdit d’un sourire du coin des lèvres et elle s’empêcha de fléchir la nuque et le torse en signe d’approbation, sans rien dévoiler de la façon dont il l’avait convaincue, comme autrefois dans l’eau du bain ou à la proue du voilier au-dessus des remous froids et tenaces du Pacifique : ici pour éviter d’avoir du savon dans la bouche, là pour ne pas tenter les prédateurs dont Pierre savait tout. Car Pierre était l’homme des solutions raisonnables, et ils allaient et venaient en grand nombre sous la coque, ces monstres féroces. Les carangues, curieuses comme des chiots, mouchetées ou royales, les murènes grises, toutes sortes de bêtes intelligentes et dangereuses… L’eau sauvage n’est jamais sans risque, Irène le savait aussi bien que lui mais d’un savoir livresque, à la manière d’une jeune fille de son époque ; c’est pourquoi, maintenant que le siècle était passé depuis seize ans, elle la confondait volontiers, quoique par jeu, avec celle, tiède et opaque, des tubs.
Elle garda la tête droite sans effort et remit les paumes à plat sur le tissu de sa robe comme on les laisse sur un cahier ouvert quand aucune correction n’est plus à craindre. Un goût de bulle savonneuse glissa sur ses gencives, une mince tache noire fila droit devant elle sous l’eau menaçante en direction de la mer — souvenir du bain, souvenir des Marquises. C’était un juste retour des choses que ce rappel des peurs anciennes apprivoisées par la prudence de Pierre, soutenue par ce chemin inattendu d’une carpe ou d’une truite convoquée par une nature complice. Irène aurait voulu l’embrasser, le remercier pour chacune de ces choses d’hier si bien faites, justes et pondérées : poissons nacrés dessinés à l’échelle dans son cahier d’école, photographies de l’océan prises au lever du jour avec le Leica du grand-père Jérôme, passage du gant gonflé d’eau claire sur les tempes — choses du bain, de la nage en mer et de la voile —, et le remercier plus encore si c’était possible pour ce poisson d’aujourd’hui, long et gras, qui filait à ses pieds dans l’eau sale bien qu’il n’en fût nullement responsable. Elle n’osa pourtant rompre le silence qu’ils avaient mérité au terme d’une longue journée de marche. L’eau était devant eux, noire et tachée d’argent en cette première nuit d’été, mouchetée de marques blanches qu’on aurait pu prendre de loin pour des mouettes posées en équilibre dans le creux des petites vagues de juin. Elle partait de sous leur ponton, faussement plate et silencieuse, glissait lentement sur les côtés pour remplir le bassin, allait de l’avant et se perdait dans la grande nuit lagunaire. Ils pouvaient aller au-delà, bien au-delà encore en la prenant pour guide. Pierre aurait pu vouloir lui donner cela en cadeau bien qu’ils eussent été partout, goûté tous les lits, écrasé l’herbe de tous les champs, profité des refuges de basse montagne lorsqu’il faisait froid au dehors d’un bout à l’autre de l’Asie, bien qu’ils se fussent glissés sous des draps aussi épais que des couvertures, tièdes et repassés comme des mouchoirs de soie, et eussent senti tour à tour, parfois dans une seule et même journée tant le monde était généreux et l’argent facile, la chaleur du foin fané par les journaliers et la raideur bienveillante des taies empesées par les bonnes. Maintenant qu’il fallait se laisser vivre pour quelque temps encore et surtout ne rien négliger en termes de promesses à venir et de rétributions d’usage, Irène tenait à ce que cet optimisme fût envisagé avec le flou des départs inopinés, mais en plein accord avec les petits calculs dont Pierre avait le secret depuis le temps des culottes courtes.
Des culottes ? Non, réfléchit-elle. Depuis bien avant, depuis la première fois où, du creux des bras de sa mère penchée au-dessus du berceau, elle avait dû — c’était certain — observer ses grands yeux délavés. Geneviève s’était à peine courbée de façon qu’Irène ne régurgitât pas, et Irène s’était tenue le dos bien droit devant le grand panier en rotin de Polynésie « pour voir son double de ses propres yeux ». Autant dire que Pierre calculait depuis la nuit des temps. Il n’y avait aucune odeur de terre là où ils étaient aujourd’hui, assis côte à côte au bord du quai, ni même de boue ou de vase, pas un seul relent d’égoût. Les bancs de roseaux qu’on pouvait distinguer au loin en plissant les yeux ne bruissaient pas, leur respiration était si douce que l’eau silencieuse avait repris ses droits sur tout l’espace. Une tierce personne qui serait passée le long du quai aurait pu croire que son rebord en pierre blanche d’Istrie avait disparu pour la seule raison que l’eau, toujours imprévisible, lunaire en plus d’un sens, s’était mise à monter sans prévenir, par jeu, fantaisie, inconséquence nocturne. L’attitude était familière et partagée après des années d’apprentissage : ils pouvaient rester de très longs moments tout indifférents à l’environnement, qu’il fût champêtre ou citadin, humain, animal ou végétal, qu’il s’agît du décor frivole rêvé du plus profond sommeil ou celui, fonctionnel et éphémère, des halls d’hôtels étoilés et des préparatifs. L’indifférence n’était jamais feinte ; il la préféraient à l’attention encombrante d’autrui, l’intérêt des tiers pour leur couple pêchant par flatterie ou simple maladresse en ce qu’il les séparait pour un moment. Chacun de ces errements venus de l’extérieur n’avait-il pas été une douleur ? Irène et Pierre auraient bien pu n’avoir qu’un seul nom et une âme unique à peine fendue en deux comme une orange qu’on commence à ouvrir.
Une église sonna la première heure du matin. Pierre crut reconnaître la cloche du campanile de Sainte-Eufémie. C’était improbable, mais il aimait cette église qui avait dans son esprit la taille d’une chapelle. Il se tourna vers Irène et lui sourit en poussant de l’index un caillou dans l’eau. Lui aussi pensait à cette matière dure et souple du berceau à roulettes. Ils l’avaient conservé dans la cave de l’appartement de Paris, et Pierre descendait le regarder de temps à autre sans prévenir pour le pousser du pied, ou bien pour soulever la poussière grise en soufflant sur le tissu encore tenu au cannage par de petits nœuds serrés comme des nœuds plats de lacets.
Irène baissa la tête pour regarder le caillou tomber. Curieusement, l’eau noire ne bougea pas, comme si la pierre avait été aussi légère qu’une plume ou la lagune faite d’une huile épaisse. Elle aurait voulu savoir, être rassurée comme autrefois avec poissons et savon, soit en passant une paume arrondie dans l’eau pour récupérer le caillou, soit en la laissant filer entre ses doigts. Peut-être avait-elle imaginé ce geste et cette chute. Après tout, elle s’était mise par osmose à penser à tout autre chose : au berceau, justement, à son tissu Vichy jaune pâle et à son voile, fait dans la même matière, qu’on pouvait tirer pour faire de l’ombre jusqu’aux pieds le long d’une tige curieusement souple en bois de palmier. Là, au fond de cette petite coque protégée du bruit des pas, des va-et-vient et des portes claquées par les vents pluvieux d’Aquitaine, Pierre se donnait tout entier au sommeil fondateur des nouveaux-nés comme il se donna plus tard au même sommeil exactement dans les bras pleins d’Irène, par des vents menaçants, porteurs de mort et, dans leurs impalpables anfractuosités aériennes, d’une malveillance dont on lisait l’effet d’épouvante sur les visages. Du fond de ce sommeil sans trouble, Pierre préparait leur lendemain dans ses détails les plus inattendus, avec une précision parfois comique et il fallait qu’Irène introduisît dès le réveil une part de hasard — calculée, pour le coup, c’était son paradoxe — afin que la vie, facilement ennuyeuse, leur parût au moins un peu fantasque. Drôle. Risquée. (Quoique l’élément du risque ne manquât pas de se manifester souvent sans leur concours et à leur désavantage, malgré les manipulations féminines en faveur d’un imprévu qui devait reproduire la tranquilité maternelle de leurs chambres jumelles de Bordeaux.)
C’était une habitude que d’examiner ainsi leur départ dans la vie, d’y réfléchir chacun pour soi au même moment sans avoir à s’en ouvrir. Ils s’y appliquaient lorsqu’ils revenaient à tel ou tel port devenu familier. L’examen faisait partie du voyage, le voyage lui-même prenait des allures de retour aux sources. La mère d’Irène avait été une femme remarquable pour son époque. Elle avait pris sa fille dans ses bras ce jour du premier regard parce qu’elle aimait sentir sa chaleur contre son sein, parce que la chaleur lui manquait cruellement depuis longtemps avant la grossesse. La difficulté d’Irène à trouver le sommeil avait été la meilleure des excuses, les cris de Pierre dans la pièce voisine l’occasion de rire d’une épouvantable cacophonie à l’étage des enfants, un vacarme strident que sa mère à elle n’aurait certainement pas supporté. Si la mère d’Irène avait hurlé aussi fort au même âge, Madame Thomazeau aurait fait monter la nourrice et exigé qu’on lui portât sa verveine au fond du jardin pour qu’elle ne fût point dérangée par sa fille. Elle prononçait rarement son prénom — Geneviève —, disait plutôt « Viens ici me voir » ou alors « Referme bien la porte », sans laisser l’arôme d’amande et la mollesse pâtissière du prénom adoucir ses ordres. À l’instant du pencher au-dessus du berceau jaune, cette fille rarement nommée avait déjà décidé qu’elle partirait avec son enfant. Avec son Irène. Aux Marquises, peut-être sans le père, avant l’école obligatoire, au moins le temps de la petite enfance, dans la propriété familiale à laquelle Irène aurait droit un jour. Les hommes comptaient peu dans la famille Thomazeau : le père de Geneviève, tout comme son mari, n’existaient que comme géniteurs et financiers au service d’un gynécée réparti sur plusieurs méridiens et parallèles.
Pierre avait souvent fait remarquer que cette première séparation avait été déchirante. C’était dit sur un ton moqueur et il s’adressait alors à des couples d’étrangers qu’Irène et lui connaissaient à peine parce que la femme — légitime ou non, maîtresse officielle, amie de passage, peu importe, la question était toujours féminine — demandait invariablement « s’il y en avait eu beaucoup d’autres comme ça, des séparations ». Et ces gens de toutes sortes, rencontrés au hasard d’une villégiature ou d’une invitation s’amusaient à l’unisson, par couples — par paires d’imbéciles — de sa réponse péremptoire comme d’une bizarrerie anachronique, inquiets en réalité de ce qu’on pût « se connaître depuis le berceau et quand même rester ensemble », comme si seule l’amitié ou un intérêt familial et financier eussent été à même de soutenir l’épreuve du temps. L’épreuve destructrice, c’était sous-entendu, émaillée de pièges et de faux-semblants. Irène y répondait par un massage des doigts, histoire de leur redonner la souplesse perdue à ce contact imprévu, puis des ongles seuls, par de petits mouvements secs qui signifiaient qu’elle était en réalité débarrassée depuis longtemps de telles âneries, convenues et bourgeoises, de leur poussière néfaste. La petitesse du monde lui glissait dessus sans même qu’elle s’en rendît compte, avec la facilité d’un vent tiède. Rester ? Pour écarter quelle envie de quel départ ? Pour conjurer quel péril ?
La nuit, au contraire, leur était favorable, surtout lorsqu’elle promettait d’être profonde, défaite des hommes et libérée de l’écho de leurs conversations, rendue à elle-même pour qu’elle pût étendre sans contrainte son empire sur toute chose aquatique et terrestre ; en l’occurrence — à l’endroit où ils se trouvaient ce juin-là — sur un mélange de matières solides et liquides habité de hérons, d’aigrettes, de ragondins et de pipistrelles. Irène se demandait combien de temps ils allaient rester. Non pas qu’elle voulût partir. Ils avaient loué pour un mois. Ils auraient pu s’établir là où ils étaient jusqu’à la fin sans jamais plus bouger. La propriétaire n’y aurait point redit. Depuis le temps qu’ils revenaient, madame Zaffo gardait chez elle un nombre conséquent de livres français, et aussi les manteaux d’hiver apportés le premier décembre qu’ils étaient arrivés chez elle, impossibles à fourrer dans leurs valises pleines de cadeaux le matin du départ. Elle les avait rangés à son étage de manière qu’ils pussent « voyager léger» s’ils décidaient de profiter d’un autre hiver. Elle réitérait au téléphone l’invitation pour les jours froids presque en chantant, à chaque nouveau voyage, quelle que fût la saison, d’un petit air malin qu’on lui connaissait si bien qu’il faisait sourire à distance avenue Vélasquez. Alors — et il ne semble pas que cela fut le fruit d’une décision, pas même superficielle ou négligeable — Irène poussa à son tour un caillou dans l’eau. Une sirène retentit à l’horizon, qui n’annonçait pas la montée des eaux, beaucoup plus tardive, d’octobre et de la Toussaint, mais le passage d’un paquebot de croisière, et ils se levèrent parce qu’il était tard. Pierre connaissait par cœur le chemin le plus court mais préférait déambuler. Ils marchèrent côte à côte le long du quai en faisant parfois, pour en rire, de belles enjambées, puis, avec retenue, le long des ruelles perpendiculaires qui imposaient au contraire la lenteur, presque au hasard alors qu’ils auraient pu tracer une carte de leur territoire avec une précision insoupçonnée des autochtones. Dans cette ville inconsidérément prégnante et inspirée, piena di cose, pleine de choses, et pour ainsi dire encombrée de détails redondants, d’anecdotes contradictoires, d’historiettes et de tiroirs secrets, ils se sentaient libres comme on peut se sentir hissé haut sans vertige en traversant le bush australien plat et dur, pelé par endroits, recouvert de sa fine poudre rouge. En cette belle saison, Irène peuplait volontiers Venise de barbares et de cannibales, Pierre de saints, d’ermites et de prophètes. C’était pour jouer et entre eux deux. Toutes sortes de remarques déplacées étaient destinées à un usage ludique et privé : à propos d’un jeu des matières ou d’une forme observés dans une frise, ou plus bas dans une plinthe, peut-être à l’angle d’un meuble de maître du musée Correr ou dans la boursouflure d’un mur de cuir gaufré leur rappelant le bois flotté, l’écorce, le raphia. Choses lisses bien qu’inscrites ou tressées, merveilles sans rigueur de l’enfance au Pacifique. Souvent, aussi, ils s’amusaient à comparer différents genres de nuits, mais pour se féliciter de n’en préférer aucun, chaque obscurité affichant ses qualités intrinsèques, chaque nuit particulière se trouvant brutalement opposée à toutes les autres quant au matin qui lui fait suite. Inscrit sur une feuille d’or ou plutôt griffonné à la va-vite sur un méchant papier bis qu’on soupçonnait ardoise juste avant l’aube : c’était imprévisible, le matin. Que feraient-ils demain ? Quelle serait l’humeur au réveil ? Qui se lèvera le premier, se demanda Pierre en respirant si fort que le vent tiède monté d’Afrique lui tourna la tête ? Il ne voulut rien laisser paraître de cette question et assura son équilibre de manière artificielle, en faisant semblant d’avoir à poser les pieds sur les dalles sans mordre aux interstices. Cette marelle mensongère le conduisit à un banc et il s’y assit seul, non pas pour se reposer, mais, avoua-t-il en répondant à la question muette avec tout son souffle, pour en profiter encore. Irène l’eût jugé diablement hypocrite si elle avait découvert la supercherie.
Demain…
« Rentrer » n’était pas un terme courant de leur lexique personnel. C’était une expression plutôt rare, un mot technique qui renvoyait aux calendriers et aux horaires. « Rentrer à Bordeaux » aurait pu être considéré, ou encore «rentrer à l’Île Marchand». Mais c’était parce que le vent pouvait les conduire à l’un ou l’autre lieu sans distinction. L’amour de la paresse qui avait vaincu dans leur esprit l’idée pompeuse de la France fille aînée de l’Église, incarnée là-bas selon la grand-mère d’Irène par la minuscule mais non moins cathédrale Notre-Dame des Marquises, et tout près d’eux, à Bordeaux, à deux cent mètres à peine de sa maison, par l’imposante et véritable cathédrale Saint-André, ce goût grave et malicieux pour l’oisiveté reprit incontinent ses droits. Irène dit tout haut qu’elle voulait rester plus longtemps, Pierre caressa le bois craquelé du banc pour qu’elle vînt le rejoindre et ils décidèrent de prolonger leur séjour pour une durée indéterminée. « Restons autant que nous le voulons », affirma Pierre d’une voix un peu faible. Le Temps recouvert d’or, à qui ils avaient offert leur amour et leur argent sans autre engagement que celui de tout dépenser, leur devait quelque chose, c’est ainsi qu’ils comprirent ce parti inattendu l’instant d’avant. Rester. Le Temps leur devait en retour, non pas un sursis, ni même une quantité indéfinie de durée, mais une suspension abstraite. Ils ne pourraient en venir à bout tant les placements fructifiaient sur les marchés et leur amour se voyait sans cesse offrir de nouveaux prétextes. La promesse du Temps était depuis longtemps renouvelée n’importe quand et n’importe comment, au petit bonheur la chance, comme il sied aux insouciants. Là où ils étaient aujourd’hui, ils voulaient plus encore, par vanité et gourmandise. La grand-mère d’Irène, inquiète, tellement avare du prénom de sa fille, avait eu la certitude qu’ils réussiraient « à tout claquer ». Ces mots, dans sa bouche, étaient fielleux, pleins d’un mauvais poivre. Elles les avait glissés quitte à souffrir de leur vulgarité, comme ces gens qui préfèrent partager un mal dont ils sont responsables avec ceux qu’ils ont décidé de punir par la grossièreté, plutôt que de les voir goûter un bonheur qu’ils pourraient mépriser à distance en ne sacrifiant point leurs bonnes manières. Elle les avait retenus entre la joue et le palais à la manière de bonbons surnaturels qui n’auraient jamais pu fondre. Irène les avait entendus une seule fois, susurrés derrière une porte le jour de ses dix-huit ans, à Bordeaux, rue Montbazon, mais néanmoins assez fort pour qu’elle pût en prendre connaissance, et cette idée perverse du mal qu’on distille avec les apparences du secret pour que les inquiets s’en imprègnent aussitôt derrière des battants faussement fermés l’avait fait pleurer. Madame Thomazeau était ainsi faite que ses biens en Aquitaine et aux Marquises, quoique considérables, avaient dans sa tête endolorie la fragilité des pâtisseries au beurre. Lorsque le père de Pierre était parti à son tour en Polynésie pour s’engager dans les affaires, un mois à peine après le départ de Geneviève, madame Thomazeau l’avait convoqué. Elle avait vu ce départ-là d’un œil très favorable : un homme marié, issu d’une famille respectable, qui avait l’intelligence de laisser épouse et enfant à la métropole pour traiter là-bas les mains libres, aurait tout le loisir d’espionner pour son compte. La grand-mère d’Irène connaissait par cœur la langueur factice des îles, l’ennui qui s’installe au creux des soirées tièdes, l’ivresse des bleus de minuit et de cobalt mélangés à la frontière de l’eau et du ciel. Elle ne s’y était rendue qu’une seule fois, mais son idée des abus de la vie sociale de Tahiti et des Marquises était précise. Son mari les lui avait enseignés et elle bénéficiait depuis sa mort des avantages de la mémoire à distance par ouïe-dire, bien plus fidèle à ses yeux que l’observation directe. On les commentait dans sa famille depuis la victoire de Dupetit-Thouars sur les Anglais. Là-bas — et peut-être seulement là-bas pensait-elle par vanité — chacun savait ce qu’il fallait savoir, ou tout au moins le soupçonnait. Ou alors rajoutait-on un petit mensonge et prêchait-on le faux afin de se rassurer sur des vérités usées jusqu’à la corde. Le parfum de scandale était une chose lointaine dont Paris façonnait les apparences et qui tournait en rond pour y gonfler sur place. Alors qu’aux antipodes, c’était facile. On n’y gardait jamais un secret plus de deux jours. La Polynésie française lui appartenait un peu, son salon de Bordeaux lui rendait hommage par l’exposition disparate et plutôt charmante de conques nacrées rangées dans une vitrine de la plus petite à la plus grande, de nacelles de pêche, de masques rituels et d’une peinture maladroitement imitée de Gauguin pour faire « moderne », c’est-à-dire choquant. Un peigne en bois de palmier pendait au-dessus de la porte du vestibule, à la manière d’une croix de baptême ou d’un miroir de poche accrochés trop haut pour cacher une tache ou une fissure. Lorsque la mère de Pierre rejoignit son mari avec son enfant, madame Thomazeau voulut y voir une trahison, pire encore que celle de sa fille. Pierre avait un an.
Irène revint avec eux cinq ans plus tard, sans ses parents à elle, pour ses premières vacances d’été françaises. Madame Thomazeau, qui n’avait tout ce temps reçu qu’une seule lettre, d’ailleurs assez vague et convenue, perdue dans un flot de cartes postales, comprit très vite que les deux petits avaient grandi ensemble dans un sens contraire à ses attentes. Elle recommanda les Berges du Lac en matière de plage bordelaise le lendemain de leur arrivée mais ne daigna jamais les y accompagner. Elle rappela à la gouvernante en affectant un ton distrait que les paréos étaient dans la malle jaune.

Le campanile sonna la demi-heure et Pierre dit « Rentrons, maintenant ». Il fallait traverser le canal de la Giudecca, descendre du vaporetto à Saint-Marc et continuer à pied pour retrouver l’appartement de madame Zaffo dans le quartier de l’Arsenal, ou bien prendre un taxi devant la Piazzetta. Encore devaient-il passer un pont et remonter la très longue calle del Corder jusqu’au quai pour rejoindre la station la plus proche de Sainte-Eufémie. Elle eut peur de la distance qui la séparait encore de cette rue pourtant si familière, l’île de la Giudecca étant l’un des premiers quartiers de Venise qu’ils avaient visité jeunes mariés après le service militaire de Pierre. Les mots dansaient dans la tête d’Irène, trop de mots à la fois, des mots du temps des Marquises, dans une immense confusion. Elle eut peur d’avoir à marcher si loin et même d’affronter les murs froids et humides, les portes closes avec leurs rangées de sonnettes en cuivre. Pierre pouvait-il le comprendre ? Il allait droit devant, sans se retourner, vers la rue bordée de maisons hautes et étroites. Était-il donc l’homme des labyrinthes ? Il s’engagea sur le pont. Était-il également l’homme des passerelles ? Le pont avait des marches, il les gravit avec une aisance inhabituelle. Elle traînait les pieds, comme les enfants qui imaginent en toute sincérité avoir quelque chose de plus important à faire que de se presser. Était-il à présent l’homme des escaliers ? Jamais elle n’avait assisté à autant de transformations aussi inopinées, radicales, contradictoires. Elle les récapitula dans l’espoir de mieux cerner ce Pierre inattendu et il lui apparut comme un automate programmé pour exécuter trois tâches : avancer droit et vite, bifurquer militairement sur la gauche, lever les jambes pour gravir deux à deux les marches plates et profondes — difficiles, difficiles — et surtout (comme quoi l’automate en était un et avait renoncé aux devoirs comme aux émotions) ne pas s’arrêter, ne pas se retourner, ne pas se demander si Irène suivait. Elle aurait pu penser à ces couples moqueurs qui doutaient qu’ils fussent restés ensemble autrement que par lassitude ou intérêt. Si l’un d’eux les avait observés en ce moment même, la femme aurait pu imaginer l’abandon dont Irène était victime et l’homme sourire en pensant que le marcheur avait une autre créature en tête pour s’éloigner avec tant d’indifférence. Mais Irène avait trop de morgue et d’héritage familial pour comparer son couple à aucun autre. Elle avait dans la tête tous les mots qu’il fallait pour garder Pierre auprès d’elle, pour le ramener en arrière par la pensée, lui faire redescendre ces marches affreuses et l’obliger au demi-tour. Ces mots différents qu’elle aurait volontiers prononcés en silence ne l’avaient jamais été, par aucun autre couple. Ils n’étaient pas pour autant cérémonieux. Ils n’avaient ni patine, ni usure, ni histoire, et si on lui avait demandé de les dire maintenant qu’elle était seule au bord du quai et que Pierre devait s’être engagé dans cette horrible calle del Corder, elle aurait pu décrire leur couleur ou dire quelle était leur odeur lorsque le vent se levait, parler de la consistance qu’ils prenaient en fondant dans la bouche. Car c’était là, finalement, qu’ils résidaient, mais pour disparaître aussitôt, à la différence des mots méchants de sa grand-mère. Une image ancienne lui en donna la confirmation.
Pierre, assis sur l’un des paréos de madame Thomazeau — ceux qu’on sort de la malle en bois l’été et qu’on étend dehors le soir après les avoir rincés —, regarde sa mère s’avancer vers les vagues à la plage des Berges du Lac en août 1938, l’année de leur premier retour à la métropole. Le père de Pierre est resté quelques mois de plus pour affaires ; de même les parents d’Irène, mais eux pour une durée encore indéterminée. Elle sera courte, Irène doit maintenant rentrer en classe de onzième — à Paris ou à Bordeaux, rien n’est encore décidé. Geneviève et son mari se disputent souvent à ce propos. Le goûter est préparé sur des petites assiettes bleu roi à bords dorés. C’est l’œuvre de Françoise, la gouvernante. Pierre écarte les quartiers d’orange et l’idée lui vient lorsqu’il en tient un entre les doigts — luisant, orange, il va sans dire, mais pour le coup très orange, sanguin, violet au centre et sans les petites peaux blanches désagréables à mâcher —, l’idée lui vient d’écarter pareillement les lèvres d’Irène qui sont elles aussi gonflées à la manière du fruit et portent leurs propres traces violacées aprèsla vigueur du bain froid. Quelle ravissante orange, cette Irène. Il colle dessus ses lèvres à lui, pleines de sel, sèches, un peu trop sèches. « Oh ! » fait doucement Irène. «Encore ?» demande Pierre. « Oui », répond Irène, six ans. «Alors, c’est bon l’orange ?» fait la mère de Pierre en secouant ses cheveux mouillés au-dessus d’eux. «Très», réplique Irène avec assurance, fière, indifférente au pouvoir des adultes. Comme elle est militaire, tout à coup, et Pierre remarque qu’elle n’a pas rouvert les yeux pour répondre. Lorsqu’elle le fait enfin l’instant d’après, ils sont d’un vert merveilleux, d’un vert profond ensoleillé de minuscules points jaunes et Pierre ne sait rien faire d’autre que regarder ses pieds pour ne pas être aveuglé. Ceux d’Irène sont là tout contre, leur plante uniformément rose fait face à celle de ses pieds, tout aussi roses. Non par rosissement mais roses d’origine, à vrai dire à peine teintés, faits pour la marche feutrée. Les yeux, les pieds — Irène est partout, où qu’il se tourne. En haut, en bas, sur les côtés. C’est un drôle de bonheur parfait. Le Pacifique est dans leurs veines. Jamais ils ne seront libres de cette attache. Esclaves de l’eau, des grands fonds, des prédateurs, de la nudité.
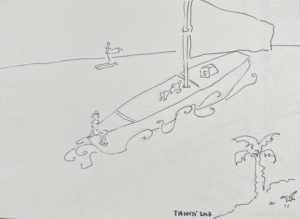
Irène cria — sans force — son nom, Pierre, au goût sucré d’orange sanguine. Aucun autre mot n’aurait pu mieux la satisfaire en cet instant, ni posséder un tel pouvoir incantatoire et descriptif. Elle n’avait jamais fait l’expérience de l’impuissance haussée à ce degré de perfection. Irène n’avait rien trouvé d’autre pour le ramener à la raison et ne trouvant rien s’était réduite à un bruit. Leur destination lui sembla plus incertaine encore. Et s’ils n’atteignaient jamais l’appartement de la calle Erizzo ? S’ils restaient indéfiniment perdus dans les petites rues étroites et fraîches de la Giudecca …? « Perdus » était le mot juste. Perdus pour la première fois, jetés dans les limbes ou quelque lieu mythologique sans projection cartographique. Elle aurait pu trouver d’autres exemples si elle avait eu la présence d’esprit de retourner s’asseoir sur le banc pour réflechir plutôt que de chanceler sans but. Pierre n’aurait pas manqué de revenir et elle aurait eu le temps de rappeler au moins ceci à sa mémoire : perdus en mer, au large de la Pointe Vénus, à Tahiti (Geneviève avait garé sa quatre chevaux au parking du phare, elle était montée pieds nus sur le capot et avait pris ses jumelles pour scruter l’horizon) ; perdus entre Gobi et Dengkou dans le désert mongol (quelqu’un, une fois de plus, était intervenu, et le danger, là encore, s’était enfui). Pourquoi Pierre tardait-il ainsi ? Lui était-il arrivé quelque chose ? Bien qu’il eût depuis longtemps passé les marches, Irène se prit à les imaginer glissantes. Mais pourquoi glisser ? Quelle idée… Sans eau de pluie, au début de l’été, avec partout la pierre sèche et salée qui assure les pas. Il restait la rue étroite. C’était pire encore. Pierre ne pouvait-il s’y perdre ou y faire une mauvaise rencontre ? Il suffisait d’une ombre tapie dans l’embrasure d’une de ces portes aux sonnettes brillantes, d’un chat qui rôde, d’un présence animale… D’un monstre énorme et impur. Du taureau blanc, tiens, autrefois envoyé par Poséidon sur les rivages de la Crète pour la gloire du roi Minos, avec Pasiphaé qui s’en éprend et Dédale, ingénieux, qui lui fait une belle vache blanche en fer gainée de cuir à l’intérieur pour qu’elle s’y cache et satisfasse dans le confort sa passion contre nature. Pasiphaé, salope antique, accroupie dans la fausse bête, sa fente de chair contre la fente de fer, en position pour recevoir le taureau sauvage.
DEUX
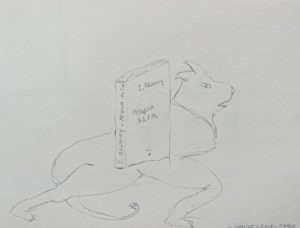
« Elle dort encore », dit madame Zaffo en observant le petit Minautore en bronze sur la table basse.
Pierre partit déposer les encornets dans l’évier et revint s’asseoir face au canapé, dans le fauteuil réservé à ses lectures.
« C’est votre fauteuil », commenta-t-elle avec un joli sourire.
Il y avait, dans la rue juste derrière Notre-Dame-des-Marquises, bien avant la construction de cette vilaine cathédrale qui plaisait tant à madame Thomazeau, une librairie tenue par une femme à laquelle madame Zaffo ressemblait étonnamment lorsqu’elle faisait le bien, eu égard aux yeux et à la bouche. Comme la dame de la librairie du Globe, elle souriait en exposant avec générosité toutes ses dents, parfaitement blanches, alignées derrière des lèvres rehaussées au pinceau. Elle avait veillé sur Irène toute la matinée comme l’autre veillait la nuit sur ses livres pour en trouver un à confier à Pierre le matin venu.
« Nous avons bien trop marché », dit-il en pensant soudainement à elle.
« Jusqu’au bout de la Giudecca ? Vraiment ? À cette heure-là ? »
Madame Zaffo examina de nouveau la petite statuette posée entre eux deux. Le cou était sans conteste celui d’un homme très jeune, pas du tout le cou large et épais d’une bête adulte. On aurait plutôt dit la figurine d’un athlète qui aurait dû passer par punition un masque démesuré. L’adolescent était en passe de tomber devant Thésée, mais ses deux genoux, réunis et parallèles, fléchissaient ensemble de manière qu’il avait l’air de s’abaisser en signe de respect ou de pénitence plutôt que de mourir comme le doivent les créatures difformes et sanguinaires, en posant d’abord une patte, puis l’autre, avant que la croupe, lourde et sans force, s’affaisse d’un coup aux pieds du héros.
Pierre devait convenir qu’ils avaient pris un risque ridicule. Il ne dit rien de son propre étourdissement, mais c’était exactement comme si madame Zaffo savait et s’abstenait par courtoisie d’un commentaire inutile.
« Tu n’as pas beaucoup dormi, mon garçon », disait la dame du Globe en glissant un volume dans sa poche à la première heure. « Qu’est-ce donc qui te tient comme ça toute la nuit ? C’est pas déjà les filles, à ton âge ? » Ou bien, si le livre était ce qu’elle appelait avec candeur « un vrai livre », comme d’autres parlent avec dévotion de « grande musique », elle le déposait sur sa paume ouverte, avec le titre dans son sens à lui pour qu’il pût le lire à voix haute, et observait sa première réaction. Un titre imposant ou énigmatique suggérait qu’on allait bientôt réfléchir et faire des découvertes. Les livres qui tombaient directement dans sa poche étaient faciles et récréatifs ; ceux qui attendaient un instant encore au creux de sa main et pourtant comme en suspens dans l’air tiède de la boutique étaient investis d’une puissance particulière. La magie de la difficulté leur donnait une odeur ambrée et poussièreuse qui collait aux doigts pour longtemps.
« Vous avez eu bien de la chance que l’ambulance soit arrivée aussi vite, ajouta madame Zaffo, elles tardent un peu, parfois, surtout en pleine nuit. »
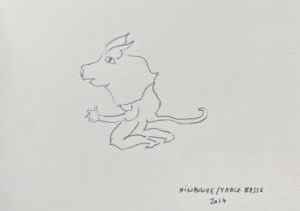
Pierre s’était au contraire toujours étonné de la vitesse avec laquelle elles fendaient l’eau en creusant un sillon profond sur leur passage.
« Elle n’a pas bougé. Je lui ai donné un verre d’eau il y a une heure quand vous êtes parti faire les courses. Elle s’est rendormie tout de suite. Tout ira bien, vous verrez. Il faut juste du repos. C’est ce que le docteur a dit. »
Elle glissa l’ordonnance sous la statuette, puis se ravisa.
« Je peux prendre ce qu’il vous faut à la pharmacie si vous ne voulez pas redescendre. Je dois y aller pour mon Baptiste. »
Cette amabilité toucha Pierre, notamment que le prénom du mari fût prononcé avec tant de naturel sous sa forme française, sauf que madame Zaffo, habituée à Battista, avait buté sur le p pour faire plus vrai, se risquant à un « Bapetiste » ravalé sans embarras.
Souvent, Pierre repassait par la librairie après être allé à l’épicerie ou au pain et la dame du Globe était toujours là au milieu de son invraisemblable fourbi. Sa peau était parcheminée, comme recouverte d’une poudre ancienne, ses yeux bleu clair brillaient au fond de la pénombre. Elle lisait interminablement, la porte ouverte sur la rue inondée de soleil, comme elle faisait chez elle à l’étage, la nuit venue, à la lumière de la lune. Allait-on la déranger en passant le pas de sa porte ? Tout le monde le pensait et chacun s’en moquait éperdument.
« Je lui ferai un peu de lecture cet après-midi », dit Pierre en regardant la statue.
« J’ai des livres en français », répondit vivement madame Zaffo, puis elle ajouta par politesse « bien sûr, vous avez les vôtres ». Elle voulait parler des nouveaux qu’ils n’avaient pas certainement manqué d’apporter, par opposition à ceux qu’elle conservait d’une année sur l’autre, à l’instar des manteaux d’hiver, dans son appartement du premier étage. Mais quand la dame du Globe disait « vous avez les vôtres », c’était une autre histoire, d’abord parce qu’il semblait à Pierre qu’elle recourrait à un voussoiement hors de propos. Et puis, pour effacer cette première impression, il lui substituait le sentiment qu’elle le renvoyait dans ses pénates, sans méchanceté, avec une sorte d’admiration craintive.
« Vous les Castaing, vous avez sûrement vos propres bouquins », disait-elle, sous-entendant par bonhommie et fierté commerçante qu’ils ne valaient pas les siens, ni même — et c’était là que sa petite phrase lancée comme une fléchette atteignait le centre de la cible — ceux des Thomazeau, qui possédaient une immense bibliothèque dans leur maison de Papeete et une autre, plus considérable encore, dans leur résidence des Marquises. Pierre reconnaissait la supériorité des ouvrages en vente chez la dame du Globe. C’étaient les siens, après tout, plus encore que ceux de son père et de son grand-père Jérôme. Il n’en paya jamais aucun, sans éprouver la moindre gêne, et les lisait en cachette, trop vite, avec une avidité infantile en ces débuts adolescents. Lorsqu’il les rapportait deux ou trois jours plus tard, il lui fallait passer un examen oral. Madame Zaffo lui fit d’ailleurs une proposition semblable, avec plus d’urbanité que l’ancienne libraire des Marquises. Elle présenta l’exercice comme un jeu reposant. « J’en ai un justement, que je voulais… », dit-elle en pinçant les lèvres avec un petit air amusé pour éviter d’en dire plus. Puis elle ne put s’empêcher d’ajouter « … vous faire lire. Vous me direz… », s’arrêtant de nouveau, pleine de pudeur, en guise de conclusion. Elle regardait maintenant par la fenêtre, soulagée et distraite. Le campanile de Saint-François-de-la-Vigne apparaissait comme dans un cadre. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez », fit-elle sans se retourner, « je ne prendrai pas d’autres locataires cette année. L’appartement est à vous. »
Quels mots singuliers. Pierre avait de la peine à le croire. La possibilité lui était donc offerte de rendre hommage à l’idée toute neuve selon laquelle le Temps devait à son couple un répit, une idée née la veille au soir à l’occasion d’une promenade trop fatiguante pour leur âge. Jusqu’à son départ pour le service militaire, il s’était repu de l’idée que la vieille libraire hirsute et folle, avec ses lèvres étrangement pures de vestale antique, resterait pour lui dans sa boutique à la manière d’une femme immortelle. Elle l’attendrait. Il la retrouverait à son retour, non seulement de l’armée, mais de son voyage de noces, de ses vacances à Bordeaux, en dépit des caprices et des hésitations, infiniment dévouée, disponible, et tout serait exactement comme avant. Il s’apprêtait maintenant à se satisfaire de l’idée que son amie de Venise proposait de l’accueillir pour toujours. Là non plus, aucun effort n’avait été requis. Il ne s’était pas battu. Quoi de plus attendu, d’ailleurs, puisque Pierre ne s’était jamais battu pour rien. Et le frisson qu’il s’était donné à lire les vieux livres du Globe ressemblait étrangement à celui qu’il éprouvait aujourd’hui à s’installer chez madame Zaffo, avec ses lèvres un peu trop rouges et son Minautore décoratif. Il avait préféré des volumes jaunis et tachés aux belles éditions originales reliées cuir qu’il aurait dû lire assis dans un bon fauteuil sous le ventilateur de la bibliothèque du grand-père Jérôme. Cette fantaisie lui avait valu quelques piques. Mais qui, aujourd’hui, aurait pu se moquer de la longueur inopinée de son séjour vénitien et d’une lecture recommandée par la bonne madame Zaffo ? Personne. Faute de combattants, bien sûr, mais c’était surtout qu’il avait une fois de plus Irène pour alliée. Irène au même âge avait elle aussi été complice de l’ancienne fée qu’un sort injuste avait puni ; et sa bibiothèque familiale, aux Marquises, était pour le coup un bijou très rare, non pas une bibliothèque bourgeoise comme celle de Jérôme Castaing, mais un vaisseau en bois flotté sur les étagères duquel trônaient les éditions rares acheminées depuis Bordeaux par le grand-père d’Irène.
Madame Zaffo attrapa l’ordonnance d’un petit coup sec, avec deux doigts serrés comme les deux tiges d’une pince à sucre, et tapota la tête en bronze du bout des ongles ; satisfaite du tintement sourd et sans écho, elle descendit chercher le livre quatre paliers plus bas. Quelle drôlerie d’avoir droit à un tel optimisme. La peur froide de la nuit faisait place à une sérénité douce et facile. La veille, il avait retrouvé Irène allongée sur le banc, d’une pâleur terrifiante, murmurant des propos incohérents, et voilà qu’ils pouvaient profiter de l’automne italien, moelleux le soir et baigné pour eux seuls d’une vive lumière bleutée. Irène approuverait un séjour de trois ou quatre mois ; rien ne les empêcherait de bouger un peu : Padoue, Trévise. Ils iraient en train jusqu’à Ravenne, passeraient une journée à Trieste.
Des mots vulgaires étaient sortis de sa bouche, d’abord en français, puis en italien. Les premiers étaient familiers ; c’étaient ce qu’on appelle par pudeur des gros mots, des mots si laids dans la bouche des enfants qu’il leur est interdit de les prononcer à table parce que la politesse est la première expression du respect au fondement des vertus sociales, son abandon un signe de décadence morale. Irène avait dit « prout » et « merde alors » à voix basse. Pierre avait ri, un peu étonné. Elle avait continué en marmonant, sans prêter attention à lui, comme s’il avait finalement décidé de prendre le bateau tout seul à Sainte-Eufémie et que cette résolution lui avait rendu sa liberté. Elle s’était relevée en s’aidant des coudes et avait dit en tendant la nuque pour se faire entendre « et ben vraiment, ben vraiment, j’dis merde alors » sur un ton revendicatif. Pierre avait voulu s’asseoir à côté d’elle pour la réconforter, mais Irène l’en avait empêché en s’étalant à nouveau de tout son long comme une clocharde qui prend ses aises sous le coup d’une immense fatigue. Il commençait à faire frais. Elle s’était râclé la gorge comme pour en éjecter une grosse arête, était passée en italien au registre des organes sexuels sans une trace d’accent. Elle avait pu entendre ces mots dans la rue à l’occasion d’une altercation. Puis elle avait laissé pendre ses bras dans le vide comme si elle avait dû faire la morte au théâtre et ouvert les yeux en imitation des mystiques, les roulant vers le haut pour mieux s’observer du dedans. Sa bouche était sèche, sa respiration saccadée, et elle s’était mise à décrire avec une grande exactitude anatomique les sexes en érection de divers individus dont Pierre avait reconnu les patronymes : monsieur Audibert, le comptable des chantiers Thomazeau, et monsieur Kahiki, le charcutier de la rue des Remparts à Papeete. L’énorme gland de monsieur Audibert était recourbé vers la droite et les testicules du charcutier étaient pleins d’un foutre épais à l’usage de ses clientes. Pierre avait pensé au syndrome de Tourette et à peine avait-il commencé à y réfléchir qu’Irène s’était mise à répéter de nouvelles obscénités de manière compulsive, parfois avec un sourire en coin et un regard vide qui faisait peur. Il l’avait giflée mais elle avait continué en improvisant à toute vitesse une histoire loufoque dans laquelle le sexe de monsieur Kahiki avait la taille d’une « bite de taureau ». Pierre avait alors eu une pensée coupable pour l’Hôpital des Incurables.
C’était la première fois. C’était comme si Irène avait été un moment habitée par un esprit étranger. Elle avait même semblé en convenir un court instant. Son regard s’était éclairé, ses lèvres avaient cessé de pendre, on aurait pu croire qu’elle voulait de l’aide et ne désirait rien tant que retrouver son lit, puis elle était retombée à plat sur le banc sans bouger. De drôles de sons étaient sortis de sa bouche, pleins de crachats retenus, de chuintements et d’aspirations ; les mêmes deux ou trois fois de suite avec une accentuation répétée au moment où sa langue partait cogner contre le palais.
Il n’aurait jamais pu prévoir un tel incident. Si étrange. Dès le premier jour… Pierre s’était dit qu’elle venait de répéter quelque chose en mongol.
« Je le laisse sur la table basse », lança madame Zaffo.
Le livre, déjà, mais l’ordonnance… ? pensa Pierre le temps qu’elle refermât la porte derrière elle, comme si elle était repassée chercher son parapluie ou son porte-monnaie. Comme souvent dans ce genre de situation, Pierre élaborait de suite une vengeance. Il fallait, se disait-il, les mains au fond de l’évier occupées à rincer les encornets visqueux, il fallait, l’idée devenait tout de suite répétitive, rendre à l’ennemi le mal pour le mal. Mais comment ? D’autant plus que madame Zaffo allait revenir avec les médicaments puisqu’elle n’était pas encore passée à la pharmacie. Irène devait les prendreavant le déjeuner. Entrerait-elle une seconde fois sans frapper ? Avait-elle délibérément choisi de remonter tout de suite avec le livre alors qu’elle aurait pu faire sa petite course dans la foulée, le temps que Pierre en finisse avec les logigo vulgaris — le nom latin lui vint à l’esprit —, ce qui lui aurait évité un effort de plus ? Cette manière de combine lui déplaisait. Il remit ses idées en place, prêta un ordre arbitraire à quelques souvenirs anciens, plus vifs que les récents comme toujours à son âge, le temps de creuser la plaie. Pouvait-on concevoir quelque chose de plus irritant ? Y avait-il une conduite plus propre à le faire sortir de lui-même ? Même son père frappait avant d’entrer dans sa chambre, non seulement à l’adolescence où le manque de rigueur dans le travail, le désordre, les réponses évasives à toutes les questions importantes auraient pu l’exaspérer, mais déjà à l’époque de l’enfance où entrer en poussant une porte n’est pas encore une affaire d’état et marque plutôt une saine attention, une crainte de l’accident. Cette délicatesse du joli mouvement des longues mains fines de monsieur Castaing contre le bois de la porte avait formé son caractère sans que son père s’en rendît toujours compte, née qu’elle était d’une peur solide de mal faire. Madame Zaffo n’avait de toute évidence aucun sens de la fragilité des frontières avec autrui, de l’espace du dedans, lequel sembla à Pierre, pour peu qu’on voulût excepter Irène, un sens typiquement masculin. Castaing père avait eu une intuition précise de ce que son fils risquait lorsqu’il était laissé à lui-même. Ce n’était pas vouloir le surveiller toujours. Tout le contraire. C’était plutôt l’entourage qui avait besoin d’être suivi de près, le monde dans son ensemble — imprévisible, méchant, enclin à la faute, toujours passible d’une bonne correction.
Madame Zaffo, gardienne de manteaux et de livres dont elle n’avait que faire, viendrait déposer le sachet de la pharmacie frappé d’une croix de Malte d’un noir profond avec l’air qu’elle devait prendre lorsqu’elle retrouvait son Baptiste chez elle planté au milieu de l’entrée, les pieds nus sur le carrelage même en hiver. Un air double, une fausseté ancienne se cachaient, non pas dans le plissement des paupières qui indiquait en surface une attention constante aux soucis des autres, mais dans le vert clair de l’iris dont on voulait croire par naïveté qu’il trahissait un grand cœur en dépit de sa dureté — un vert pur de toute pitié. Bouffonne et injuste, l’idée allait faire son chemin passé l’heure du déjeuner ; elle circulait déjà dans la fraîcheur bienfaisante de la cuisine où Pierre, les doigts gluants, le cœur gros à l’idée qu’Irène pouvait être beaucoup plus mal en point qu’il n’y paraissait, échauffaudait une théorie sans fondement dont l’effet était de gâcher ce qu’il désirait tant et venait d’obtenir sans effort : rester à Venise le plus longtemps possible. Que n’aurait-il donné pour laisser couler le temps qui restait, fluide et généreux, loin des origines, loin des Audibert père, fils et petit-fils, qui géraient les affaires de sa famille par alliance depuis trois générations, loin de tous les liens tissés par les maisons Castaing et Thomazeau réunies sans qu’il y participât jamais lui-même sinon par son mariage avec Irène ? Rester à Venise — une idée plausible, patiente, raisonnable, qui donnait maintenant du fil à retordre.
Irène se reposait seule dans la chambre préparée par madame Zaffo, à présent délivrée d’un poids qui devait peser bien lourd depuis longtemps si l’on pensait à la violence de ses paroles incohérentes. Il disposa les encornets dans la poêle, côte à côte, comme on fait avec les sardines, et posa un couvercle dessus. Irène prendrait-elle aussi du vin ? Le docteur l’avait très certainement déconseillé. Seuls les pauvres ou les inconscients peuvent croire que l’alcool est bon à la santé. Il sortit une bouteille du réfrigérateur et l’ouvrit. Madame Zaffo en laissait toujours une au frais pour leur arrivée. Elle recommandait qu’on bût le blanc local non troppo fresco ; l’avait proposé dès leur premier séjour et c’était devenu un rite : la bouteille allongée sur l’étagère du milieu, jamais droite dans la porte, pointant vers eux son goulot vert recouvert de plomb. De même aujourd’hui pour ce qui serait peut-être l’ultime villégiature. Irène l’avait dit tout haut dans l’avion alors qu’ils entamaient leur descente sur Mestre : « … et toujours, pour le premier soir, ce blanc délicieux qui pique le bout de la langue. »
Ils étaient arrivés deux jours plus tôt un dimanche en milieu d’après-midi. Le soleil était à peine levé sur l’avenue Vélasquez lorsque le réveil avait sonné du côté de Pierre. Irène l’avait tout de suite éteint. Pierre dormait encore, la tête de profil sur l’oreiller. La lumière filtrée par les persiennes tombait à côté de son bras sur le revers du drap, le cou était tendu et semblait sans ride. Irène resta penchée au-dessus de lui le temps de retirer sa main de la table de chevet mais sans le toucher, en dessinant un arc pour éviter de déranger son sommeil. C’était curieux comme le soleil s’écrasait sur le coton blanc et épargnait le visage de Pierre. Si la lumière était tombée à peine plus haut, s’il avait été sept heures plutôt que six, il aurait plissé les yeux et fronçé les sourcils, murmuré quelque chose et se serait retourné vers elle pour retrouver le sommeil. Le petit-fils Audibert, responsable de l’intendance, avait le chic pour trouver des billets bon marché, des vols en matinée. S’il avait pris leur réservation pour trois ou quatre heures de l’après-midi, comme Irène le lui avait demandé, ils auraient mis le réveil à onze heures et elle aurait manqué la belle lumière du matin. Six heures était donc la bonne heure, et elle profita de ce moment qui s’allongeait et lui offrait Pierre dans son sommeil.
Sa mère lui avait fait un drôle de cadeau, peut-être pas en s’inclinant pour de vrai au-dessus du berceau, mais en affirmant qu’elle l’avait fait. « Je me suis penchée avec toi dans les bras. » Ses paroles avaient eu un goût de mensonge, un goût de faux qui leur avait ôté le droit de convaincre comme si Geneviève avait voulu se donner un rôle important en étant à l’origine d’une position qu’Irène imitait depuis le début : toujours près de Pierre, appuyée contre son bras ou son dos, et même collée à lui dans l’adolescence, mais surtout et longtemps après encore, en surplomb. Geneviève était entrée dans sa chambre avec le bouquet le jour du mariage ; en soulevant le col de sa robe pour lui donner du volume, elle avait dit quelque chose comme « Pierre est plus petit, alors c’est toi qui va devoir te pencher pour l’embrasser à l’église ». Cette remarque incongrue, Geneviève ne l’aurait jamais faite en temps normal, il avait fallu cette occasion unique, et si quelqu’un d’autre se l’était appropriée, Irène aurait lancé une pique bien sentie comme elle savait faire. Mais là, dans la solitude de sa chambre de jeune fille, avec les invités qui attendaient le départ pour l’église en bas de l’escalier, quelques minutes avant qu’elle descendît les marches en soulevant les pans de sa robe et s’exposât enfin dans tout son éclat, Geneviève avait ajouté « tu le fais toujours, tu le ferais même s’il te dépassait d’une tête ».
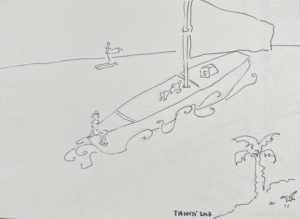
Irène y avait réfléchi pour retrouver des images personnelles qui eussent infirmé les paroles de sa mère. Geneviève avait observé cette résistance silencieuse à l’autorité parentale et ajouté en posant un doigt sur les lèvres de sa fille avec un petit sourire ironique pour bien lui montrer qu’il n’y avait là aucun reproche, « continue, surveille-le bien ». Elle voulait dire : regarde bien Pierre comme tu l’as toujours fait, comme j’ai fait les tous premiers mois après sa naissance quand je l’ai recueilli le temps que madame Castaing reprenne des forces. Elle insistait avec son beau sourire pour dire combien elle était heureuse de cette union, précisant en silence : comme moi à ton âge, autrement dit, ma chérie, en portant la tête assez haut pour l’observer plus facilement, avec une sorte d’émerveillement reposé. En tournant autour de cette image, en la reproduisant à l’infini sous différents angles possibles, elle léguait à Irène une vérité qui avait valeur d’exemple, une certitude abstraite. Pourtant, Irène s’était convaincue le temps de descendre l’escalier nuptial que sa mère ne l’avait jamais tenue dans ses bras au-dessus du berceau de Pierre une semaine après le retour de la clinique. L’épisode du premier regard était une invention qui remontait si loin dans le passé de l’humanité que personne en particulier n’avait eu le besoin de mentir pour la fabriquer. La mythologie familiale des Thomazeau et des Castaing était exactement comme la grande : elle avait le pouvoir de révéler une vérité universelle en dépit des évènements attestés de la vie réelle ; elle était faite de revirements improbables, de croisements inattendus et d’authentiques mises à l’épreuve, si docile qu’elle pouvait s’accommoder de n’importe quel témoignage et contre-vérité. Irène avait toujours protégé Pierre et ne s’en était jamais cachée ; elle avait veillé à sa santé, corrigé les devoirs mal faits, menti pour être punie à sa place, écarté en silence les amis infidèles ou dangereux. Madame Thomazeau avait toujours prétendu, ironiquement et par méchanceté, qu’elle avait empêché le petit Castaing de faire carrière. Contrairement à l’accusation de dilapidation, dite comme une messe basse, son jugement sur la médiocrité du mari de sa petite-fille en matière d’argent était franchement énoncé. Pierre en avait ri dès l’ouverture des hostilités et semblait en rire encore du fond de son sommeil paisible d’homme de quatre-vingt-quatre ans.
Pourquoi, s’était dit Irène en reposant la tête sur son coude le matin du départ pour Venise — elle regardait maintenant en direction de la fenêtre refermée sur Paris endormi —, pourquoi aurais-je jamais dû me reprocher quelque chose ? Il lui avait semblé qu’elle était comme sa mère avait toujours été : libre et même méprisante envers ceux qui ne l’étaient pas pour avoir préféré les conventions, qui avaient choisi une voie facile ou tracée par d’autres et sacrifié à une petite idole de rien par manque de courage.

Lorsque Pierre avait glissé son bras sous l’oreiller et remué les paupières, elle s’était levée pour préparer un petit-déjeuner. Dans la pénombre du couloir mal éclairé par les appliques murales placées trop haut, ses anciens souvenirs s’étaient estompés. Ils flottaient le long des motifs géométriques du papier peint de l’avenue Vélasquez : le berceau d’osier, la pointe Vénus à Tahiti, les petits cadres en bois fruitier avec leurs dessins d’enfant dans le couloir des chambres de Bordeaux, la vieille libraire des Marquises assise à sa fenêtre au clair de lune. La mer si pure et bleue qui aveuglait au réveil prenait maintenant la teinte jaunâtre de la peinture du couloir parisien, noircie et poussiéreuse autour des tuyaux de chauffage. Lorsqu’elle avait franchi la porte de la cuisine, le carrelage froid les avait figés un bref instant. Elle avait allumé le plafonnier ; ils s’étaient effacés sans laisser de trace.
Pierre repassa dans le salon sur la pointe des pieds. Un volume plutôt mince était posé de biais contre le jeune Minautore. Il suffisait de s’approcher de la table basse pour en lire le titre.
Et pour Irène, entre la théière et les tasses que madame Zaffo retournait sur leurs soucoupes pour leur épargner la lumière, selon la croyance que le soleil gâterait les décorations intérieures de la porcelaine : le sachet de la pharmacie avec sa croix à huit pointes.
TROIS
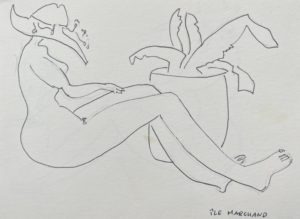
Pierre lut à voix haute :
Les jours comme ceux-là, la ville prend vraiment des allures de porcelaine, avec toutes ses coupoles recouvertes de zinc comme des théières ou des tasses retournées et le profil penché des campaniles qui luisent comme des cuillères abandonnées et se fondent dans le ciel.
« Comme c’est vrai », dit Irène en fermant les yeux. Elle voulait dire « Comme c’est beau » et ne désirait rien tant que cette beauté la visitât sans l’intermédiaire du regard, pour déposer une vérité nue et sans défaut dans sa tête endolorie. Le soleil bienfaisant glissait sur ses paupières ; si elle plissait les yeux ou se laissait aller en arrière contre le dossier, elle voyait par instants très brefs une myriade de taches minuscules de couleurs vives, étoilées comme des cristaux, s’agiter sous ses paupières.
« On n’abandonne pas une cuillère comme ça », fit remarquer Pierre. Il percevait Venise comme faussement folle et secrètement ordonnée ; de pure parade théâtrale mais en réalité logique et farouche à l’instar de Turin, ville du Nord. Les ermites et les prophètes des premières visites portaient à présent des costumes de notable ; leur silhouette était celle d’hommes mesurés et responsables. On ne pouvait se fier aussi facilement aux clochetons, aux arabesques, à la dentelle, aux fissures. Non seulement l’abandon d’une cuillère était improbable, mais il ne pouvait se figurer une seule tasse qui, retournée, pût rappeler un quelconque objet en zinc, ou qui en fût même recouvert d’une couche. « Aucun rapport, aurait-il pu objecter, aucun lien, tiens, entre les coupoles, les tasses et les théières. » Il en conçut une sorte de chagrin. L’inflation négative, toujours en bon ordre de marche chez Pierre, lui permettait de partir des cuillères pour rejeter les coupoles, pas seulement le zinc, puis tout à fait autre chose pour peu qu’il y eût un certain genre de métal dedans, puis n’importe quoi d’autre quand bien même il n’y en aurait eu que très peu, rien qu’une pellicule, et enfin… tout catégoriquement, dans un geste emphatique qui abandonne les couverts à leur triste solitude et à la pénétration réciproque du ciel et des clochers, en faveur d’une totalité philosophique rien moins qu’abstraite. C’est dire si Pierre, depuis la naissance, penchait sans se l’avouer en direction du vide.
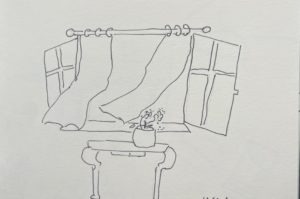
Il se serait volontiers laissé aller à une remarque sur le profil des campaniles — ils avaient justement sous les yeux celui de l’église des Grecs, dangereusement incliné vers le canal qui longe le musée des icônes — mais préféra le silence. La prose du poète… choix de madame Zaffo. Pierre aurait bien voulu la féliciter et marquer le respect qu’il leur devait à eux deux, le poète russe et la nouvelle passeuse de livres, héritière en terre italienne de la libraire du Globe, alors qu’il voulait se venger d’elle l’instant d’avant. Assis sur la terrasse à côté d’Irène qui croyait aux bienfaits du soleil, il éprouvait quelques difficultés à trouver les mots justes.
« Il a dû écrire ça l’hiver, fit-elle remarquer, c’est pour cette raison que tu trouves que ça sonne faux. »
Et bien évidemment, Brodsky, avec cette affaire de service à thé, avait évoqué l’hiver lagunaire quelques pages plus haut.
« Lis encore, dit-elle, mais plus doucement. »
Comme Pierre allait faire amende honorable, Irène rouvrit les yeux et ajouta, la main en visière :
« Ah oui, j’ai oublié de te dire que j’ai rêvé, tu ne devineras jamais de qui. C’est tellement bête… de monsieur Kahiki, le charcutier de la rue des Remparts. Tu te rappelles de lui ?
— Vaguement.
— Et bien moi, alors là, très précisément. Enfin dans mon rêve… Je n’avais pas pensé à lui depuis des années. Il avance vers maman avec un énorme couteau à découper, mais vraiment énorme, je veux dire gigantesque comme dans les rêves ; aucun charcutier n’a besoin d’un couteau aussi gros. Il avance et maman ne le voit pas parce qu’elle est en train de somnoler sur la véranda de la maison des Marquises. Je ne crois pas que monsieur Kahiki soit jamais venu aux Marquises. Je pense même qu’il n’a pas souvent poussé beaucoup plus loin que sa petite boutique de Papeete… non… à vrai dire je suis certaine qu’il n’a jamais quitté Tahiti. Enfin peu importe, ça ne compte pas. Je l’ai mis là dans mon rêve. Tu m’écoutes?
— Mmmhh…
— Je l’ai mis là, et moi… je me suis mise à l’étage. La fenêtre de ma chambre est ouverte et je suis penchée. Je crois que ma sieste est finie.
— Tu crois ?
— Enfin, je te dis ça maintenant. Le fait est que je dois bien me réveiller de ma sieste parce que mes yeux sont tout collés. C’est signe que nous sommes l’après-midi, parce que si c’était le matin quand je saute de mon lit pour filer direct chez la libraire, j’aurais les yeux grand ouverts. Donc… J’ouvre la fenêtre pour prendre un peu l’air, pour me débarbouiller en quelque sorte, et je vois le charcutier avancer vers maman avec son couteau.
— Et…?
— Tout à coup le couteau disparaît, il prend maman dans ses bras et ils sont tous les deux extrêmement beaux.
— Laisse moi continuer… Son tablier maculé de sang séché a disparu. Il porte une cotte de mailles… Non non non … nous sommes dans les années quarante, il porte un joli costume croisé en lin crème et Geneviève succombe aux charmes…
— Tu es bête. Lis donc. »
Pierre reprit au début, en partie par générosité, en partie par bravade, pour s’imprégner de cette prose qui avait commencé par le contrarier, mais aussi pour vaincre sa peur. Cet effort de lecture était facilité par la présence d’Irène, familière, rassurante, délicieusement répétitive. Il avait toujours réussi à en tirer parti, même à l’occasion des quelques ruptures, courtes et capricieuses, dont elle avait pris l’initiative, comme si Irène n’avait finalement jamais pris aucune décision contraire à leur couple. Il aurait volontiers soutenu que « rupture » disait mal les choses, appartenait comme « rentrer » au vocabulaire d’une autre langue. Plutôt parler de brouillerie ou de désaccord, qui relèvent du tracas passager. Jamais il n’y avait eu de désunion, ni même de mésintelligence. Pierre avait toujours fait signe le premier pour ramener Irène aux vagues et à l’écume, signifier que leur séparation n’avait été qu’un songe. Lorsqu’elle revenait avec son petit bagage à la main et un air pincé qui ne durait pas, sa présence physique était en parfaite harmonie avec le fantôme qu’elle avait laissé derrière elle, celui avec lequel Pierre avait dîné d’une salade verte deux ou trois soirs de suite et contre lequel il s’était endormi pas plus tard que neuf ou dix heures sitôt son livre refermé.
Il n’était plus question de fâcherie ni d’éloignement depuis longtemps. L’impossibilité dont les observateurs de passage s’étaient moqués par bêtise avait acquis la solidité du marbre, mais Pierre tenait quand même à ce qu’elle reflétât encore une volonté, à ce qu’elle fût le fruit d’une décision et non de l’habitude. L’âge n’y faisait rien. Ils se devaient un dessein plus qu’une intention transitoire. De même avec la mort : surtout pas de caprice ni de hasard. Ce qui lui avait tant fait peur la veille et qu’il contemplait avec horreur face à Irène allongée au soleil sur la terrasse, était qu’elle pût disparaître avant lui. Ou après, peu importe. Qu’ils pussent partir autrement qu’ensemble. L’incident des gros mots laissait un goût macabre, une âcre odeur de fumée, non pas tant parce que les mots étaient vulgaires que parce qu’ils étaient un signe et que ce signe n’indiquait rien qui lui fût familier. Ils devaient bien venir de quelque part. De loin, du désert mongol qu’ils avaient visité des années plus tôt, se disait Pierre, mais il ne savait pas pour autant quel sens leur donner. Il aurait pu accepter d’autres écarts ou bizzareries, mais pas cette convulsion. Irène aurait pu boire un bol de café le matin et y tremper une tartine beurrée, choisir une robe affreuse, mais ça… Il voulait dire : cette torsion inhabituelle de la bouche, ce tremblement des lèvres qui ne laissaient rien supposer de précis, qui, s’efforçait-il d’espérer, se suffisaient à eux-mêmes, n’étaient rien qu’eux-mêmes, pitoyables et chancelants, de simples difformités physiques passagères, sans maladie de l’âme qui leur correspondît.
« Et d’ailleurs, maintenant que tu en parles… »
Elle allongea le bras les yeux fermés, chercha le genou de Pierre, le trouva en tâtonnant, posa sa main dessus, toujours dans cette pénombre intime illuminée par instants de têtes d’épingles scintillantes, et pinça le tissu du pantalon comme on fait chez le marchand avec un échantillon.
« Si tu veux tout savoir… »
Elle remit l’étoffe à plat et remonta la main le long de sa cuisse.
« … tu ne croyais pas si bien dire. Monsieur Kahiki possédait effectivement un costume en lin crème. Je l’ai vu le porter un dimanche où nous l’avons croisé rue Dumont-d’Urville, bras dessus-bras dessous avec sa femme. »
Pierre posa son chapeau de paille sur la tête d’Irène.
« Tu devrais être à l’ombre », dit-il sans faire de commentaires. Puis il ne put s’empêcher d’ajouter « Il avait dû l’emprunter, ou bien en louer un », sur quoi Irène décida de se lever.
Elle redescendit au salon sans même esquisser un soupir, d’un pas étrangement leste. Depuis l’altana, faite de bois clair et de lumière pure, ce pas lui sembla élastique.
Pierre faisait maintenant face à une solitude créée de toutes pièces par sa maladresse, mais qui n’avait pas le caractère attendu des solitudes anciennes. Celle du service militaire, celle des punitions enfantines, et même celle laissée par la mort des amis chers, étaient plus légères. Comment la rompre, comment reconquérir l’espace qui le séparait d’Irène, s’excuser de l’ineptie de sa remarque ? Pourquoi rabaisser monsieur Kahiki ? Pourquoi le mettre à part des autres ? Pourquoi rappeler sa laideur, sa grossièreté, profiter d’un rêve innocent pour impliquer Geneviève ? Demander pardon aurait été infantile.
Il ramassa le chapeau et observa autour de lui les toits de tuiles rondes, les antennes de fer, les cordes à linges, les petites terrasses semblables à la leur avec leur mobilier d’extérieur. Il y avait là toute une vie superposée à celle des rues, des magasins et des habitations, à la limite du ciel bleu et sans tache, à la fois urbaine et céleste. On se parlait parfois, surtout le soir, d’une terrasse à l’autre, un peu trop fort, et des activités aussi banales que celles du monde du dessous s’y déroulaient au grand jour : l’étendage des lessives, l’ouverture des vins d’apéritif. Les bruits de la rue montaient, amplifiés, cristallins, pour se perdre aussitôt dans l’air limpide venu des Alpes. La lagune, à l’horizon, gisait, terreuse et parfois si peu profonde qu’on pouvait passer d’un monticule à l’autre comme sur des pierres de gué et la retrouver dix mètres plus loin, épaisse de vase, assez traître et froide pour qu’on y risquât la noyade. À l’inverse de ces paysages de fond des peintures de la Renaissance, bleutés du très clair au très obscur, orientaux par métaphore, inaccessibles et riches des détails d’une architecture antique et pleine d’ornements, elle faisait corps avec la ville. Les toits de tuile, les crénaux et les campaniles lui appartenaient de plein droit.
Pierre se leva à son tour, tiré de sa rêverie par une corne de brume. « Tu as raison », dit-il un peu trop fort pour qu’Irène sût au plus vite qu’ils étaient réconciliés, « il y a une photo de lui dans le tiroir du bureau, à Paris… le tiroir du milieu », mais Irène s’était déjà rendormie sur le canapé.
Pierre prépara un thé pour son réveil et s’assit à côté d’elle. Il prit ses jambes sur ses genoux. Le soleil de l’après-midi les avait chauffées. Peu importe les effets toniques du thé. Ils parleraient au lieu de dormir, comme ils avaient marché hier : tard dans la nuit, avec excès, bonheur, et une libéralité qui détruirait jusqu’aux plus petits déplaisirs. C’était possible ; la chaleur bienveillante des jambes et des chevilles lui donnait cette conviction. Et puis ils avaient eu la même conversation à Bordeaux trente ans plus tôt à propos de ce même costume en lin lorsqu’ils avaient rangé la maison à la mort de Geneviève Thomazeau. « C’est curieux », avait dit Irène avec hésitation en triant les photos, « je ne me rappelle pas du tout du charcutier de la rue des Remparts dans un costume en lin crème. Je ne vois même pas où la photo a été prise. »

La rue Montbazon était toute insouciance en ce jour de deuil ; la fraîcheur des pierres et des pavés montait généreusement jusqu’au fenêtres ouvertes, glissait sous les portes, faisait un bien fou aux pieds nus et aux aisselles.
Il ne pouvait s’agir de la communion d’Irène ; monsieur Kahiki n’aurait pas été invité. Le cliché le montrait dans un costume de coupe anglaise avec des poches à larges revers coupés en biais et un col souple plutôt important.
Irène avait rangé la photo dans la boîte et lancé « Il avait toujours les mains roses, des ongles rongés et un tablier plein de taches de sang, du sang noir comme du boudin. Beurk… »
À moins qu’il s’agît d’un mariage auquel tout le quartier avait été convié, auquel cas monsieur Kahiki, qu’on croisait le dimanche sur la promenade en fin de journée, aurait pu emprunter un costume pour faire honneur à ses hôtes.
« C’est une drôle d’idée d’avoir gardé ça », avait quand même ajouté Irène en retournant la photo pour vérifier si une date était inscrite au dos.
Pierre, qui jugeait inutile de s’encombrer de vieilles boîtes à chaussures dans l’appartement de Paris, s’était alors permis une remarque sur la manie familiale de tout conserver. Le berceau, bien sûr, mais le berceau était à part ; il avait la puissance des reliques. Les photos… Pierre avait gardé une seule photo de lui à la caserne de Besançon l’année de son service militaire. En ce jour de tristesse, son visage était rasé de frais, ses dents d’un joli blanc cru et lumineux. La fatigue du voyage de Paris en Aquitaine avait un peu creusé ses joues, leur donnait de l’éclat.
« Ça doit faire pas loin de quarante ans, avait-il dit. Quarante ans, Irène ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir foutre de ça ? »
Irène avait passé outre le vocabulaire et répliqué en se retournant vers lui, émue par cette peau fraîche et ces lèvres pleines qu’elle voulait goûter sans cesse malgré le décès de sa mère : « Voilà, Pierre ! C’était les années cinquante ! Et c’était le mariage de Blanche Delhumeau avec Jean-Yves. On avait même invité les Audibert. »
Maintenant qu’Irène s’était allongée sur le canapé de madame Zaffo, Pierre se rappela que son père avait effectivement prêté un costume d’été à monsieur Kahiki à l’occasion de ce mariage improbable. Non seulement venait-il de trouver la solution à la question posée par Irène à l’époque de l’enterrement de sa mère, mais il se souvenait d’autres scènes fabriquées sur le même modèle qui avaient par rétrospection valeur de récidive. Irène, injuste et triomphale, répétait à chacune de leurs visites à Bordeaux ce même voilà ! pour signifier qu’elle avait eu raison de garder une photo, une carte postale, un foulard, un cadeau ménager, qui pussent témoigner de la continuité de leur existence. Les préparatifs de l’enterrement de Geneviève, la levée du corps, les condoléances, la peine immense et tranquille comme une œuvre impassible de la nature n’y avaient rien changé. Elle avait apprivoisé ces lèvres qui lui avaient tant manqué à l’époque de l’armée. Elle avait glissé la photo dans ses affaires, un peu par fétichisme, un peu pour célébrer une victoire sans que Pierre, rassuré sur le nombre de cartons qui resteraient dans la cave de la rue Montbazon, en sût jamais rien.
Elle avait donc menti, conclut-il en regagnant le fauteuil du salon de madame Zaffo, pour une photo de rien du tout, orpheline dans le tiroir de la commode avenue Vélasquez, une photo du charcutier de Tahiti célèbre pour son Bayonne comme les grands acteurs sont célèbres pour leur jeu. On ne pouvait d’ailleurs le nier, lorsque Jean-Pierre Kahiki sortait son grand couteau pour couper des tranches et les lachait d’un coup sec sur le plateau de sa balance en arrondissant le bras au-dessus de la tête, les yeux fixés sur la flèche du cadran comme un toréador sur sa victime, on était au théâtre. Et puis, quoi… ? Blanche et Jean-Yves étaient restés mariés six mois, le temps de concevoir Léopold.
Blanche Delhumeau… C’était drôle comme son nom de jeune fille revenait avec naturel, au point que le nom de son mari s’était effacé des mémoires. Irène y pensait-elle, parfois ?
« Blanche des Marquises », disait-on, comme si la petite fille de la communale de Papeete avec qui on jouait le temps des vacances avait jalousé l’aristocratie des autres, qu’elle fût attestée ou purement de style et de maintien, alors que Blanche avait la fraîcheur de son côté et une correction d’enfant dans un manque de manières qu’on interprétait souvent à contresens. La pureté naïve, vertueuse à Bordeaux, faisait peur aux antipodes où l’on disait pour éviter les sujets embarassants que la nature, grossière et sauvage sous sa vaste beauté lumineuse « reprenait ses droits ». Mais Blanche s’en fichait éperdument — des roturiers comme des aristocrates, de la jeunesse brune et souple des Îles du Vent comme des fondés de pouvoirs de la capitale. Elle s’en moquait avec l’orgueil généreux des déshérités qui juge paritairement l’abondance et le dénuement, opposant une insolence douloureuse aux faits et gestes de tous les hommes sans exception, grands et petits, pareillement factices, transitoires, infidèles et — mon Dieu — humains.
QUATRE
Je m’étais dit que j’allais pleurer, avait noté Irène dans son journal quelques mois après que Pierre fut revenu de son service militaire, tellement pleurer que je n’oserai pas sortir de ma chambre pendant trois jours et que j’y resterai seule sans voir personne pour que mes yeux paraissent moins rouges et mes cernes moins creusés quand je retournerai chez le fils Audibert lundi matin. Et puis j’ai rencontré Blanche par hasard dans le quartier de la gare Saint-Lazare…
Irène n’avait pas touché ce journal depuis des mois lorsqu’elle écrivit ces lignes. La vie commune avec Pierre avenue Vélasquez, la régularité des horaires qui lui permettait de prévoir quand elle pourrait s’asseoir à son bureau pour s’y consacrer sans avoir l’air de s’isoler, le besoin d’imaginer un but qui effaçerait cette vilaine période du régiment, l’y avaient poussé. Elle l’avait commencé dans l’adolescence pour consigner au hasard des observations diverses sur la famille, les évènements politiques du moment — tellement différents suivant qu’on les commentait à Bordeaux ou aux Marquises —, les expositions du Jeu de Paume à l’occasion des premières visites parisiennes, mais aussi des réflexions plus intimes. Elle appelait ces confessions des trahisons et les numérotait pour en souligner le côté risible et inoffensif — risible au sens léger de « plaisant ». Ces notes avaient leur vie propre à l’intérieur du journal, elles tissaient une histoire particulière qui conduisait des frayeurs enfantines aux réticences coupables et aux aveux. Si on les avait isolées, on aurait obtenu un portrait psychologique fidèle d’Irène, depuis la fin de l’enfance jusqu’à la maturité, une confidence naïve et continue qui revenait sur telle réflexion ou tel sentiment sans qu’ils fussent abordés autrement que dans ces soliloques, dessinant les méandres d’un fleuve souterrain.
Sous le chapeau Trahison 332, on pouvait lire : Me suis dit que la réflexion d’Ivan Karamazov « Si Dieu est mort, tout est permis » est moins l’expression d’un désespoir — chose qu’on tient tellement à faire passer pour typiquement russe (ah bon… ?) — que d’une extraordinaire prétention. Ou encore : Je n’ose pas dire à Pierre combien j’aime sentir ses poils de barbe quand il me lèche. Il s’était rasé avant de sortir au théâtre l’autre soir. Nous sommes partis avant la fin. La mise en scène était atroce. Nous avons eu le courage de subir un acte, pas plus, des Joyeuses commères de Windsor. Du coup, nous avions plus de temps à la maison, mais c’était quand même beaucoup moins bien. (Trahison 4203). Le petit cahier rouge qu’elle gardait dans son tiroir, acheté en cachette à la librairie du Globe le jour de ses treize ans, n’en comptait pas moins de six-mille-deux-cent-quatre-vingt-douze en mars 1962 au moment des accords d’Évian. Trahison 6156 propose d’aillleurs Journée historique. Accords déviants. Et un peu plus loin pour marquer le vide de la journée : Rien fait. Un peu honte quand même parce que Pierre a dû passer l’après-midi avec son père pour évoquer la question des chantiers. Ou alors, Audibert père et fils s’en mettront vraiment plein les poches. Je crois qu’il va falloir qu’il travaille, qu’il s’intéresse aux tonnages et aux voilures. Et s’il fait ça, alors Dieu est mort, et tout, vraiment tout, pour ne pas dire absolument n’importe quoi, est permis.
Au temps du service militaire de Pierre, Blanche louait un petit deux pièces dans le bas de la rue de Mogador. Elle venait de commencer son droit à la faculté de la rue d’Assas. Irène ne l’avait pas vue depuis les dernières vacances aux Marquises. Blanche avait pris ses distances depuis l’échec du mariage — par fierté et peur des sarcasmes, ou plutôt, comme elle le dit plus tard en feignant l’obstination, « pour se mettre au frais ». Elle se rencontrèrent à Paris par hasard. Blanche lui fit signe de l’autre côté de la rue et traversa hors des clous pour venir à sa rencontre.
Il n’avait fallu à Irène que quelques jours pour sortir le cahier rouge du tiroir et dessiner maladroitement cette trajectoire aérienne de Blanche Delhumeau se faufilant entre les voitures, le balancement du sac au bout de la main qu’elle avait levée en criant son nom, et son mouvement de recul lorsqu’elle s’était retrouvée face à elle sur le bon trottoir. Les trois esquisses au crayon précédaient de deux années ses notes sur la rencontre fortuite « dans le quartier de la Gare Saint-Lazare… », jetées là grâce au confort de la vie conjugale avec Pierre, régulière mais jamais monotone. Les trois points de suspension disaient que des évènements importants en avaient résultés, médités tout ce temps sans que le besoin d’ouvrir le carnet se fît jamais sentir. Ces quelques notes avaient valeur de légende pour les trois ébauches antérieures, lesquelles étaient séparées par une grosse astérisque, dessinée avec des petits fils tout tordus qui partaient du centre et s’entortillaient au hasard sur la feuille. Irène avait croqué sur le coup de l’émotion le capot d’une voiture, le bras lancé en signe de victoire, le visage de Blanche, à peine crayonné, mais avec deux grands yeux qui exprimaient à la fois la surprise et la contrariété. Le temps d’écrire « Je m’étais dit que j’allais pleurer », Irène était revenue sur cette astérisque banale avec des ajouts crayonnés à l’allure végétale. Son gribouillage avait effacé la petite étoile, si précise au départ qu’on aurait pu la croire typographiée, en lui prêtant un mouvement involontaire qui contredisait sa fixité. On pouvait dire à présent que ces phrases étaient posthumes, tant l’ancien moi d’Irène avait été mis à mal et abandonné pour que le nouveau, neuf et délivré, pût reprendre à son compte le fil du récit d’abord ébauché sous la forme du dessin.
Le fils Audibert habitait avec sa famille rue de Naples, dans le quartier de l’Europe. Irène avait failli pleurer ; elle venait tout juste de sortir de chez lui en pestant contre elle-même et réfléchissait à son air filou, sans trop savoir de quelles manœuvres frauduleuses il était capable, s’en voulant tout autant de son incapacité à le cerner que d’avoir accepté son rendez-vous. Ne trouvant rien de précis à lui reprocher, elle avait préféré s’éloigner et redescendre au hasard en direction de la Madeleine. Lorsqu’elle rouvrit son carnet pour griffonner sa première esquisse, elle se rappela précisément du moment où la Peugeot 104 avait klaxonné, du haussement d’épaules par lequel Blanche avait signifié à l’automobiliste qu’elle avait conscience de son impuissance à résister à une impulsion sans conséquence — féminine, à en juger par le grand sourire qu’elle avait jeté en pâture pour excuse. Le conducteur avait lancé une injure en se penchant par la portière. Elles en avaient ri toutes les deux et Blanche avait ensuite regardé Irène d’une drôle de manière, en reculant devant elle une fois à l’abri sur le trottoir. Irène avait eu l’impression que son amie venait de découvrir qu’elle avait été au bord des larmes l’instant d’avant et qu’une chose terrible lui était arrivée. Non pas un malheur objectif mais plutôt quelque chose d’imaginaire qui n’était terrible que de son point de vue à elle, et qu’il était par conséquent beaucoup plus difficile de dissiper ou de réparer qu’une vraie fatalité.
L’impression était d’autant plus curieuse que ce mouvement de Blanche sortant des limbes rue de Mogador l’avait tout de suite projetée dans un état d’esprit très différent. Elle avait effacé jusqu’à l’attente réconfortante des larmes qui devaient bientôt remplacer Pierre, une attente paisible dont Irène avait prévu chaque étape en marchant le long du lycée Condorcet, puis en direction du métro Saint-Estienne-d’Orves en prenant par la rue Joubert après avoir quitté Audibert fils. Pierre serait stationné à Besançon pour dix-huit mois. Comme souvent, elle avait anticipé le pire par superstition ; elle s’était dit qu’en imaginant les plus grandes souffrances, la réalité ne pourrait lui apparaître qu’agréable. Personne ne pouvait être aussi malheureux, aussi abjectement seul. Pierre lui écrirait, il se moquerait de la vie militaire, il la ferait rager en lui disant à l’occasion d’un retour à la caserne qu’il avait passé son trajet de fin de permission à consoler une jeune fille rapatriée au domicile familial suite à un échec amoureux. Des peccadilles un peu niaises, faites exprès pour chatouiller, auxquelles Irène ferait semblant de croire. Mais maintenant que Blanche était devant elle et posait sa main sur la sienne, le décor bisontin, les tuiles vernissées du palais Granvelle, les beaux hôtels de la noblesse d’épée installée à Besançon par Louis XIV qu’elle avait vus, enfant, reproduits dans l’encyclopédie des Castaing, s’évanouirent d’un seul coup.
Blanche dit « Allons plutôt chez moi ».

Irène réfléchit le lendemain matin qu’aucun autre projet n’avait été envisagé : s’asseoir à une terrasse de café ou sur le banc d’un square avoisinant pour se dire l’essentiel, parler du départ pour Paris, parler de Léopold. Ce « plutôt chez moi » trahissait sa petite sœur des Marquises, mais de manière si pateline et douceureuse qu’elle n’en avait rien vu. C’était tellement trivial qu’elle en rit tout doucement à peine sortie du sommeil au lever du jour, délicieusement lasse de son ivresse, ravie d’avoir été prise au piège, en cherchant les pieds de Blanche sous le drap pour les chatouiller avec ses orteils.
Le nom de Blanche flottait dans la mémoire de Pierre, tantôt cristallin, tantôt feutré, selon qu’il était prononcé par Irène ou monsieur Kahiki. Il s’éteignait dans la bouche de madame Thomazeau, obstinément absente à la cérémonie de mariage et au déjeuner qui avait suivi. Le visage de Blanche avait parfois les traits de l’enfance, parfois ceux de l’adolescence, ou alors un mélange des deux terriblement confus et indécis ; tour à tour jeune et moins jeune, abîmé par le sentiment de l’erreur, puis de nouveau naïf sans raison. À d’autres moments encore, Pierre regardait Venise par la fenêtre et la silhouette de mademoiselle Delhumeau s’effaçait derrière un nuage ou un rideau tiré par une main invisible. Blanche n’était ni vraiment une enfant, ni vraiment une adulte. Elle portait un masque ancien dont on devinait l’épaisseur à la racine des cheveux ; une ligne sombre séparait le faux front d’avec le vrai. Son corps sans âge perdait sa matière. Il devenait liquide, puis gazeux, extensible et sans volume ; seule l’ombre du masque, grise et profonde, résistait à la dilution dans l’air chargé de chaleur.
Blanche s’était mariée trop vite ; elle avait quitté les Marquises et choisi le droit. Pierre l’avait croisée plusieurs fois à son retour du service, mais n’avait jamais rien su de la rencontre parisienne. Il observait maintenant Irène allongée sur le canapé, les froissures du coussin sur sa joue ensommeillée, l’entortillement du tissu de sa robe autour de sa jambe, rassuré par la profondeur de son calme. Ses paupières étaient lourdes à la manière des petites portes laquées des coffrets à bijoux, et c’est avec insouciance qu’elles protégeaient ses yeux malicieux et brillants. Sur les paupières : une simple touche bleu pâle qu’Irène avait dû étaler en vitesse du bout des doigts dans la salle de bains, une poudre azurée, légère comme le duvet des ailes de papillon. Pierre eut un sourire ; cette coquetterie lui avait échappé. Irène s’était faite belle sans rien dire, malgré la peur de la veille, malgré l’incident nocturne de la Giudecca. C’était tout aussi secrètement, d’un coup de clef nerveux dans la serrure, que Blanche avait ouvert la porte de son petit deux pièces, et avec le même effet de séduction séditieuse qu’elles s’étaient retrouvées toutes les deux seules comme au temps des Marquises. La lumière du soleil qui tombait sur la table devant la fenêtre de la rue de Mogador avait la même pureté. De minuscules poussières virevoltaient en tout sens au ras de la nappe, faites de la fibre du coton blanc. Le rayon de lumière qui passait plus haut par la vitre et venait à elles par dessus les toits parisiens d’ardoise et de zinc, traversait une atmosphère d’une remarquable tranquilité, sans nuance ni retouche, urbaine par défaut. Il y avait de gros livres empilés sur le côté. La poussière venait de là, se dit Irène, plutôt fière en cet instant de retrouvailles de n’avoir pris aucune décision quant à ses propres études. Blanche ne s’étonna pas le moins du monde qu’elle n’eût aucun projet de cette nature ; son amie appartenait à un autre univers, moins riche en contraintes, malléable.
« Tu t’amuses, à Paris ? » demanda-t-elle.
Irène acquiesca sans dire un mot, comme si elle approuvait une réponse.
« Tu fais quoi ? »
Elle hésita à donner une réplique prétentieuse du genre « Je cherche à oublier l’avenir » ou alors « Rien, mais n’est-ce pas déjà quelque chose ? » Il était entendu que Blanche aurait dû prendre sa réponse sur le mode ironique, mais il y avait un risque. Elle pouvait très bien juger l’ironie pleine de suffisance. Irène dit simplement « Je vis avec Pierre » sans avouer qu’ils avaient été deux fois à Venise, une première fois un mois de mai, à l’hôtel, et une deuxième en hiver dans un appartement confortable qu’ils avaient loué pour un mois.
« Tout seuls ? » demanda Blanche.
« Tout seuls », répondit Irène et sa fierté, cette fois-ci, n’était pas feinte. « Tout seuls à Paris » aurait fait provincial. Le Pacifique lui avait appris à dominer la supériorité parisienne. Vus du voilier ou de la pointe Vénus, des jardins de Paofai et même de la modeste place du marché, les fastes de la métropole n’avaient rien d’intimidant. Ils étaient accessibles. On pouvait aller à Paris quand on voulait, en passant par Bordeaux plutôt que par Le Havre qui en était plus proche par le train. Sur les deux ou trois mois loin des Marquises et de Tahiti, on en passait facilement un à se reposer en Aquitaine sans se soucier le moins du monde de ce qu’on manquait de nouveau au théâtre et à l’opéra. Irène maîtrisait à la perfection ce snobisme inversé qui ne doit rien à la morgue de l’aristocratie des îles et tout au sentiment naïf d’appartenir à un paradis païen.
Il faisait chaud. Blanche servit deux menthes à l’eau avec glaçons et partit prendre une douche. Elle revint sans s’être séchée, posa sa serviette sur le rebord d’une chaise et s’allongea sur le canapé. Elle croisa les bras derrière la tête et regarda ostensiblement le plafond.
« C’est drôle comme tes pieds sont roses », dit Irène.
« C’est drôle comme ses jambes ont si peu changé », pensa Pierre en se levant pour reprendre le livre posé sur la table. Une pichenette sur la tête du Minautore fit sonner le bronze. C’était à peine un tintement, plutôt son écho lointain, ou alors une modeste imitation, pâle et feutrée, qui laissait Irène à son repos. Pierre recommença, le livre à la main, l’œil sur le sommeil d’Irène, et cette fois-ci, un son de cloche, lourd et inattendu, jaillit de la bête. C’était là, une fois de plus, la manifestation infantile d’une habitude exaspérante du jeune Castaing : faire quelque chose d’idiot en prenant l’air intelligent du connaisseur. Autrefois, c’était prendre un livre sur une étagère de la librairie du Globe pour le remettre au mauvais endroit, ou bien ouvrir l’appareil photo du grand-père Jérôme et gâcher la pellicule. Aujourd’hui, c’était faire du bruit pour rien. Irène y resta indifférente. Elle continua à dormir sans bouger la jambe. Pierre aurait voulu qu’elle se reveillât pour lui parler encore de monsieur Kahiki, de la rue des Remparts et de Léopold.
Irène chassait les réflexions contraires à ses actes lorsqu’elle s’allongeait à côté de Blanche sur le lit de la rue de Mogador dans un esprit d’évanouissement ; elle repoussait aujourd’hui les intimations de Pierre avec le repos conseillé par le médecin de madame Zaffo. Amollie sous le drap parisien, elle prenait la main de son amie dans la sienne et Blanche faisait descendre sa paume contre son ventre sans défaire cette étreinte anodine, encore respectueuse du sommeil. Pierre prendrait sa main, lui aussi, pour la passer contre sa joue et la réveiller doucement avant la tombée de la nuit vénitienne.
La journée serait chaude, s’était dit Irène la première fois. Les bruits de Paris étaient détachés les uns des autres comme si une mécanique artificielle les avait séparés et exposés côte à côte pour inventaire. Ils étaient différents des bruits de Bordeaux. Irène s’était déjà fait cette réflexion plusieurs fois dans la solitude de l’avenue Vélasquez : moins sourds, sans l’amorti du velours, avec un effet de trompette royale. Ils passaient dans la chambre adoucis par l’épaisseur des rideaux, et Blanche, allongée sous les draps avec sa main sur le ventre faisait penser à une courtisane recomposant sa beauté pour le soir le temps que l’orchestre répète une dernière fois, que les velours soient époussetés et la foule rangée dans les loges.
Du droit. Comme cette matière, sèche et sérieuse, lui convenait ; entièrement cachée sous ses manières faciles et légères, mais tout autant, après tout, que sa vie de lesbienne célibataire devait être cachée sous des camaraderies enjouées avec des garçons de bonne famille qui faisaient les mêmes études. Blanche travaillait en semaine avec le plus grand sérieux, se penchait jusqu’à pas d’heure sur des manuels ennuyeux et des commentaires d’arrêt avec dans un coin de son esprit la certitude qu’elle allait retrouver le samedi ou le dimanche… une habituée, une créature, Irène ne savait trop quel nom leur donner, en tout cas une autre femme qui n’avait ni son intelligence ni ses capacités et qu’Irène reléguait instinctivement au monde convenu de la nuit et des artifices. Peut-être fermait-elle ces gros livres vers minuit ou une heure pour remonter vers la place Clichy et flâner le long du boulevard. C’était curieux comme en l’espace de quelques heures sa vie avait changé, par cette sorte de retrouvailles sans dénomination connue, par sa rencontre impromptue avec Blanche Delhumeau. Elle aurait pu rentrer chez elle, faire couler un bain, oublier Audibert fils qu’elle avait voulu sonder pour découvrir jusqu’à quel point il mentait à Pierre, mais qu’elle n’était après tout pas obligée de revoir. Elle aurait pu ouvrir son journal ou aller seule au cinéma. Au lieu de cela, elle était — l’expression lui fit peur et la fit sourire — au lit avec Blanche. Ce lit tout bête dans cette chambre toute simple, bien différents du luxe de son quartier, avec Blanche douce et tiède endormie à ses côtés, lui plaisaient infiniment. Elle allait cacher cette histoire à tout le monde ; ni Pierre — ni Audibert, ni Léopold, bien sûr, quelle idée —, ni personne n’en entendrait jamais parler. Blanche serait comme le personnage d’un roman sans lecteur dont Irène pourrait écrire et réécrire les chapitres à loisir : Blanche à la bibliothèque de la faculté, Blanche en week-end à la campagne, Blanche au théâtre, nue dans son bain, conduite par sa maîtresse dans des soirées privées… Les possibilités étaient infinies, et Irène, que la liste ennuyeuse et attendue aurait dû endormir, resta éveillée pour en inventer d’autres encore, la main sur le ventre de son amie et les yeux fixés sur les moulures du plafond. Blanche est à moi, se disait-elle, plus qu’elle n’est à aucune autre, parce que je la connais depuis longtemps avec tous ses petits défauts. Je connais les erreurs qui l’ont marquée, je sais quelles faiblesses la menacent derrière son aplomb, ce qu’elle attend des hommes sans jamais rien avouer à ces femmes de mauvaise vie qu’elle rencontre au hasard de ses sorties. Je sais tout ce qu’elle cache à celles qui la possèdent — son ancienne vie de vent et d’eau, l’existence d’un fils dont son mari de six mois n’a pas voulu — et quelle solitude elle éprouve au terme de ces aventures sans tendresse, sans avenir, sans rien d’autre que la chair pleine de l’orgueil de son désir. Si je voulais la sauver, continua Irène alors que la main de Blanche dessinait tout à coup des ronds et des ellipses, je l’emmènerai loin d’ici. Et comme les doigts de Blanche s’arrêtaient pour s’imprégner plus encore de la moiteur de sa peau, elle vit qu’il était six heures de l’après-midi et se dit qu’il était grand temps d’aller faire des courses, comme si la vie domestique avait eu le pouvoir de faire pâlir la dissolution et le péché.
Pierre reprit sa lecture sans la quitter des yeux. S’il avait su comment la petite Delhumeau faisait glisser Irène sur le dos sans lâcher la main qu’elle avait prise presque de force, comment Irène se laissait installer, comment des mots extraordinairement doux, techniques, bien différents des grossièretés d’hier soir, sortaient de sa bouche et disaient exactement ce qu’il fallait faire au moment même où Blanche le faisait, tour à tour tendre et conquérante, dans cette chambre pleine de fausse fraîcheur, s’il l’avait su, Pierre se serait fourvoyé et aurait cru à une trahison. C’est pour cette raison qu’Irène ne lui en avait jamais parlé, n’avait jamais rien confié à son carnet, n’avait jamais rien dit à personne de la petite langue rose de Blanche, ni du vin blanc qu’elles buvaient en peignoir. Ce n’est pas moi qui fait cela, pensait Irène, Pierre m’en voudrait. Lorsque le souvenir de Blanche prenait forme, ou lorsque Léopold posait une question sur sa mère, elle regardait le parc Monceau par la fenêtre, s’attachait à un détail de la végétation ou des fenêtres, et recouvrait la rue de Mogador d’un grand voile. Elle se rappelait — en faisant un effort, comme s’il y avait eu une difficulté à surmonter — que le Paris de Blanche n’avait pas la fraîcheur hautaine des beaux quartiers où l’air du soir a la transparence du cristal, où les arbres poussent avec plus de liberté, où l’on voit encore à plus d’un siècle de distance que des étangs, des hameaux et des chemins de terre ont laissé leur place aux avenues pavées et aux immeubles en pierre de taille, crémeux et solides, par une alchimie de l’argent qui a transformé le confort ancien des hôtels particuliers en un confort moderne, moins fastueux mais pratique. Les bruits, chez Blanche, étaient vifs et courts, les pas claquaient sur un bitume vieux de six mois, ils n’avaient pas l’aisance des pas qui crissent sur les grosses feuilles de platane en automne. De l’autre côté de Paris, plus à distance de la Seine, là où sa vie avec Pierre gagnait en mollesse et libéralité, les dames de compagnie promènent les chiens de race à petite allure, leurs chaussures basses à semelles de crêpe suivent à distance leur course abrupte et nerveuse ; lorsqu’elles rentrent au crépuscule, la laisse roulée comme une cravache contre la cuisse, les lourdes portes à double battants se referment sans bruit sur un dallage en damier noir et blanc. Aux étages éclairés par la douce lumière des lampes de bureau, les enfants font leurs devoirs. Il dînent tôt, côté cour, dans une vaste cuisine aux allures de palais des neiges carrelé de blanc. Irène ouvrait la fenêtre pour s’en convaincre, Léopold venait la rejoindre, Pierre les regardait faire, posait sur eux un regard possessif et attendri, et Blanche s’évanouissait pour eux trois sans résistance, effacée par les pas feutrés et les tombées du jour du Parc Monceau, artificielles, peintes à l’huile, parsemées de petites taches jaune d’or.
(À suivre…)
