De fragiles vibrations
À propos de L’Année où j’ai appris l’anglais, de Jean-François Duval,
par Matthieu Ruf
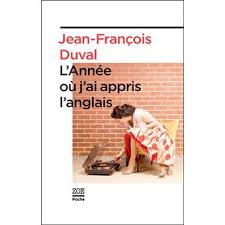
Spécialiste de la beat generation, Jean-François Duval cultive le goût du voyage. Voyage de par les routes du monde, voyage dans l’éternité d’un verre de whisky, et parfois les deux en même temps (Boston Blues, paru en 2000 chez Phébus). Avec L’année où jai appris l’anglais, il nous convie avec bonheur à la frontière du Far East, de l’Extrême-Orient imaginé que figure, pour le jeune protagoniste, la ville de Cambridge.
Chris, dix-huit ans, y part apprendre l’anglais. Cette langue le «met au monde une deuxième fois », lui fait découvrir l’intensité des amitiés simples car éphémères, les vibrations d’un lieu « sans fausse note », les douleurs et les délices d’un premier amour en lutte avec la fuite du temps. La langue de Duval, elle, nous entraîne dans le monde d’illusions voulues de Harry, le colosse « qui ne ressemble pas à lui-même », de Barbara, la tigresse, de Mike, l’ange triste dont la musique change les êtres. Compagnons d’une saison de grâce, le printemps 1968 sans Sorbonne, où Chris, enfant adulte comme eux, vit, « se contente » de vivre tel un solo de guitare, tantôt blues, tantôt électrique. Une vie à part, suspendue dans l’amour, inconscient puis exploré, pour Maybelene, dix-sept ans, qui devient bien vite le véritable «génie du lieu».
Le roman se concentre alors sur cette relation magique, la module par petites touches. Bicyclettes dans le matin, pubs enfumés, escapades : Chris et Maybelene se cherchent, se perdent de vue puis se redécouvrent jusque dans les plus infimes détails. Tout est littérature chez Duval, et c’est une de ses qualités : les papiers de chewing-gum disent l’échange pudique des sentiments, les rues inconnues de Cambridge l’égarement partagé. Autant de « manières de montrer le chemin », mais qu’on aimerait parfois moins évidentes ; quelques accords faciles se sont glissés dans la partition par ailleurs nuancée de l’auteur. Reste qu’à travers ces petits riens, c’est dans un univers de liberté qu’il nous fait entrer: espoir par le rock, jeux de mots entre les amants plurilingues, prairie solitaire où il est permis d’être soi-même, le moment d’une journée parfaite. Mais cette liberté est condamnée, fragilité du rêve que vaincra la fatalité du départ, du retour à la réalité. Ce n’est en fin de compte pas un rock conquérant, mais bien plutôt mélancolique qui se dégage de ce récit d’un séjour hors du temps, et pourtant si intensément vécu, qui nous renvoie à nos propres « moments exacts ». Cette mélancolie, ou plutôt cette tendresse, mémoire qui s’enfuit transfigurée en littérature, est une manière d’accepter les dissonances, celles « qui rendent l’univers complet ». Avec Duval, les cordes de la guitare sont fragiles, et la musique d’autant plus belle.
M.R.

