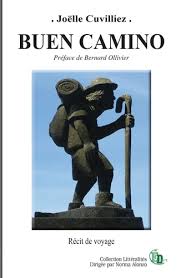Le Bon Chemin de la marcheuse
Sur le Buen camino, de Joëlle Cuvilliez
par Francis Vladimir
« Marcher, c’est sentir qu’on a des muscles (ils renâclent), des articulations (elles grincent), des tendons (ils protestent), un souffle (il accélère), c’est prendre conscience des sens – fumet de sueur, de varech et d’algues, son du vent et des vagues, vision des nuages et de paysages. À chaque pas, la pensée s’évanouit devant le ballet aérien d’un oiseau de proie, un cerf-volant rouge déployé sur une immense mer de sable écru fouettée par la crème des vagues, une fleur de figuier de barbarie orange. Un pas, une perspective… tout se joue en alternance, la plénitude et la douleur, la chaleur et la soif, la faim et l’inquiétude, la joie et les regrets, les souhaits et la fatigue, l’envie d’arrêter et la nécessité d’avancer. (p.135/136). »
La marche ce serait donc ça, une recension physique de soi vers le but fixé, le but à atteindre. Et dans ce regroupement, cette pelote serrée qui ne se dénoue que pour tracer le chemin si cher au poète, l’écrivaine Joëlle Cuvilliez s’inscrit dans une suite logique de marcheurs, scripteurs de l’aventure marquante que l’épreuve suppose. Car c’est bien d’une épreuve consentie, il est vrai, dans laquelle le lecteur de ce récit de route est embarqué comme s’il l’eût été, volontairement, à la suite d’un pouce levé, pour un auto stop improbable, dont la finalité sera de lire de la première à la dernière page Buen camino et suivre les vingt neuf étapes, de Saint-Jacques de Compostelle à Lagos en Algarve, sept semaines et demies de marche et d’évasion qui laisseront toujours libre cours aux souvenirs, à l’expérience, à la nostalgie et à la vie.
On ne sait ce qu’il faut louer dans ce type d’entreprise humaine, la volonté initiale, la ténacité de tenir et d’aller au bout, la force intérieure de ne pas se laisser aller face à l’adversité de certains jours ou encore l’extrême énergie à convoquer pour ne pas sombrer à la fatigue, mais aussi la période d’un deuil qui pousse à s’éloigner un temps ( ici la perte de la petite chienne Chaïli ). De cette réalité physique on ne saurait faire fi, l’écarter d’une pichenette comme si cela entrait dans les données incontournables de l’aventure. Certes. Mais à partir de là, à compter de tout ce qui fait douleur physique, appréhension, angoisse et peur voilà que le récit de Joëlle Cuvilliez s’accoude à toute autre chose et cette autre chose c’est la vie, tout ce qu’un être normalement constitué possède intimement en lui, sa relation au monde, aux êtres, aux vivants et aux morts, et aux choses essentielles. Et quoi de mieux indiqué que d’opérer cette relation dans le cadre d’une aventure solitaire et salutaire.
L’idée même de pèleriner en laissant, dans son dos, Saint-Jacques de Compostelle qui depuis des siècles est le fin du fin des pèlerinages en Occident, le nec plus ultra, la proue mystérieuse et mystique et un brin dévoyée, révèle le côté facétieux de l’auteur. C’est à n’en pas croire vraiment la réalité de la chose mais c’est ainsi que cela se fit sans autre forme de procès avec le viatique ajusté que tout bon marcheur lancé sur les grands chemins se doit de calculer avec parcimonie, logique et raison. Bref, durant 160 pages il nous est donc donné de suivre l’écrivaine, un peu comme son ombre par des chemins multiples et divers, ensoleillés ou fortement pluvieux. Des intempéries qui mouillent le paquetage et ravivent le froid sur la peau, des rayons solaires qui brûlent plus qu’à leur tour, et des heures et des heures de marche, des kilomètres sous les godillots ( Nous sommes le 21 juin, c’est le solstice d’été et, coïncidence, je me rends compte que je célèbre la journée la plus longue de l’année par la marche la plus longue de mon parcours, neuf heures et trente-sept kilomètres au total. J’ai même droit à une fête de la musique très spéciale, orchestrée symphoniquement par le vent et les vagues. P.148).
Il fallait à minima sinon rappeler du moins évoquer cet aspect physique des choses comme on le ferait des caprices d’un volcan soudainement sorti de sa torpeur terrestre. Mais voilà que derrière le récit méticuleux des tenants et aboutissants de la marche évocatrice, s’immiscent tout au long des pages des raisons autrement plus lointaines, à la source, qui plus que la motivation spirituelle sont constitutives par fragments fortement évocateurs, d’une vie de femme. Qu’on ne s’y trompe pas le récit de voyage se double en contrebande du récit d’une vie. Il est heureux pour le lecteur de découvrir l’autre versant de la marche, celui qui rétablit l’équilibre des abrupts des chemins parcourus, qui rectifie l’affaissement que la fatigue entraîne pour redonner cette colonne vertébrale intérieure que l’esprit vif, et l’écrivaine le démontre à l’envi, ne cessera de donner à voir et à entendre. Il faut avoir du souffle pour marcher si longuement en terre inconnue même si les étapes prodiguent le CMN, confort minimum nécessaire, et plus de souffle encore il faut avoir pour porter en ces pages de la relation de l’aventure, les souvenirs dans lesquels les lieux et les personnes creuseront au fil du temps les fondations d’une personnalité. Tenir debout c’est aussi s’appuyer sur les autres, les reconnaître comme des soutiens inespérés à des moments où on ne s’y attend pas et le livre de Joëlle Cuvilliez fourmille de ses histoires à elle, de ses histoires passées, qui se fondent dans le paysage qu’elle traverse aujourd’hui, dans ceux qu’elle a traversés antan et dans ceux qu’elle aura confectionnés dans sa tête de femme jeune d’abord, de femme aguerrie ensuite, d’individu métamorphosé.
Lire Buen camino, c’est aller à la rencontre de l’écrivaine et c’est découvrir la femme qu’elle s’est forgée, c’est-à-dire qu’elle s’est donnée de devenir au-delà de bien de péripéties, de mises en danger mais aussi de certitudes advenues, l’intime conviction. Les synchronicités comme elles les appellent, entre les êtres, entre les choses, n’auront cessé d’être sa boussole, il faut lire le livre et on s’étonnera de ce fourmillement dans les correspondances qui, sans arrêt, l’auront étonnée et rassurée aussi.
De la Galicie de l’Espagne à L’Algarve du Portugal, tout au long des six cent trente kilomètres, des pensions portugaises en hôtels oubliés ou connus, de dortoirs en chambres borgnes soi-disant individuelles, de villages côtiers reculés en villes décevantes, de restaurants inespérés en boulangeries gourmandes, de ses écarts de route à Fatima, de douches en douches…, pas à pas, nous suivons la marcheuse dans ses rencontres, dans ses pensées et réflexions immédiates et sa relation intime et au monde, à ce qui l’entoure à sa main et à son regard, d’une acuité jamais en sommeil, dans sa propre histoire familiale, professionnelle, amicale. Et la manière là de se dévoiler au détour du chemin est marqué au sceau de la pudeur et de la douleur retenues, d’une vitalité rageuse contenue par l’âge accepté, dans sa jubilation, parce que dire les êtres qu’on aime et qu’on a aimé pour délicat, ravageur, que cela puisse être est aussi la meilleure manière d’apprendre à s’aimer soi-même.
C’est là un livre sans fard que nous livre Joëlle Cuvilliez, d’une simplicité à fleur de mots où la beauté de ce qui s’est donné à voir sous ses yeux se perçoit dans un enthousiasme innocent, ou la difficulté de certains moments transparaît, où la joie et la surprise dans les rencontres comme les déconvenues et les lassitudes tissent une toile à la pluie et aux vents, colorée de soleil et au final, apaisante. L’écriture intransigeante, au cordeau mais toujours ouverte, à l’écoute des autres ( nombreux dans le récit) rend compte du côté aventurier de l’écrivaine de par les continents et pays où elle a fait halte, où elle s’est formée ( l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Europe, le pays de l’enfance), que confirment les multiples aléas, les grands récits historiques notamment de la fin du XXème siècle, dont le livre se fait le creuset en écho à une tessiture, à une âme en quête d’elle-même et de ses semblables. Un livre où se donnent dans les interstices du récit, dans ce recours au chemin, les précédents écrits de l’écrivaine, en rappel d’elle-même, à la cordée des mots pour continuer à tracer le chemin, son chemin…. « Quand l’à pic est assourdissant, regarder les pieds, pas le danger, pas la difficulté à venir, pas la longueur du chemin qui reste à parcourir. Éviter les sauts de cabri, de chèvre, de chamois. Privilégier les pas de fourmi. Se souvenir que la pensée crée la réalité. (p137) »